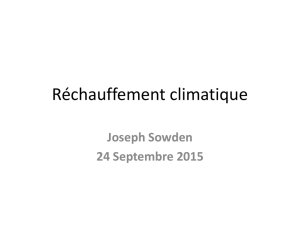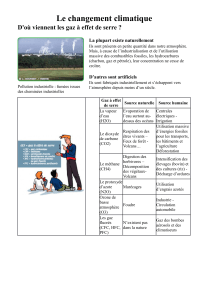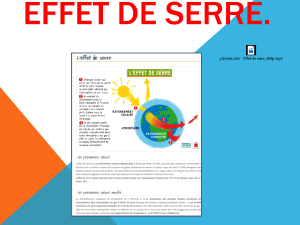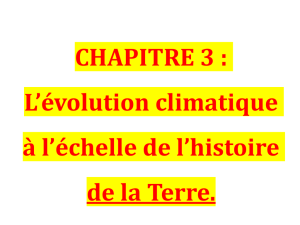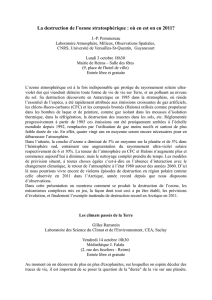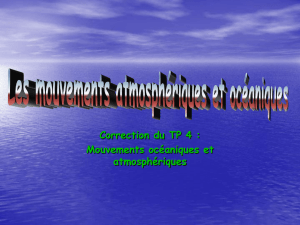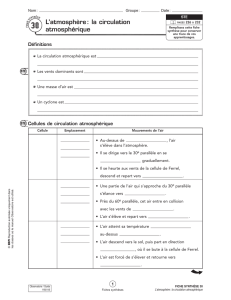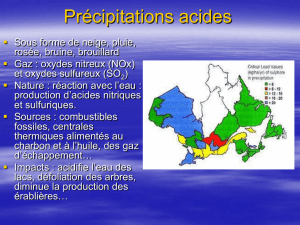À première vue, la Terre semble dotée de toutes les ressources

Àpremière vue, la Terre semble dotée de toutes les
ressources nécessaires à notre survie et à notre confort.
Toutefois, sans l’atmosphère et le Soleil, la vie y serait
impossible. Le Soleil procure à notre planète une quantité
énorme d’énergie, dont dépendent autant les espèces
animales que les espèces végétales. L’atmosphère retient
une partie de cette énergie et les vents aident à la ré-
partir aux quatre coins du globe. De quelle façon cette
énergie circule-t-elle sur la Terre ? Quelles sont ses mani-
festations dans l’atmosphère ? Comment l’être humain
peut-il l’employer pour ses besoins sans nuire à l’environ-
nement ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles
nous répondrons dans ce chapitre.
vers -334
Publication du traité
Les Météorologiques
par Aristote
vers -250
Première estimation
des distances Terre-Lune
et Terre-Soleil
vers -79
Attribution des marées
à l’influence de la Lune
1997
Signature du protocole de
Kyoto, visant la réduction
des émissions de gaz
à effet de serre
1687
Explication des marées
par la théorie de l’attraction
de Newton
1783
Première analyse de
la composition de l’air
1835
Démonstration de l’effet
de Coriolis
1839
Découverte de l’effet
photovoltaïque
1863
Proposition du concept
de l’effet de serre
1913
Démonstration de
l’existence de la couche
d’ozone
1987
Signature du protocole
de Montréal, visant la
réduction des émissions
de CFC
1686
Démonstration que le vent est
engendré par les différences
de pression atmosphérique
1450
Conception de l’anémomètre,
pour mesurer la vitesse
du vent
!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page220

L’atmosphère
et l’espace 7
SOMMAIRE
1. L’atmosphère ............................. 222
1.1 La composition
de l’atmosphère....................... 222
La pression atmosphérique....... 224
1.2 La circulation atmosphérique.. 226
Les vents dominants.................... 227
Les masses d’air............................. 229
Les anticyclones et les
dépressions................................ 230
1.3 L’effet de serre................................ 233
L’augmentation de l’effet
de serre......................................... 233
1.4 La contamination de
l’atmosphère.............................. 235
L’amincissement de la couche
d’ozone......................................... 236
Le smog............................................... 237
1.5 Les ressources énergétiques... 238
L’énergie éolienne.......................... 238
2. L’action du Soleil
et de la Lune
sur la Terre ........................ 239
2.1 L’émission d’énergie par
le Soleil......................................... 239
L’énergie solaire............................... 241
2.2 Le système Terre-Lune................ 243
Les marées......................................... 243
L’énergie marémotrice.................. 245
L
’
u
n
i
v
e
r
s
T
e
r
r
e
e
t
e
s
p
a
c
e
221
!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page221

L’atmosphère est la couche d’air qui enveloppe la Terre. Les gaz qui la com-
posent sont essentiels à la vie sur notre planète:
ils agissent à la manière d’un filtre, en bloquant certains rayons dangereux
du Soleil, comme les rayons ultraviolets;
ils assurent une certaine stabilité du climat terrestre en retenant la chaleur
sur la Terre;
ils sont en partie constitués de dioxygène (O
2
), indispensable à la
RESPI
-
RATION CELLULAIRE
, et de dioxyde de carbone (CO
2
), nécessaire à la
PHO
-
TOSYNTHÈSE
des végétaux.
L’ATMOSPHÈRE est la couche d’air
qui entoure la Terre.
La force d’attraction de la Terre retient les
par ticules qui constituent l’atmosphère au -
tour du globe. C’est pourquoi les particules
d’air sont plus rapprochées les unes des autres
près de la surface de la Terre. Elles le sont
beaucoup moins à haute altitude. En effet,
99% de la masse de l’atmosphère est concen-
trée dans les 30 premiers kilomètres au-
dessus du sol.
Vue de l’espace, l’atmosphère apparaît comme
un fin halo de lumière bleue qui borde la
Terre. En fait, on considère que l’atmosphère
se prolonge jusqu’à plus de 10 000 km au-
dessus de la surface de la Terre.
222
CHAPITRE 7
1L’atmosphère
ST
STE
ATS
SE
CONCEPTS DÉJÀ VUS
Atmosphère
Atome
Molécule
Transformations physiques
Transformations chimiques
Les satellites sont mis en orbite autour de la Terre dans la
haute atmosphère, généralement à plus de 500 km d’altitude.
7.1
L’atmosphère contient 21% de dioxygène (O
2
), mais elle contient surtout
78% de diazote (N
2
). On y trouve également d’autres gaz en très faibles
quantités. C’est ce mélange gazeux que l’on nomme «air». La figure 7.2
montre les proportions des gaz qui composent l’air. Ces proportions ne
changent qu’à très haute altitude (à environ 100 km du sol).
L’AIR est le mélange gazeux, composé surtout de diazote et de
dioxy gène, qui constitue l’atmosphère.
Il est à noter que la vapeur d’eau (H
2
O) est un
composant de l’air très important en météorologie,
puisqu’elle est à l’origine de la formation des
nuages et des précipitations. On parle alors du
«taux d’humidité» de l’air. Selon les régions et la
journée, la vapeur d’eau peut repré senter jusqu’à 4% du volume d’air.
1.1
LA COMPOSITION DE L’ATMOSPHÈRE
ST
STE
ATS
SE
CONCEPTS DÉJÀ VUS
Air (composition)
Couches de l’atmosphère
«Météorologie» provient
des mots grecs
meteora
,
qui signifie «élevé dans
les airs», et
logia
, qui si -
gnifie «théorie».
!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page222

223
L’atmosphère et l’espace
La pollution cosmique
L’espace qui entoure la Terre est pollué. En effet,
depuis les débuts de la conquête de l’espace, dans
les années 1950, les déchets ne cessent de s’accu-
muler dans l’exo sphère (la couche de l’atmosphère
la plus éloignée du sol). On y trouve des débris de
fusées qui ont servi à propulser des engins dans
l’espace, des satellites hors d’usage, des vieilles
batteries ou encore des outils perdus par des
astronautes, comme des tournevis ou des boulons.
Selon les estimations des spécialistes de la NASA,
on trouverait dans l’espace environ 9000 gros
objets, tels que des morceaux d’anciennes fusées,
environ 110 000 débris moyens mesurant entre 1 et
10 cm, et environ 35 millions de débris de l’ordre
de 1 mm, comme des éclats de peinture.
Dans l’exosphère, un simple boulon peut voyager
à une vitesse de 8 km/s, soit 10 fois plus vite
qu’une balle de fusil ! Un choc avec un tel projec-
tile suffirait à faire éclater le hublot d’une navette
spatiale ou à sérieusement endommager un satel-
lite, voire à le faire exploser. C’est pourquoi les spé-
cialistes de la NASA suivent de près la trajectoire
des débris spatiaux.
+
ENVIRONNEMENT
+
L’air contient également des particules solides
et des parti cules liquides en suspension. Ces
particules proviennent de la surface de la
Terre (poussières, pollen, suie, fumée, gout-
telettes, etc.) et se mêlent aux gaz de l’air.
Gaz Symbole Volume (en %)
Vapeur d’eau H2O0 à 4
Argon Ar 0,93
Dioxyde de carbone CO20,038 (variable)
Néon Ne 0,001 8
Hélium He 0,000 52
Méthane CH40,000 17 (variable)
Krypton Kr 0,000 11
Dihydrogène H20,000 05
Oxyde nitreux N2O 0,000 027 (variable)
Xénon Xe 0,000 008 7
Ozone O30,000 001 (variable)
CFC (chlorofluorocarbures) C
n
F
n
Cl
n
0,000 000 1 (variable)
Quelques constituants de l’air
La composition de l’atmosphère en basse altitude.
7.2
Diazote (N2)
78%
Dioxygène
(O2)
21%
Autres
gaz
1%
➞
L’exosphère contient de nombreux débris provenant
de l’exploration spatiale (ci-dessus, une représentation
fictive).
!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page223

224
CHAPITRE 7
L’atmosphère terrestre se divise en cinq grandes couches, qui sont illustrées
à la figure 7.4. Cette figure fait également ressortir deux importantes carac -
téristiques de l’air, soit la pression et la température, qui varient notamment
selon l’altitude. Il est à retenir que plus on monte en altitude, moins il y a de
particules d’air dans l’atmosphère.
La section suivante porte sur la pression atmosphérique, l’un des éléments
essentiels à l’étude de l’atmosphère.
La pression atmosphérique
L’air étant un mélange gazeux, donc un
FLUIDE COMPRESSIBLE
, il exerce une
pression à cause de ses particules qui entrent en collision les unes avec les
autres. Ces collisions déterminent la pression de l’air ou «pression atmo-
sphérique».
La PRESSION ATMOSPHÉRIQUE est la pression de l’air dans
l’atmosphère.
Plus il y a de collisions dans une région donnée, plus la pression atmo-
sphérique y est grande. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique
s’élève en moyenne à 101,3 kilopascals (kPa), 1 kPa équivalant à la pression
qu’exerce une masse de 100 kg sur une surface de 1 m
2
.
Deux facteurs principaux ont un effet sur la pression
atmosphérique:
lorsque le nombre de particules augmente, les colli-
sions sont plus fréquentes et la pression s’élève. À l’in-
verse, lorsque le nombre de particules diminue, la
pression chute. C’est pour cette raison que la pression
dimi nue lorsqu’on s’élève en altitude (voir la figure 7.4);
lorsque l’air se réchauffe, les particules se déplacent
plus vite et le nombre de collisions augmente. Sous
une cloche de verre, où le volume est fixe, la pression
augmente donc avec la température. Dans l’atmo-
sphère cependant, la pression de l’air tend à l’équi-
libre. Quand la température augmente, les particules
s’éloignent les unes des autres, ce qui ramène la pres-
sion vers une valeur plus près de la normale. Résultat:
la
MASSE VOLUMIQUE
de l’air diminue. L’air chaud
est ainsi plus léger que l’air froid et il a tendance à
monter.
La pression atmosphérique varie d’un endroit à un autre
et d’un moment à un autre. Ces variations de pression
sont à l’origine de plusieurs phénomènes atmosphé-
riques. En effet, les particules d’air se déplacent des zones
de haute pression (où elles sont très nombreuses) vers les
zones de basse pression (où elles sont moins nombreuses).
C’est ce qui donne naissance aux vents.
ST
STE
ATS
SE
Plus il y a de particules d’air, plus la pression
est grande, car plus il y a de collisions entre
les particules.
7.3
Haute pression
Basse pression
CONCEPTS DÉJÀ VUS
Pression
Fluide compressible
Relation entre pression
et volume
Masse volumique
Vents
O2
N2
!Chapitre 07 (a) (5e épreuve):Layout 1 09-12-22 12:04 Page224
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%