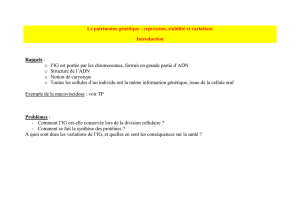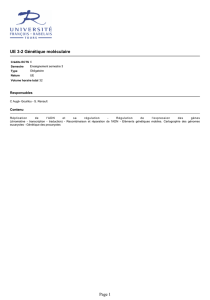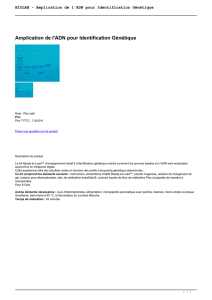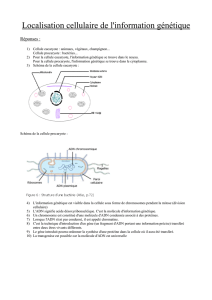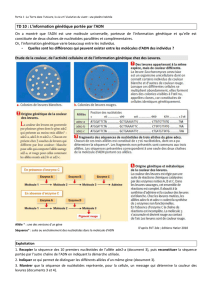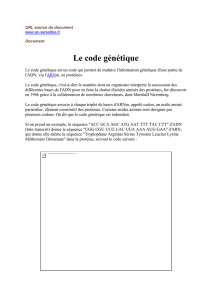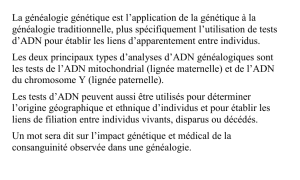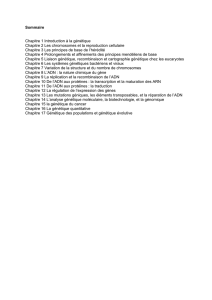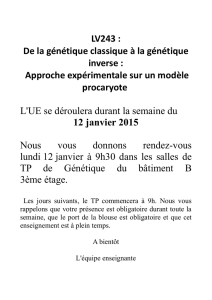texte - Structure et instabilité des génomes

Ondes et particules de vie
Par Pierre Sonigo
Institut Cochin, INSERM, Paris
Copyright Pierre Sonigo 2004
Face aux progrès des biotechnologies, les principes éthiques doivent garantir le respect de
l’individu. Encore faut-il préciser ce qu’est un individu. En première approche, cela semble aller
de soi : un individu, c’est vous ou moi. Mais il existe des situations plus délicates, par exemple au
cours du développement embryonnaire. Certaines questions reviennent fréquemment : combien
de temps faut-il pour qu’un embryon, formé au départ d’une seule cellule, puisse être considéré
comme une « personne humaine » ? Plus généralement, une seule cellule, c’est-à-dire un oeuf
fécondé ou même n’importe quelle cellule de notre corps, peut-elle être considérée comme un
être vivant à part entière ? Malheureusement, ni l’accumulation de données biologiques, ni les
progrès technologiques n’ont permis de répondre de manière définitive à ces questions. La
situation est d’autant plus confuse que, comme nous le verrons, les théories biologiques se
perdent dans la problématique de l’individualité. Même si nous y tenons comme à notre propre
peau, le concept d’individu n’est pas indispensable à une approche scientifique du vivant. Au
contraire. Le progrès scientifique nécessite l’adoption d’un point de vue dont nous ne sommes
pas le centre. La biologie pourrait prendre ses distances par rapport à l’individualité que nous
nous attribuons. L’éthique devrait alors évoluer dans la direction opposée, c’est-à-dire se
rapprocher de l’individu et assumer pour cela des choix de plus en plus indépendants des données
biologiques.
Séquences et conséquences
La génétique apparaît aujourd’hui comme une évidence, une réalité scientifique incontournable.
Ainsi, les dernières décennies ont permis la découverte de l’ADN, le déchiffrage du code
génétique, l’identification des gènes de nombreuses maladies. Plus récemment, le séquençage du
génome humain mais aussi les OGM ou la thérapie génique semblent confirmer le bien-fondé de
cette approche de la biologie. Pourtant, lentement mais sûrement, difficultés scientifiques et
promesses non tenues s’accumulent : les gènes du cancer ne suffisent pas à comprendre le cancer,
les gènes du développement embryonnaire sont les mêmes chez de nombreux organismes, les
gènes du virus du sida ne nous disent pas comment ce virus peut tuer. La pratique de la recherche
impose de douter et de veiller sans cesse à la validité des théories qui guident nos travaux.
Aujourd’hui, la question de la validité des théories génétiques doit être posée et les incohérences
éventuelles soigneusement disséquées. Même si cela peut paraître surprenant, provocateur pour
certains, c’est un élément incontournable de l’activité de recherche. J’ai personnellement été
confronté à des difficultés scientifiques que la génétique ne pouvait pas résoudre. Dans les années
1980, le laboratoire où je préparais ma thèse était spécialisé dans les techniques d’analyse de
l’ADN. A l’époque, nous suivions à la lettre les enseignements de la biologie moléculaire. Quelle
que soit la question posée, nous tentions systématiquement de la résoudre par le séquençage
d’ADN, considéré alors comme la voie royale pour trouver des solutions à des problèmes
biologiques très divers. En l’occurrence, au problème du sida. Fin 1984, nous avons obtenu la
séquence complète du génome du virus du sida. A la publication de ces travaux, des journalistes
nous ont demandé : « Vous avez la séquence du virus du sida, vous devez donc tout comprendre
maintenant… ». L’un d’entre nous, particulièrement inspiré, a répondu : « Nous connaissons son

visage, mais nous ne connaissons pas son cœur». Et quand il a dit « cœur », il me semble qu’il
pensait quasiment « âme ». De retour au laboratoire, j’ai demandé à mon collègue ce qu’il avait
voulu dire exactement. Où pensait-il chercher le cœur en question ? Nous avions la séquence du
virus sous les yeux et reconnaissons que c’est un superbe outil de recherche. Mais cela ne nous
donnait pas une lumière totale sur la maladie, nous n’avions pas le livre du sida.
Schématiquement, le virus est formé de quelques molécules : 12 protéines différentes, plus son
génome. La séquence du génome nous donnait accès à la composition des protéines. Mais rien de
plus. Un virus est un animal extrêmement simple, minuscule, presque ridicule, et s’il y avait un
livre de vie dans les séquences d’ADN, le virus était un objet idéal pour commencer à en
déchiffrer la grammaire. Pourtant, il n’y avait pas d’autre grammaire à appliquer que celle du
code génétique, c’est-à-dire la correspondance entre la structure de l’ADN et la structure des
protéines, que l’on connaît depuis longtemps. La simplicité du virus ne nous révélait pas le
langage des gènes. Nous restions cantonnés à la composition des protéines. Ce qui, bien sûr, pour
un chercheur est très utile. Mais cela ne nous ouvre pas des horizons nouveaux, ne jette pas une
lumière franche sur l’action du virus. On ne sait toujours pas exactement, vingt ans plus tard,
comment le virus du sida tue. Paradoxalement, la publication de la séquence de ce virus - qui était
considérée en 1985 comme un grand succès scientifique -, n’apportait pas la réponse aux
questions que nous nous posions. Le sida reste un drame. Si les solutions ne sont pas là où l’on
pensait, il faut aller les chercher ailleurs. Cette démarche impose de revoir avec un œil le plus
neuf et le plus ouvert possible, les fondements théoriques de la biologie moderne, et de traquer
sans pitié la moindre anomalie. Curieusement, cela conduit à se demander ce qu’est un individu.
Un problème de découpage
La biologie moderne repose sur deux théories bien anciennes : la génétique, issue des travaux de
Gregor Mendel (1822-1884) publiés en 1865, et la théorie de l’évolution par sélection naturelle,
publiée par Charles Darwin (1809-1882) en 1859. La question de l’individu est enfouie au cœur
de ces deux théories. D’un côté, la génétique cherche à expliquer la nature du lien héréditaire
entre deux individus. D’un autre côté, le darwinisme s’appuie sur des différences d’efficacité de
reproduction des mêmes individus : selon le principe de la sélection naturelle, l’entité qui se
reproduit le plus vite se maintient. Encore faut-il s’entendre sur cette entité. En biologie, tout se
reproduit : les gènes, les molécules, les cellules, les organismes, même pour certains les espèces.
Les reproductions de ces différents éléments s’enchevêtrent à des vitesses différentes. Il est donc
indispensable de définir celui qui doit être pris en compte par la sélection naturelle. Mais les
spécialistes n’arrivent pas à se mettre d’accord sur ce point. Au bout du compte, ce sont les
théories qui se multiplient. Selon le niveau choisi on parle de : gène égoïste, darwinisme
moléculaire, darwinisme cellulaire, darwinisme classique, sélection de groupe ou d’espèce ...
Pour illustrer cette difficulté, prenons l’exemple d’une forêt. Même si la taille de la forêt dépend
de la reproduction des plantes et des animaux qui la constituent, on ne dit pas que la forêt elle-
même se reproduit. On dira plutôt qu’elle s’étend, qu’il s’agit de croissance. Pour parler de
reproduction, il faut se référer à un élément précis, une entité dont le nombre est croissant et les
caractéristiques conservées. Il est possible de définir une telle entité dans la forêt : par exemple
une surface, disons un carré de forêt de 100m2. Ces carrés se ressemblent comme des frères. Le
phénomène qui était au départ défini comme une croissance de la forêt, peut maintenant être
considéré comme une reproduction des carrés. Le carré est arbitrairement défini. On aurait pu
tout aussi bien choisir des carrés de 243cm2 ou de 6,55957 m2. C’est donc un découpage tout à
fait arbitraire qui permet d’abandonner le terme de croissance et de considérer exactement le

même phénomène comme une reproduction. De manière générale, lorsque le découpage semble
aller de soi, par exemple pour des animaux, on parlera de reproduction. Au contraire, quand le
découpage est moins évident, comme dans le cas de la forêt, on parlera plutôt de croissance. La
question est donc de savoir ce qui rend le découpage évident dans certains cas, et pas dans
d’autres. Existe-t-il des critères fiables et objectifs, capables de guider un tel découpage ? Le
piège est de croire que c’est simple. Le vieux problème philosophique du « découpage » de la
continuité du réel en éléments individuels est omniprésent en biologie. Dans le monde végétal par
exemple, les branches d’un arbre sont indépendantes et l’arbre est conçu non comme un individu,
mais comme une colonie1. A l’inverse, ce qui apparaît comme des plantes indépendantes peut être
connecté par un réseau de racines souterraines. Dans ce cas, comment compter les plantes ? Autre
classique : la fourmi ouvrière est stérile et ne se reproduit pas. Seule la fourmilière dans son
ensemble se reproduit. Dans ces conditions, de la fourmi ou de la fourmilière, lequel est un
organisme à part entière ? Sous des formes variées, cette question a fait couler beaucoup d’encre,
et la controverse n’est toujours pas résolue.
Dans le cas des humains et des animaux qui leur ressemblent, le problème de découpage posé par
les forêts, les insectes sociaux ou les plantes peut apparaître assez trivial, voire absurde. Tous nos
sens nous indiquent avec force qu’un être humain n’est ni une forêt, ni une fourmi ou une plante.
« Je suis à l’évidence un individu ! » Certes. Mais cette évidence, guidée par un point de vue peu
objectif sur nous-même, n’a rien de scientifique. Comme les branches d’un arbre, nos cellules et
nos organes font preuve d’une certaine indépendance les uns par rapport aux autres.
Contrairement aux évidences, l’idée d’une autonomie de notre organisme ne résiste pas à un
examen même très superficiel. Pour la très biologique reproduction notamment, l’individu
humain est un couple. Pour la nutrition, nous n’irions pas bien loin sans la photosynthèse végétale
ou les activités biochimiques des milliards de bactéries qui peuplent notre intestin. Nous
dépendons des plantes, qui elles-mêmes dépendent de la lumière solaire. Si l’on prend en compte
toutes les connections vitales dont nous dépendons, l’individu réel ne serait-il pas Gaia, notre
planète, voire même l’univers dans son ensemble ? « Mais non, voyons ! » répondent à cela les
gardiens de la spécificité biologique. « L’univers ne se reproduit pas. Seul le vivant se
reproduit. » La reproduction encore ... L’argument des gardiens est circulaire : comme nous
l’avons vu, l’idée de « reproduction » passe par la définition préalable d’un individu de référence.
En renonçant à un tel découpage, les « individus » se fondent dans un tout continu, dont on ne
peut dire qu’il se reproduit. Il s’agit pourtant du même phénomène. En l’absence d’individus
séparés, le terme de reproduction n’a pas de sens. Nous verrons que sur ces bases théoriques, les
vieilles questions qui fondent la biologie -le gène, l’évolution- pourraient trouver de nouvelles
réponses2.
Une vague idée de l’individualité
Imaginons un observateur un peu particulier sur une plage. Il débarque à l’instant d’une planète
lointaine et froide. D’où il vient, il n’y a ni eau liquide ni vent. Le temps est maintenant clair et le
vent de la veille est tombé. Il observe les vagues qui viennent mourir sur le sable. Il écoute
attentivement leur respiration qui s’accentue lorsqu’elles se brisent. Il remarque qu’elles se
succèdent dans le temps et qu’elles se ressemblent. Vaguement. Comme ce qu’il appelle vie sur
sa planète d’origine. Un air de famille mêlé à un souffle de différence. Comment ces vagues
1 Voir F. Hallé. L’éloge de la plante. Seuil.
2 Voir P. Sonigo et I. Stengers. L’évolution. EDP sciences 2003.

naissent-elles ? Sa première intuition est de considérer les vagues comme des individus à part
entière. En effet, chacune semble douée de sa propre autonomie et meurt sans que celle qui la suit
ne s’en soucie. Mais si les vagues sont effectivement autonomes, comment comprendre qu’elles
se ressemblent autant ? Notre observateur imagine qu’un élément invisible doit se propager de
vague en vague et que cet élément produit la ressemblance qu’il cherche à expliquer. Chaque
vague, ainsi née de celle qui la précède, engendrerait celle qui lui succède. La première vague
transmettrait l’élément organisateur à la suivante et cet élément serait capable de conférer une
forme à l’eau. Satisfait de son hypothèse, il choisit pour cet organisateur le nom d’ADN, un terme
ancien qui signifie éternel et créateur. Il réfléchit. Cet élément mystérieux serait-il capable à lui
seul de générer un mouvement aussi organisé, stable, régulier ? Perdu dans ces pensées, il
s’approche progressivement de l’eau. Il remarque que les vagues sont couvertes de vagues plus
petites et que ces vagues plus petites sont-elles mêmes formées de vaguelettes. Il se demande si
l’élément organisateur ne devrait pas plutôt être transmis par les vagues les plus petites.
L’élément définirait la forme des petites vagues qui à son tour déterminerait la forme des plus
grosses. La musique des flots s’inscrit plus nettement dans son esprit. Son rythme lui révèle un
nouveau point troublant. La taille des grosses vagues semble varier de manière régulière, par
groupe de sept. Dans cette forme de vie aquatique, les vrais individus pourraient bien être un
groupe de sept. Cette idée le perturbe : dans cet emboîtement de vagues, quelle est l’entité qui
compte réellement ? Il faudrait entrer en communication avec elles, pour identifier celle qui pense
et qui parle, mais elles semblent beaucoup trop primitives pour cela. Il imagine de nouveau
l’élément organisateur expliquant la régularité et la ressemblance des mouvements de l’eau. Que
cet élément dirige la forme des vagues les plus petites ou des plus grandes, il permettrait en tous
cas de définir le système. Finalement, la seule entité vivante serait en quelque sorte cet élément
organisateur. Les vagues ne seraient qu’un artifice permettant le transport et la propagation
efficace de cet élément. Un élément organisateur égoïste ! Il serait le vivant réel, le reste ne serait
que sa production. A la réflexion, cette idée lui semble un peu mystique. Un seul élément, dont le
fonctionnement est assez hypothétique pour l’instant, pourrait-il expliquer, diriger et animer à lui
seul toute la matière qu’il observe ? Il s’arrête alors de penser et se contente de respirer
calmement, de longs instants. Un souffle d’air frais passe sur son visage. Il réalise l’existence du
vent. La mer devient plus familière. Il ressent peu à peu que les vagues impliquent tous les
composants de l’air et de l’eau. Si les vagues font partie de la même eau, la question de savoir
quel est le découpage qui compte vraiment devient saugrenue. L’absurdité du découpage en
entités autonomes, organisées par un mystérieux élément, lui apparaît brutalement. En l’absence
d’un tel découpage, il n’est nul besoin d’imaginer un élément organisateur qui passe d’une vague
à l’autre. Cette manie de tout découper en éléments individuels - peut-être pour pouvoir les
nommer ? - entraîne souvent sa pensée sur des chemins bien tortueux.
L'individu génétique
La question centrale de la génétique est de comprendre pourquoi les individus se succèdent et se
ressemblent : pourquoi les chats font-ils des chats et les chiens des chiens ? Mais cette question
n'est difficile que parce qu'il est posé d'emblée, par définition, que les parents et les enfants sont
matériellement séparés. En effet, lorsque deux objets font partie de la même matière, le problème
présente peu d'intérêt. Qui se demande vraiment pourquoi les vagues se ressemblent, pourquoi les
bras d'une rivière ressemblent à la rivière dont ils naissent ou pourquoi la moitié d'un cheveu
ressemble terriblement à un cheveu ? Il semble une évidence indiscutable, du moins chez les
animaux supérieurs qui sont souvent au centre de nos pensées, que la mère et l'enfant sont deux

personnes à part entière. Ce n'est le cas, ni pour les vagues, ni pour les bras des rivières, ni pour
les cheveux. Cette intuition forte de la séparation matérielle des parents et des enfants est à
l’origine du problème génétique. Le gène vise à combler le mystère insoluble du lien qui permet
aux générations de se ressembler, alors qu’elles seraient à l’évidence séparées. Si elles étaient
considérées comme un tout, la notion de gène serait inutile. Par contre, avec des générations
indépendantes, si la mère ne transmet pas son propre organisme, elle doit d'une manière ou d'une
autre transmettre quelque chose qui explique les propriétés de celui de l'enfant. C’est le rôle du
gène. Les pionniers de la génétique ont choisi d'attribuer ce lien à la lignée germinale ou germen
défini par la graine, l'œuf ou l'ovule fécondé. Comme l’écrit August Weissmann (1834-1914) :
“ Comment se fait-il qu'une seule cellule puisse reproduire l'ensemble du parent avec toute la
fidélité d'un portrait ? ”3
L’hypothèse de la cellule germinale en tant que responsable de l’hérédité est présentée comme un
fait acquis dans la formulation de Weismann. Pour lui, la question n’est pas de savoir si une seule
cellule produit effectivement l’organisme, mais comment elle le produit. Notons aussi qu’il
exagère l’importance de la ressemblance : parents et enfants se ressemblent certes, mais la fidélité
du portrait reste relative. Bien qu’extrêmement audacieuse, l’hypothèse de Weismann nous
semble aujourd’hui validée et précisée : l’ADN a été identifié comme le « principe actif » de la
cellule germinale. Ce n’est plus une cellule, mais une molécule qui « reproduit l’ensemble du
parent avec toute la fidélité d’un portrait ». Le gène, principe d’hérédité est aussi principe
d’individualité. Dans « le hasard et la nécessité » publié en 19704, Jacques Monod décrit les
systèmes de régulation du fonctionnement génétique :
C'est en définitive la gratuité même de ces systèmes qui ouvrant à l'évolution moléculaire un
champ pratiquement infini d'exploration et d'expérience, lui a permis de construire l'immense
réseau d'interconnections cybernétiques qui font d'un organisme une unité fonctionnelle
autonome dont les performances paraissent transcender les lois de la chimie, sinon leur
échapper.
Même si cela ne correspond pas à leur propre loi, c’est-à-dire celles de la chimie, les milliards de
molécules et de cellules qui nous composent sont supposées obéir à la nôtre avec dévouement.
Comme un seul homme. Gène du doigt, gène de l'œil, on obéit au doigt et à l'œil. Notre
organisme devient unitaire et autonome. Certains auteurs ont poussé encore plus loin la logique
de cette conception. Ainsi, selon la théorie dite du « gène égoïste » popularisée par Richard
Dawkins5, les organismes ne sont que les véhicules qui permettent aux gènes de se propager : le
gène est le seul individu qui compte vraiment. Finalement, les gènes sont le propre d’un individu.
Ils le définissent, le construisent. La génétique renforce ainsi notre sensation d'individualité. Mais
ce renforcement résulte d’un raisonnement circulaire. Comme nous l’avons vu, c’est le
découpage en individus qui a entraîné l’invention d’un concept –le gène- capable de les
connecter. Le gène est cohérent avec le découpage en fonction duquel il a été conçu. Mais il ne
peut en démontrer la réalité.
3 Cité par Evelyn Fox-Keller, le siècle du gène. Gallimard Sciences humaines 2003 pour la traduction française.
4 Editions du Seuil.
5 Pour un exposé récent, voir par exemple. R. Dawkins. The extended phenotype. Nouvelle édition, Oxford
University Press 1999.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%