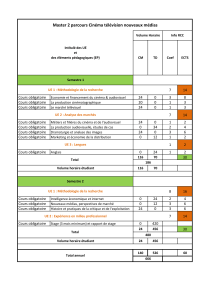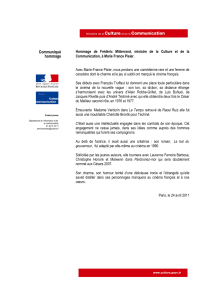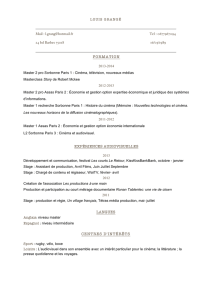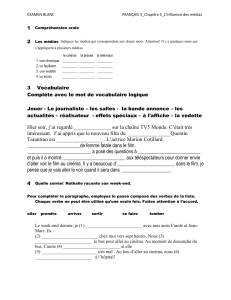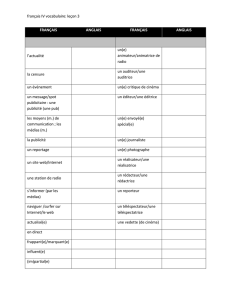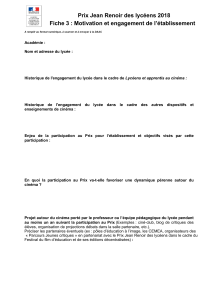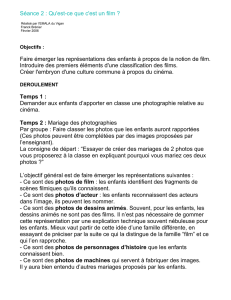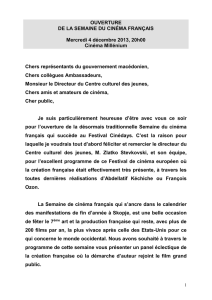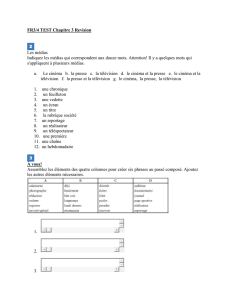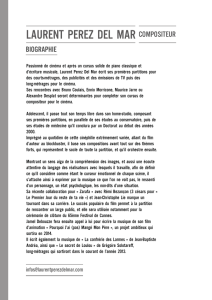Télécharger l`appel à contributions. - Traverses 19-21

Cinéma et Arts de la scène :
interférences temporelles
Colloque International
Jeudi 26 février (Valence)
et vendredi 27 février 2015 (Grenoble)
organisé par Robert Bonamy, Didier Coureau,
Ariane Martinez et Julie Valero
Le colloque « Interférences temporelles » se propose d’examiner la
manière dont le cinéma (ainsi que la vidéo) et les divers arts de la scène
(théâtre, mais aussi danse, cirque, marionnette, mime…) ont pu exercer les
uns sur les autres une influence dans leur rapport au temps : vitesses et
rythmes variables, longues et courtes durées. Les répercussions de ces
phénomènes sur la composition des œuvres, la mise en scène, le jeu de
l’acteur, la perception du spectateur y seront abordées.
Une réflexion sur les temporalités des archives, s’inscrivant dans le
cadre de l’ARC 5 « Archives cinématographiques en Rhône-Alpes : entre
documents et création », complétera ces questionnements, en occupant une
place particulière au sein du colloque (avec des rencontres et des projections
organisées). La question du rapport au temps et à la mémoire, posée par les
archives – filmiques, vidéographiques… – impliquera également des
réflexions d’ordre esthétique sur les choix spécifiques nécessaires à la
conservation des traces des spectacles vivants et éphémères.
Les contributions porteront sur une période étendue, de la fin du XIX
e
siècle jusqu’au XXI
e
siècle. Elles ne se cantonneront pas à une sphère
géographique précise, ni aux interactions directes, mais pourront montrer que
certains procédés temporels peuvent se répondre, d’une culture à l’autre.

Vingt-cinq ans après la publication de L’Image-Temps de Gilles
Deleuze, second volume du philosophe consacré au cinéma, il s’agira donc de
penser une Image-Temps dans un contexte plus vaste, passant par le cinéma et
le regard qu’il porte sur le théâtre et les arts de la scène, et par le théâtre et
les arts de la scène eux-mêmes qui, souvent, se réfèrent au cinéma de manière
plus ou moins avouée, ou font appel à l’image mouvante de la vidéo ouvrant
des espaces virtuels au sein de l’espace scénique.
Axe 1 : Vitesses et rythmes variables
En ce qui concerne la question de la vitesse et du rythme, le cinéma a,
dans ses premiers temps, emprunté certaines conventions à la scène (en
ménageant un temps d’entrée des personnages ; en montrant au spectateur des
scènes, avec un début et une fin, plutôt que des séquences). Mais, une fois
que les potentialités du film ont été mises en évidence, ce fut son tour de
modifier en profondeur la composition temporelle de la représentation
scénique. En effet, on peut lui attribuer – par influence directe ou par
analogie – de nombreux procédés rythmiques : noirs plateau assimilés aux
coupures du montage (ces « coupures irrationnelles » dont parle Deleuze pour
le cinéma « moderne »), immobilisations créant des effets de suspension
imités des arrêts sur image, transitions au ralenti transposées des fondus
enchaînés (autant de procédés qui étaient déjà au cœur des réflexions des
cinéastes des avant-gardes du muet, tels que Jean Epstein et Germaine Dulac).
Se mouvoir au ralenti permet à l’interprète (acteur, danseur, mime,
marionnettiste) de décomposer et de mieux maitriser ses mouvements, mais
aussi de transposer le réel. C’est pourquoi cet exercice a été pratiqué dans
diverses écoles, des années 1920 à aujourd’hui :
Le jeu tendait à la lenteur du ralenti de cinéma, [raconte Étienne Decroux,
ancien élève du Vieux-Colombier de Copeau]. Mais alors que celui-ci est un
ralentissement des fragments du réel, le nôtre était la production lente d’un
geste en lequel beaucoup d’autres étaient synthétisés.
1
1
Étienne Decroux, Paroles sur le mime (nouvelle édition revue et augmentée), Étienne Decroux, Librairie
théâtrale / Gallimard, Paris, 1963, p. 18.

D’autres formes rythmiques inspirées du cinéma ont pu être explorées,
ensuite, par Jacques Lecoq dans son exercice des « bandes mimées » qui
consiste à « exprimer collectivement des images » et surtout à les enchaîner,
en faisant appel à toutes les techniques du cinéma (« les premiers plans, les
plans lointains, les illusions, les flash-back ») et au « langage moderne des
images, avec ses rythmes, ses fulgurances, ses ellipses »
2
.
Les effets sur la mise en scène de certains choix de vitesses et/ou de
rythmes sont notables et constituent parfois la marque distinctive d’un
metteur en scène. Il s’agirait d’en analyser les sources et les effets. Le
recours à ces variations peut avoir une portée esthétique (sortir d’une
temporalité quotidienne), dramaturgique (faire entendre le texte autrement),
ou encore idéologique (évoquer la rapidité du temps médiatique par une
accélération du rythme des images, ou aller à son encontre). C’est ce que
laisse entendre Claude Régy lorsqu’il affirme :
Généralement, les gens ont peur dès qu’ils ralentissent et surtout dès qu’ils
s’arrêtent parce que l’arrêt se fait sur le vide. Mais c’est le contraire. C’est
pendant les arrêts que le vrai plein de l’écriture s’entend si on ne l’a pas dès
le départ occulté. […] Lorsqu’on ralentit on déréalise. On renouvelle la
vision. On s’ouvre au possible d’une relation universelle.
3
La perception du spectateur est bien entendu affectée par ces effets
rythmiques, d’autant qu’ils sont susceptibles d'entrer en contradiction les uns
avec les autres (mouvements lents sur musique au tempo rapide, et
inversement).
Axe 2 : Longues et courtes durées
Des conceptions temporelles, dans les arts de la scène comme au
cinéma, peuvent se fonder sur le choix de privilégier l’esthétique de la longue
durée et de la continuité ou, à l’opposé, l’esthétique de la brièveté et de la
discontinuité.
Quand le cinéma s’intéresse au théâtre, il en retient souvent une
expérience du corps vu en entier (ce que Serge Daney disait à propos de
2
Jacques Lecoq, Le Corps poétique, un enseignement de la création théâtrale, Arles, Actes Sud, 1997, p.112-
113.
3
Claude Régy, L’Ordre des morts, Les Solitaires intempestifs, Besançon, 1999, p. 65-66.

l’esthétique du cinéma de Jacques Rivette) et, au-delà, de l’espace perçu en
entier (scène de théâtre filmée, décor évoquant des décors théâtraux, ou
équivalence de la scène découpée dans le réel extérieur) pour, enfin, inscrire
corps et espace dans le temps long du plan-séquence, ce que Jean-Claude
Biette définissait comme étant le « Théâtre du plan » (en évoquant Monteiro).
Le filmage pouvant demeurer dans la fixité, mais aussi se faire mobile, ainsi
que les yeux du spectateur de théâtre balayant l’espace de la scène peuvent
créer leurs propres cadrages, comme le soulignait Edgar Morin. La perception
directe du temps dans l’image, qui caractérise l’Image-Temps deleuzienne se
fait ainsi ressentir dans la longue durée du plan, et selon différents processus
esthétiques (Rivette, Garrel, Straub et Huillet, Resnais, Duras,
Angelopoulos…). Andreï Tarkovski écrivait en ce sens, dans son ouvrage Le
Temps scellé : « Le rythme d’un film ne réside […] pas dans la succession
métrique de petits morceaux collés bout à bout, mais dans la pression du
temps qui s’écoule à l’intérieur même des plans. »
4
La longue durée du plan et
la longue durée du film va parfois jusqu’à coïncider avec le temps le plus
extrême du théâtre, lorsque Manoel de Oliveira réalise Le Soulier de satin
d’après Paul Claudel, en un film d’une durée de 8 heures.
Le théâtre et les arts de la scène semblent, au contraire, rechercher
aujourd’hui dans le cinéma – la vidéo, la DV – les moyens d’une ouverture
sur l’espace extérieur, mais également la possibilité de morceler l’espace et le
temps, comme dans un certain type de montage jouant sur la brièveté des
plans. Cette attirance pour la courte durée avait déjà connu une première
période de forte valorisation dans les premières décennies du XX
e
siècle. Les
auteurs du Manifeste du « Théâtre futuriste synthétique », Marinetti, Corra,
Settimelli affirmaient ainsi :
Nous sommes convaincus que mécaniquement, à force de brièveté on peut
créer un théâtre absolument nouveau en parfaite harmonie avec notre
sensibilité moderne, laconique et rapide. Nos pièces n’auront pas d’actes, mais
des instants, c’est-à-dire qu’ils dureront quelques secondes. Par cette brièveté
essentielle et synthétique, le théâtre futuriste pourra soutenir et même vaincre
la concurrence du cinématographe.
5
4
Andreï Tarkovski, Le Temps scellé, Cahiers du cinéma, 1989n p. 113.
5
« Le Théâtre Futuriste Synthétique (1915) », manifeste signé par Marinetti, Corra, Settimelli, in Giovanni Lista,
Futurisme, manifestes, documents, proclamations, L’Age d’Homme, Lausanne, 1973, p. 256.

Ils en appelaient aussi à transporter cet « effort vivifiant dans une
autre zone du théâtre : le cinématographe »
6
, moyen se rapprochant le plus de
leur « plurisensibilité »
7
revendiquée. Dziga Vertov – inspiré par le Futurisme
et le Constructivisme – introduisit jusqu’au sein des représentations théâtrales
son cinéma de montage, caractérisé par le collage de plans extrêmement brefs
captés par la puissance du « Ciné-œil » : le film L’Homme à la caméra (3000
plans en en heure), étant l’aboutissement de cette théorie. Dans une autre
sphère des avant-gardes, le Dadaïsme chercha à faire se rejoindre danse et
rythme du montage filmique, par exemple dans le ballet Relâche coordonné
par Francis Picabia, avec les Ballets suédois de Rolf de Maré, sur une
musique d’Erik Satie, spectacle dans lequel était du reste inséré le film
Entracte de René Clair.
Dans les années 1970, Antoine Vitez proposa comme exercices de
style, la « tragédie de cinq minutes » dans laquelle disait-il :
Tous les moments d’une œuvre sont ramassés dans un drame de cinq minutes.
Ou bien les thèmes d’une œuvre sont montrés dans un seul fragment de cette
œuvre, et qui dure cinq minutes. Ainsi, on montre tout Don Juan dans la
deuxième scène d’Elvire, ou tout Hamlet dans la scène avec Gertrude.
8
L'idée est assez proche de celle de Rainer Werner Fassbinder,
réduisant une pièce de Ferdinand Bruckner, pour n’en conserver que les
entrées et sorties : expérience filmée par Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
dans La Fiancée, la comédienne et le maquereau. Ce film commençait par
ailleurs, à l’inverse, par un travelling infiniment long suivant une voiture – en
bordure de la scène de la ville –, accompagné par une musique de Bach.
Allongement et rétrécissement du temps (filmique, théâtral) dans un même
court métrage.
6
Manifeste de la cinématographie futuriste, 1916, Balla, Settimelli, Marinetti, Corra, Ginna, Chiti, in Ibid., p.
298.
7
Ibid.
8
Antoine Vitez, Le Théâtre des idées, Gallimard, Paris, 1991, p. 354
 6
6
 7
7
1
/
7
100%