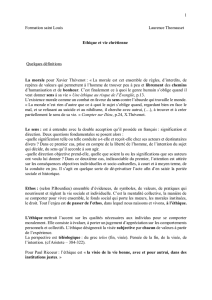PHILOSOPHIE MORALE ET PROBLÈMES ÉTHIQUES

PHILOSOPHIE MORALE ET PROBLÈMES ÉTHIQUE
s
JEAN-LOUIS CHEVREAU – CONFÉRENCES DE L’INSTITUT
MUNICIPAL - 2010

Texte de présentation
La morale est fondamentalement conflictuelle, en cela qu’elle
prétends établir des normes, lesquelles rentrent nécessairement en
conflit dans leur application à des situations concrètes, avec la
conscience morale. Nous en commencerons donc avec la tragédie
grecque « Antigone » de Sophocle, qui est selon Hegel, « l’expression la
plus parfaite du conflit tragique intérieur à la moralité ».
Nous verrons ensuite comment sortir philosophiquement de cette
conscience tragique et tenter une résolution entre la nécessité de la
norme que représente l’obligation, que nous appellerons morale, et une
sagesse pratique, ouverte à la discussion et à la singularité des
situations, que nous appellerons éthique. Cette distinction nous
permettra d’une part, de souligner l’importance et les limites de la raison
pratique chez Kant, à partir de son exigence morale d’universalité et
d’autonomie, et d’autre part, de confronter l’éthique aristotélicienne à des
thèses et des problèmes contemporains

Mercredi 10 novembre 2010
PREMIÈRE PARTIE
INTRODUCTION
Notre époque vit une crise morale sans précédent. Les repères
traditionnels ont disparu. Notre monde « désenchanté » a vu d’abord la
dissolution des croyances religieuses, qui jusqu’alors avaient arrimé la
morale à la volonté divine. Puis s’est effacé l’ascendant des grandes
figures morales des sociétés traditionnelles, la figure hiératique du père,
le respect dû aux aînés, et les règles incontestables de la famille. Enfin,
le développement des sciences et des techniques a également ébranlé
le socle des certitudes morales au profit d’approches plus pragmatiques
que l’on nomme les éthiques. Pour ne prendre que le cas des
biotechnologies, nous nous heurtons à des problèmes que nos
convictions traditionnelles ne peuvent répondre. Des cas nouveaux nous
jettent dans un abîme d’incertitude : procréation artificielle ou assistée,
interruption volontaire de grossesse, dons d’organe, eugénisme,
euthanasie… C’est la raison pour laquelle ces questions suscitent des
réflexions rationnelles, (comités d’éthique) cherchant à savoir ce qu’il
faut faire ou ne pas faire, au cas par cas. Nous verrons aussi pourquoi,
l’éthique prudente d’Aristote peut encore être convoquée pour nous
éclairer.
Cela ne signifie pas que l’action morale des uns et des autres ne
puissent pas être vertueuse. Si comme nous le verrons, nous avons
besoin de fonder rationnellement nos actions, de fait, l’homme vertueux
ne fonde pas son action sur quelque théorie que ce soit, mais il agit « au
moyen de la bonté et de la justice, et on ne peut pas dire qu’il met en
oeuvre la bonté et la justice », comme le dit fort justement cette maxime
confucéenne. Les hommes n’ont d’ailleurs pas attendu la philosophie
pour agir moralement. Cet homme vertueux incarne tout simplement des
valeurs morales sans qu’une règle ne lui soit imposée. C’est aussi le
point de vue de Kant, pour qui la morale n’est pas affaire de savoir mais
de bonne volonté.

Nous verrons que cette conscience morale n’est peut-être pas si pure
que nous pourrions le penser, car si celle-ci ne se réfère à aucun
fondement explicite, cette conscience morale n’est pas sans origine,
même inconsciente (il nous faudra distinguer, le fondement, de l’origine).
Nietzsche sur ce point nous ouvrira des perspectives critiques
intéressantes.
Cependant le problème des fondements est essentiel et c’est
même le problème philosophique par excellence : pouvons-nous justifier
ce que nous faisons ou ce que nous disons ? La philosophie ne se
contente pas de décrire les comportements moraux, elle veut les justifier.
La philosophie morale cherche à répondre, sous la seule autorité de la
raison, à la question des fins et de la destination de l’homme, pour
éclairer ses choix pratiques. En cela elle se distingue radicalement de la
religion, car elle ne dit pas ce qui doit être fait, mais comment ce qui est,
doit être connu, et donc, ce qui peut être changé. C’est pour cette raison,
que la philosophie morale peut-être appelée philosophie pratique.
A cette question des fondements ou des fins, la philosophie a
depuis Platon répondu en définissant préalablement le Bien. Car l’on ne
peut pas connaître les fins que doit se proposer l’action humaine, si l’on
ne détermine pas la fin ultime de toute action : le Bien. De la
connaissance du Bien, découlera le fondement d’une recherche de la vie
bonne et heureuse. Pour le moins il faut tâcher de rendre l’homme,
meilleur. Voilà la destination pratique de la philosophie, si explicite dans
la « République », et qui conduit non seulement à une destination morale
de l’homme, mais aussi à sa destination politique. La connaissance du
Bien, d’où découle la connaissance de la justice, est évidemment l’affaire
de la Cité. Le problème moral est aussi un problème politique.
Dans la « République », le passage le plus parlant de cette
interaction morale et politique, c’est celui du Livre 7, appelé « allégorie
de la caverne ». Nous comprenons que cette ascension hors de la
caverne, au fond de laquelle, il n’y a que des prisonniers attachés par le
cou, qui ne voient que des ombres et des échos, c’est-à-dire que des
simulacres, des chimères, des illusions, représente la sortie hors de ce
monde aveuglé par nos pulsions sensibles et irrationnelles. Cependant
cet homme qui a enfin converti son esprit (conversion intellectuelle) par
la contemplation de l’intelligible, c’est-à-dire par la connaissance des
essences, et donc apte à la science, au savoir, ne doit pas rester à ce
niveau élevé de la spéculation. Il doit opérer une descente vers ce
monde sensible, pour y instruire et diriger ses semblables, s’y comporter
moralement, en donnant l’exemple d’un homme juste, sachant ce qu’est
le Bien et la Justice. C’est pourquoi, selon Platon la philosophie doit non

seulement instruire, mais aussi gouverner la cité. Pour avoir une cité
juste et des lois justes, il faut des magistrats justes.
Si, comme nous l’avons dit, il faut établir des institutions justes, par
une visée éthique appropriée, qui en quelque sorte réponds à une
sagesse pratique, celle ci ne saurait se perdre dans la relativité des
cultures et des mœurs. Il faut pouvoir juger universellement et mettre de
côté toutes nos traditions et particularités. Comme le dit Marcel Conche,
si la morale n’est qu’affaire particulière, comment juger les assassins de
Buchenwald, de Dachau ou d’Auschwitz ? Ces assassins auraient alors
commis la seule faute, d’avoir été vaincus. Il faut bien fonder la morale
sur autre chose que la religion, ou sur une idéologie et même sur une
philosophie particulière.
Revenons à cette morale universelle : S’il faut fonder la morale
non sur le particulier mais sur l’universel, comment penser cet universel
avec des hommes particuliers ? Nous nous interrogerons sur cette vertu
du dialogue et de la discussion et nous verrons en quoi les questions
d’ordre pratique sont susceptibles de vérité, et que le choix que nous
prenons peut échapper à l’arbitraire et aux circonstances, moyennant
leur mise en discussion par des êtres rationnels, comme le dit
Habermas. Nous verrons en quoi une morale déontologique (qui désigne
le domaine des règles et des obligations morales) peut s’articuler aussi
avec une éthique de la discussion.
Si nous voulons fonder un universel vivant, n’est-il pas nécessaire
de fonder cet universel sur l’égalité des hommes, en tant que personne ?
Comme le dit Marcel Conche, « Fonder la morale, c’est alors donner
valeur universelle aux exigences de la conscience commune moderne.
C’est aussi fonder les vrais droits de l’homme ». Nous verrons que la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est loin d’être une
simple fiction formelle destinée à recouvrir les réalités de l’exploitation du
travail dans la « société bourgeoise », comme le pensait Marx. Au
contraire nous verrons en quoi ces droits « s’avèrent constitutifs de
l’espace social démocratique » . Nous interrogerons l’impact de ces
Droits sur une politique morale, et nous nous demanderons si ces Droits
ne sont pas, sur le plan d’une politique extérieure, une légitimation de
l’ordre occidental établi ? Pouvons-nous justifier le droit d’ingérence à
partir des ces Droits universels ? L’actualité politique et militaire nous
proposent suffisamment d’exemples pour notre discussion.
Enfin et logiquement, faisant suite au problème précédent, nous ne
manquerons pas de confronter la morale et l’histoire. Là aussi nous
rencontrerons de sérieux problèmes. Car si un fondement universaliste
de la morale semble une nécessité, comment concilier morale et
histoire ? Nous aborderons la question morale selon Sartre et Simone
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
1
/
99
100%