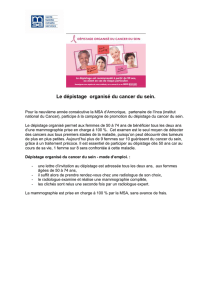Hainaut Prévention Info N° 7

Hainaut Prévention
[
Hainaut Prévention
La lettre d’information aux médecins sur les activités de prévention de l'OSH, Mars 2007 n° 7
Editeur responsable : Luc BERGHMANS rue Saint-Antoine 1 - 7021 Havré Tirage : 2100 exemplaires Parution : Mars 2007
Observatoire de la Santé du Hainaut
rue Saint-Antoine 1 - 7021 Havré (Belgique)
Tél. : 065 87 96 00 Fax : 065 87 96 79 Courriel : [email protected] Web : http://observatoiresante.hainaut.be
4
Cette lettre d’information est disponible gratuitement sur demande écrite à l’OSH, rue Saint-Antoine 1 - 7021 Havré,
par tél. : 065 87 96 00, par courriel : [email protected]
ou téléchargeable via web : http://observatoiresante.hainaut.be
Info
Le dépistage du cancer du sein
Position du Centre Fédéral d’Expertise
En 2005, le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de
Santé (KCE) a réalisé une revue systématique de
littérature scientifique concernant le dépistage du
cancer du sein chez les femmes asymptomatiques à
l’attention des médecins.
Il souligne :
la nécessité d’un programme de dépistage au
niveau de la population ;
le choix de la mammographie comme seul test
fiable pour un dépistage ; l’efficacité d’autres
techniques n’a pas été démontrée ;
la population cible : entre 50 et 69 ans, tous
les 2 ans ;
l’importance de l’information des femmes.
1. Le programme de dépistage au niveau de
la population
L’organisation d’un programme de dépistage au niveau
de la population est essentielle pour assurer un contrôle
de qualité des procédures et une efficacité optimale.
2. La mammographie :
seul test de dépistage
Actuellement, seule la mammographie est recom-
mandée dans la littérature scientifique pour un
dépistage (“mammotest” dans le programme de la
Communauté française) selon les critères d’assurance
de qualité définis par le groupe “L’Europe Contre le
Cancer”. Les centres de dépistage agréés par la
Communauté française répondent à ces critères : la
qualité des appareils et la double lecture des clichés
entre autres.
Suite page 2
Dr Roland BARBIER, médecin généraliste ;
Dr Michel DE JONGHE, médecin généraliste ;
Dr Michèle VILAIN, médecin généraliste.
Comité de lecture
Offre de formation
Vous êtes responsable d’un GLEM ou d’un DODECAGROUPE, vous êtes de la région
du Centre ou de Charleroi et vous souhaitez que le calcul du risque cardiovasculaire
global du patient vous soit présenté…
Votre confrère le Dr BUISSERET peut vous l’exposer en présence d’un médecin
cardiologue “expert”, en collaboration de l’Observatoire pour les supports
pédagogiques.
Contactez-nous au 065/87.96.75 (Dr Berghezan).
D’après le Centre Fédéral d’Expertise, la revue de
littérature scientifique ne permet pas de remettre en
question le programme de dépistage du cancer du sein
chez les femmes de 50 à 69 ans.
Les conditions de réussite du programme de dépistage
dépendent du taux de participation et de la qualité de la
mammographie : le “mammotest” en Communauté
française offre les meilleures garanties de qualité puisqu’il
répond aux normes européennes.
Malheureusement, le taux de participation des femmes de
50 à 69 ans est actuellement nettement insuffisant.
L’extension du programme à d’autres tranches d’âge pose
question :
pour les femmes de 40 à 49 ans, l’efficacité du
dépistage sur la mortalité spécifique n’a pas été
démontrée tandis que les effets négatifs sont
clairement identifiés (en particulier les faux positifs) ;
pour les femmes de 70 à 74 ans, la mammographie
est efficace mais la décision de dépister dépend de
l’espérance de vie et des co-morbidités de la
personne concernée.
Par contre, la revue “Prescrire” jette un pavé dans la
marre : le programme est-il aussi efficace que ce que
démontrent plusieurs études de fiabilité médiocre ?
En tout cas, elle nous interpelle sur plusieurs plans :
le devoir d’une information complète et éclairée des
femmes concernées ;
le regard critique des autorités de la Santé Publique
responsables de la mise en place du programme
national par Mammotest ;
la nécessité d’une évaluation rigoureuse du
programme national ;
le besoin crucial d’une évaluation du bilan
sénologique en Belgique. Dans ce cadre, rien n’a été
mis en place à ce jour pour mesurer les risques et
bénéfices de la démarche auprès des femmes.
Dr Anne-Marie Berghezan Coordinatrice du Programme
Observatoire de la Santé du Hainaut
En conclusion et pour résumer...
Edito
L’année 2006 a vu la publication de plusieurs articles
consacrés à l’efficacité du dépistage du cancer du
sein : en avril, une revue très complète publiée dans
“Prescrire” ; en octobre, la mise à jour de la méta-
analyse de la collaboration Cochrane ; en décembre,
une étude anglaise sur les femmes de 40 à 49 ans.
Ceci nous a incité à faire un tour d’horizon sur la
controverse existant à ce sujet.
Par nature, tout dépistage comporte des effets
bénéfiques et des effets pervers qui sont d’autant plus
gênants que l’intervention s’adresse à une population
a priori en bonne santé. Que le dépistage ait lieu dans
un cadre organisé ou dans un cadre individuel, le
bénéfice n’est que statistique et ne se fait sentir qu’au
niveau de la population. À l’échelle individuelle, le
médecin qui prescrit un dépistage (mammotest ou
bilan sénologique) ne peut pas savoir si le dépistage
va prolonger la vie de sa patiente, sera sans effet
majeur ou conduira à des examens inutilement
invasifs, voire à des traitements superflus parfois
lourds et toujours angoissants.
Les articles parus l’an dernier ont le mérite de relancer
le débat sur l’efficacité du dépistage des cancers du
sein. Les conclusions sur les bénéfices et les
inconvénients des techniques de dépistage
s’appliquent tout autant aux mammotests qu’aux
bilans sénologiques utilisés pour le dépistage. Les
programmes organisés ont néanmoins le mérite
d’atteindre plus équitablement les différents groupes
de femmes, d’instaurer un contrôle de qualité et de
permettre une évaluation de leur efficacité en termes
de détection de cas. Cette évaluation ne remplace pas
les essais randomisés et ne suffit pas pour trancher le
débat sur l’efficacité du dépistage. Elle permet de
contrôler a posteriori la qualité du travail accompli.
J’espère que ce numéro alimentera un débat basé sur
les éléments scientifiques disponibles dans un
domaine où la balance risques/bénéfices des
examens réalisés serait moins favorable que nous le
pensions initialement.
Dr Christian Massot Responsable du programme
Observatoire de la Santé du Hainaut
Les brèves...
SANTE BUCCO-DENTAIRE DES JEUNES SCOLARISES EN HAINAUT
La Fondation pour la Santé Dentaire et l’Observatoire de la Santé du Hainaut ont réalisé une enquête sur
la santé bucco-dentaire des jeunes. L’enquête a été menée auprès de 1147 jeunes selon un protocole
de recherche de l’OMS. Elle s’est déroulée dans le cadre du réseau des Centres de santé scolaire
vigies et a reçu le soutien de la Communauté française.
Les résultats de l’enquête sont à votre disposition. Pour toute commande,
contactez nous au 065 87 96 14.
LES MIDIS SANTE DU BOIS D’HAVRE
Jeudi 12 avril 07 : Installation des assuétudes chez les jeunes Chantal CLAES - Association Pénombre
Mardi 8 mai 07 : L’étiquetage nutritionnel Samuel TOURBEZ - Espace de prévention et d’intervention sur les
addictives
Jeudi 28 juin 07 : Croissance contre santé Christian LEONARD - Economiste de la santé - Professeur de politique
de santé

2 3
(1) Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography
The Cochrane Collaboration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006;
Issue 4:1-64
(1) revue “Prescrire” 2006 ; 26 (271) : 269-310
revue “Prescrire” 2006 ; 26 (272) : 348-374
Pour la mise en place d’un programme de dépistage, les
principales motivations sont le bénéfice d’un traitement
précoce et la réassurance des femmes dont l’examen est
négatif.
Ces arguments doivent être pondérés par les effets
négatifs potentiels de l’examen :
les faux positifs : ils entraînent une anxiété inutile
chez les femmes, de nombreux examens complé-
mentaires inutiles et coûteux, parfois invasifs ;
les faux négatifs : des femmes faussement
réassurées pourraient retarder une consultation
lors de symptômes entre deux dépistages ;
les traitements non nécessaires : les cancers
dépistés ne sont pas de même pronostic que des
lésions qui s’expriment cliniquement. Parmi eux,
certains cancers même invasifs ont un
développement lent tandis que certains cancers
“in situ” n’évolueront probablement jamais vers
des cancers invasifs. L’histoire naturelle des
cancers du sein est mal connue.
3. La population cible : les femmes entre 50
et 69 ans
La population cible pour le dépistage du cancer du sein est
la population des femmes âgées de 50 à 69 ans. C’est
dans cette tranche d’âge que les diminutions de mortalité
les plus importantes ont été observées. Par ailleurs, le KCE
souligne qu’il est nécessaire d’interpréter avec prudence
les études qui évaluent l’efficacité des programmes de
dépistage. Leur interprétation est toujours délicate en
raison des nombreux facteurs qui peuvent influencer la
mortalité spécifique.
La littérature scientifique actuelle n’a pu mettre en
évidence de diminution de mortalité chez les femmes dont
le dépistage se déroule entre 40 et 49 ans. Par ailleurs, les
bénéfices au-delà de 70 ans dépendent de l’espérance de
vie de la personne concernée et les données manquent
sur le dépistage à cet âge. Les données disponibles ne
permettent donc pas de recommander un dépistage de
masse pour ces tranches d’âges.
4. L’information des femmes : une priorité
Le KCE rappelle l’importance d’informer les femmes au
sujet du dépistage du cancer du sein. Le message doit être
objectif, nuancé et compréhensible. Les limites et les effets
négatifs doivent être expliqués.
Actuellement, les médias constituent la source
d’information principale de nombreuses femmes. Elles ont
parfois des attentes démesurées quant à l’efficacité du
dépistage et n’ont pas une bonne connaissance de ses
effets potentiels positifs et négatifs. Tous les canaux
disponibles doivent être utilisés à cette fin : en priorité, le
médecin de famille et le gynécologue jouent un rôle
primordial de conseillers.
Résumé révisé par Dominique Paulus, médecin expert senior au
Centre Fédéral d’Expertise et co-auteur du document initial
Plus d’informations ?
Le rapport du Centre Fédéral d’Expertise des Soins
de Santé : http://kce.fgov.be (rapport 11B, 2005).
Le rapport de l’Agence Intermutualiste relatif aux
données du dépistage en Belgique :
http://www.nic-ima.be/ (onglet “projets”).
Le dépistage du cancer du sein :
Position du Centre Fédéral d’Expertise
Les auteurs ont examiné 7 études. Une est rejetée en
raison de biais majeurs. Deux sont jugées de bonne qualité
et ne montrent pas de réduction de la mortalité par cancer
du sein dans le groupe “dépistage”. Quatre présentent des
défauts méthodologiques susceptibles d’altérer les
résultats et montrent une réduction de 25 % de la mortalité
par cancer du sein dans le groupe “dépistage”.
Au vu des données disponibles, les auteurs estiment que
le dépistage par mammographie permet de réduire la
mortalité par cancer du sein de 15 % environ, ce qui
représente un risque absolu de 0,05 %. Le dépistage
entraîne un surdiagnostic et un surtraitement évalués à
30 % soit un risque absolu de 0,5 %. Autrement dit, pour
2000 femmes invitées pendant 10 ans, une verra sa vie
prolongée, 10 femmes indemnes de cancer du sein en
l’absence de dépistage seront diagnostiquées et traitées
inutilement pour cancer du sein.
Tous les auteurs ne partagent pas le point de vue de
Gøtzsche et Nielsen. Nul doute que cette publication
suscitera encore bien des discussions sur l’intérêt du
dépistage fut-il opportuniste ou de masse.
Résumé : Dr Christian Massot Responsable du programme
Observatoire de la Santé du Hainaut
Dépistage du cancer du sein : mise à jour de la méta-analyse de
la Collaboration Cochrane 1
L’effet sur la mortalité du dépistage systématique du
cancer du sein chez les femmes de 40 à 49 ans fait l’objet
d’une controverse. Certains des bénéfices observés sont
attribués au dépistage après 50 ans de femmes âgées de
moins de 50 ans au moment de leur inclusion dans les
études.
En décembre 2006, S. Moss et coll. ont publié un article
dans le Lancet(1). Cette étude britannique porte sur
160 921 femmes âgées de 39 à 41 ans au moment de
l’inclusion. Le groupe intervention a été invité à passer une
mammographie annuelle jusqu’à l’année du 48ème
anniversaire. Le groupe contrôle a reçu la prise en charge
habituelle.
Les résultats montrent une diminution non significative de
17 % de la mortalité par cancer du sein (intervalle de
confiance à 95 % : moins 34 % à plus 4 %). Les auteurs
attribuent l’absence de signification statistique à un
échantillon moins élevé que prévu initialement et à un taux
de mortalité par cancer du sein plus faible qu’attendu dans
le groupe contrôle.
Dans cette étude, il faut dépister environ 2500 femmes
pour prévenir un décès. Le risque de faux positifs au bout
de 7 dépistages est environ deux fois plus élevé chez les
40-49ans (23 %) que chez les 50 ans et plus (12 %).
Sans trancher définitivement la question, cette étude
apporte des éléments à intégrer à ceux des études
antérieures sur la difficile question de l’utilité d’un
dépistage avant 50 ans.
Résumé : Dr Christian Massot Responsable du programme
Observatoire de la Santé du Hainaut
Le dépistage des femmes de 40 à 49 ans : une nouvelle publication
Suite à la publication dans la revue “Prescrire” en avril et
mai 2006(1) d’articles portant sur la pertinence de la
mammographie, il nous a semblé important de vous faire
part des messages principaux à en retenir.
Les cancers du sein sont les cancers les plus fréquents
chez la femme. La taille, l’envahissement local et à
distance jouent un rôle primordial sur le résultat du
traitement. La détection des cancers du sein a semblé être
une méthode susceptible d’améliorer le pronostic.
Les mammographies de dépistages du cancer du sein ont
fait l’objet de 10 essais comparatifs randomisés, tous
réalisés dans une population générale, chez des femmes
de 40 à 69 ans. Ces essais se révèlent être de qualité très
disparate.
Pour les femmes de 40-49 ans, aucun résultat significatif
n’a été observé.
Pour les femmes de 50-59 ans et 60-69 ans, les
diminutions de mortalité sont plus marquées dans les
études de moindre qualité. Les études de bonne qualité ne
montrent pas de diminution de mortalité. Les résultats
relatifs à la diminution de la mortalité due au cancer du sein
sont de faibles niveaux de preuves.
Pour les femmes de 70 ans et plus, il n’y a pas d’étude à
grande échelle.
Un autre bénéfice du dépistage pourrait être le recours à
une chirurgie moins mutilante ou à des traitements moins
pénibles. Ce n’est pas le cas dans tous les pays, le
programme de dépistage s’accompagne tantôt d’une
diminution tantôt d’une augmentation du nombre de
mastectomies.
Face aux incertitudes qui pèsent sur l’effet sur la mortalité,
il faut aussi examiner les effets indésirables du dépistage :
1. une douleur lors de l’examen ;
2. une irradiation responsable de l’induction de
cancer du sein et de 1 à 5 décès pour 100 000
femmes pour un dépistage à partir de 50 ans.
Cet effet est plus marqué à un âge plus précoce ;
3. des effets psychologiques : réactions anxieuses
voire dépressives liées à l’attente des résultats
des examens complémentaires ;
4. de nombreuses biopsies du sein en l’ab-
sence de cancer du sein ;
5. des diagnostics par excès : certains cancers du
sein découverts grâce au programme de
dépistage n’auraient jamais eu d’expression
clinique pour la patiente, ou en tout cas,
n’auraient influencé ni la mortalité ni la morbidité.
Dr Michel Dejonghe, médecin généraliste
avec la collaboration de l’OSH
Les avantages de la mammographie de dépistage dépassent-ils
les effets indésirables ?
Position de la revue “Prescrire”
(1) Moss S, Cuckle H, Evans A, Johns L, Waller M, Bobrow L et al. Effect of
mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality at
10 years’follow-up : a randomised controlled trial. The Lancet 2006 ; 368
(December 9, 2006) : 2053-2060
1
/
2
100%