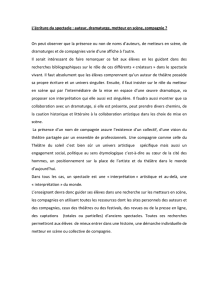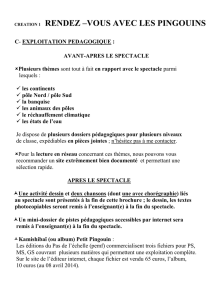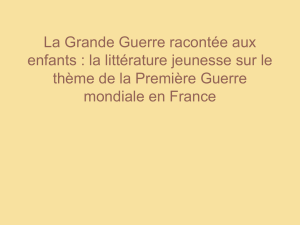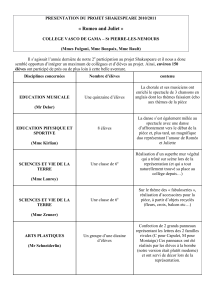LES GARçONS EN CRAMPONS

38 39
si abuser du théâtre pour faire en sorte que ces pro-
blèmes atterrissent au moins dans les médias ; en
faisant exploser un œuf de Pâques, ou en faisant
chanter en chœur, à des sans-papiers en grève de
la faim, l’hymne national belge en trois langues, par
exemple. Mais le but de ce type de théâtre est dif-
férent de ce que nous réalisons avec Steigeisen. En
prison, l’objectif était notamment de valoriser ces
gens – considérés comme des ‘rebuts’ de la société
– pour ce qu’ils faisaient sur scène. Je ne suis pas un
thérapeute. Par contre, j’ai beaucoup appris en tant
que metteur en scène en prison et en psychiatrie.
Là, je ne devais pas vendre du ‘non-sens théâtral’
et tourner autour du pot. Un metteur en scène, c’est
aussi naturellement un ego, qui veut trouver une
solution à tout. Mais là, j’ai appris à ne pas pous-
ser et tirer un acteur pour boucler coûte que coûte
une scène. J’ai appris à regarder un acteur et à voir
ce qui se passe vraiment au lieu de ce que je vou-
drais voir. Ce n’est pas évident. Encore aujourd’hui,
je continue à trouver la démarche difficile. »
Votre collaboration respecte-t-elle une
méthode particulière ?
J: « L’année dernière, nous avons réalisé Lethal
Inc., un spectacle basé sur la recherche de mé-
thodes d’exécution ‘humaines’. Ce spectacle, qui
met en scène un commandant de camp et un né-
gationniste de l’Holocauste inventeur de machines
d’exécution, est né de l’étonnement et de la volon-
té de comprendre pourquoi des gens en arrivent à
commettre de tels actes. Avec l’acteur Joris Hes-
sels, nous avons mené ensemble des recherches,
lu des livres, regardé des films. Pour d’autres spec-
tacles, nous parlons avec des témoins. C’est actuel-
lement le cas pour la préparation de De Onkreukel-
bare. Nous lisons Hannah Arendt, Zizeck, mais hier
nous avons aussi regardé un film de Woody Allen.
Nous entassons tous ces éléments et nous nous
mettons au travail. À partir d’un certain moment, les
rôles deviennent clairs. Je ne reste pas là à attendre
les instructions de Thomas, mais en définitive, c’est
bien lui – le metteur en scène – qui tranche. »
T: « A un moment donné, Jeroen monte sur
scène et je vais m’asseoir devant. J’aime pouvoir
conserver une vue d’ensemble. Je suis un accro du
contrôle. Je veux voir ce que je suis en train de faire,
je n’aime pas les bouts qui partent dans tous les
sens. Tout ce qu’on voit doit avoir un sens. Parfois,
pourtant, je joue avec d’autres metteurs en scène,
et c’est une bonne chose. L’acteur est un être vani-
teux et en même temps très fragile. Et cela, un met-
teur en scène ne doit jamais l’oublier. »
Dans le spectacle Billy, Sally, Jerry and the .38
gun, on retrouve aussi sur scène, aux côtés de
Jeroen, Willy Thomas et Isabelle Van Hecke.
T: « C’était une autre manière de travailler, car à
l’époque, j’avais déjà écrit le texte à l’avance. Ce qui
n’empêche pas de nombreux remaniements pen-
dant le processus de travail. »
Billy, Sally, Jerry and the .38 Gun raconte un
jour de septembre 1975, le jour où le président
américain Gerald Ford a échappé pour la
seconde fois à une tentative d’assassinat.
T: « Le jour où Sara Jane Moore pointe son arme
sur Ford. Billy s’est inspiré d’Oliver Sipple, l’homme
qui se trouvait entre Ford et Moore et qui, bien mal-
gré lui, est devenu un symbole du mouvement gay.
Trois vies qui se rejoignent presque par accident. »
J: « Dans ce spectacle, on retrouve l’étonnement
que je veux communiquer à travers la question com-
ment ce président mélancolique, cette femme au
foyer révolutionnaire et cet ancien militaire homo-
sexuel se rencontrent à cette époque cruciale. Ces
petites gens évoquent tout un monde. »
T: « Ce sont trois personnages solitaires à qui
on doit, par accident, un grand courant historique
dont les répercussions se font toujours sentir au-
jourd’hui. J’ignore pourquoi, mais chez nous, la
fascination pour l’homme ordinaire est manifes-
tement profonde. Dans Billy, Sally…, on voit avec
quelle impulsivité et selon quel hasard ces trois
courants historiques se sont télescopés. L’impé-
rialisme américain dans les années septante, les
mouvements révolutionnaires de l’époque et le
renversement des idées libertaires des années
soixante. J’ai lu récemment The seventies Unplug-
ged, un compendium des années septante, selon
lequel le fait que ce sont précisément des gens
ordinaires qui recourent en masse à la violence,
à travers des actes terroristes, est représentatif
des années septante. Nous sommes nés en 1983,
peu de gens de notre génération peuvent encore se
représenter quelque chose des années septante.
Souvent, cette période nous évoque quelque chose
de semblable aux années soixante, mais avec une
crise économique plus poussée. Alors qu’on sent
justement que tout, dans les années soixante, était
mis sens dessus dessous. »
Pouvez-vous aussi donner libre cours à cette
fascination pour les gens ordinaires avec le
personnage de Robespierre, qui vous occupe
actuellement ?
T: « Une des questions qui me taraudent est de
savoir comment un personnage relativement ordi-
naire comme Robespierre a pu se transformer, en
un temps aussi court, en l’une des figures les plus
redoutées de la révolution. De nombreux mythes
entourent l’homme, il a beaucoup de sang sur les
mains, alors qu’il plaide, dans l’un de ses premiers
textes, pour l’obtention de droits civils pour les
juifs et les acteurs ainsi que pour la suppression de
l’esclavage et de la peine de mort. Comment tout
bascule-t-il, pourquoi cela devient-il soudain si vio-
lent ? Ce caractère ordinaire n’est d’ailleurs pas un
jugement de valeur, mais plutôt un constat. C’est
pourquoi ce spectacle parle aussi un peu de nous,
de cet état ordinaire, cette médiocrité dans la-
quelle nous nous retrouvons aussi. Nous essayons
de courir après les grands événements, mais nous-
mêmes nous ne sommes pas les grands penseurs
et génies de cette époque. C’est l’avantage d’un
spectacle : on peut y entasser une foule de ques-
tions auxquelles on n’a pas de réponse. »
Est-ce aussi un avantage : le fait de ne pas
devoir, dans un spectacle, présenter des
points de vue arrêtés et des slogans, mais
de pouvoir au contraire manipuler la matière
avec hésitation ?
J: « Oui, avec beaucoup d’hésitation et, à cer-
tains moments, c’est déjà provocateur en soi de ne
pas adopter de point de vue. Nous avons déjà re-
marqué que c’est déstabilisant pour les gens. »
T: « Bien sûr, on a bien un avis. Dans les premières
semaines de répétition de Fobbit, par exemple, nous
avons en fait réalisé inconsciemment un pamphlet
anti-guerre. Puis nous nous sommes dit : notre vo-
lonté de ne pas propager la guerre est tout de même
évidente, pas besoin d’en faire un spectacle. Nous
voulions dresser le portrait d’un homme, et distiller
entre les lignes ce que nous pensions. Nous voulions
que les gens s’identifient ou se posent les questions
que nous nous sommes aussi posées pendant le
processus de création. »
« Sally était à la fois agent double pour les ser-
vices secrets et active dans des groupements d’op-
position d’extrême-gauche. Elle s’est mariée à plu-
sieurs reprises. Femme de militaire, elle a vécu un
temps dans une base militaire. Plus tard, elle s’est
remariée avec un médecin et s’est installée dans un
faubourg. Elle a ensuite épousé un ingénieur du son
hollywoodien, nominé aux Oscars pour son travail
dans Citizen Kane. Plus tard, elle deviendra membre
de mouvements de gauche. Elle change sans cesse
– et sans difficulté – de cadre idéologique. Beau-
coup de ses décisions sont motivées par un inson-
dable sentiment de solitude. Sa décision de pointer
une arme sur Ford relève peut-être davantage de
la tentative désespérée d’être considérée comme
un être à part entière que d’un geste véritablement
porté par sa foi dans la révolution. Pourtant, c’est
bien elle qui appuie sur la détente. Pour moi, cela en
dit très long sur la manière dont l’histoire s’écrit. Il
en va de même pour Ford, qui est devenu président
par hasard, après que Nixon se soit fourvoyé dans le
scandale du Watergate en 1974. Ford est cependant
l’initiateur des accords d’Helsinki, dont il pourra se
targuer plus tard d’avoir été le préambule à la chute
du mur de Berlin. Il porte la responsabilité du retrait
des troupes américaines du Vietnam. Mais il ne sera
jamais élu démocratiquement. Il ne cessera de se
battre avec un complexe d’infériorité… »
Ce ne sont pas des héros...
J: « Les héros ne sont pas tellement intéres-
sants. Je me demande s’ils existent vraiment. L’his-
toire s’écrit davantage par accident que grâce au
penseur d’un grand projet. »
T: « On rencontre parfois des personnages
comme Robespierre, dont l’image est inattaquable.
Je pourrais difficilement les appeler des héros. Nous
l’appelons, en néerlandais, ‘l’infroissable’ (de on-
kreukelbare), car cela sonne plus ‘bête’ que ‘l’incor-
ruptible’ (de onkreukbare), le surnom qu’il avait déjà
reçu de son vivant. À l’époque de la révolution fran-
çaise, de nombreux révolutionnaires vont tomber
en décadence après l’exécution du roi. Ils se réfu-
gient dans les palais et s’emparent de ceux-ci. Mais
Robespierre continue d’habiter dans un petit ap-
partement, dans la maison d’un ébéniste. La seule
chose à laquelle il consacre de l’argent, c’est l’achat
d’un coûteux manteau bleu ciel qu’il fait réaliser par
le meilleur tailleur. Mais nous ne ferons certaine-
ment pas de spectacle sur Robespierre sans nous
soucier du monde dans lequel nous vivons. En plus
de lire et de consulter du matériel plus historique,
nous voulons aussi aller discuter avec des gens di-
rectement impliqués dans les révolutions arabes. »
Qu’est-ce qui relie Robespierre à cette
époque, l’actualité politique en 2012 ?
J: « Il y a surtout beaucoup de questions qui
sont lancées. Existe-t-il des scénarios pour une
révolution ? Pourquoi, bon Dieu, trouve-t-on si peu
d’exemples de révolutions qui ne se sont pas termi-
nées dans un bain de sang ? Pourquoi la révolution
dévore-t-elle ses propres enfants ? Hannah Arendt
écrit que la révolution française a été le brouillon de
toutes les révolutions suivantes. »
T: « Dans un certain sens, la révolution française
est née dans un contexte de pauvreté poignante. Il
n’en va pas autrement des révolutions arabes. Cela
commence chaque fois avec des gens qui ont faim
et avec quelqu’un qui est assis, depuis bien trop
longtemps déjà, derrière son bureau, et qui ne veut
pas lâcher le morceau. Donnez à quelqu’un un bu-
reau et une carte de visite, et il se passe des choses
étranges dans sa tête. Tout à coup, la question n’est
plus : pourquoi suis-je là derrière ce bureau ? Mais
bien : que faire pour rester le plus longtemps pos-
sible derrière ce bureau ? Et comment expliquer que
ceux qui finissent par le pousser de son bureau vont
eux-mêmes s’installer derrière ce bureau ? Et alors
qu’on n’arrive à nouveau pas à s’en débarasser ? Je
ne sais pas. C’est humain. Tellement humain. C’est
ce qui est alarmant. »
Avez-vous un bureau et des cartes de visite ?
T: « Non. Dieu merci. »
J: « Mais nous avons un site Web. »
interview / fr
Ils font du théâtre en s’inclinant devant la petitesse
de l’homme. Ils le font avec des images fortes, un
grand engagement et un plongeon dans la réalité.
Nous vous présentons Thomas Bellinck et Jeroen
Vander Ven, le duo de Steigeisen.
« Sur la terrasse d’Al Jazeera. » C’est là qu’ils se
sont rencontrés. En 2005, le premier jour de leur
épreuve d’admission au RITS, à Bruxelles. Devant
attendre le verdict du jury, ils se sont mis en route
pour Molenbeek, à la recherche d’un café où on sert
de la bière au fût. Une quête quelque peu complexe
– ils ont dû se rabattre sur la terrasse du café Al
Jazeera. Ils y ont passé tout l’après-midi, d’une ma-
nière qui pourrait servir de métaphore à la collabo-
ration de Jeroen Vander Ven et Thomas Bellinck de-
puis quelques années déjà : moitié à l’ombre, moitié
au soleil. Jeroen : « À la fin de cet après-midi-là, la
moitié du visage de Thomas était brûlée. »
Pendant leurs années au RITS, ils ont réguliè-
rement travaillé ensemble. Notamment sur un
spectacle sur Robespierre, un personnage qu’ils
repassent au crible cette année dans De Onkreu-
kelbare. Jeroen : « Thomas suivait la formation de
metteur en scène et moi, celle d’acteur. Plus nous
faisions de choses ensemble, plus il est apparu
que nous étions, d’une certaine façon, compa-
tibles. Nous avons trouvé une sorte de méthode de
travail commune. » En 2009, ils couronnent leurs
études avec le spectacle Fobbit, basé sur des in-
terviews de militaires belges en Afghanistan et de
témoins oculaires.
Avec ce spectacle, le monde du théâtre n’a pas
tardé à comprendre que ces deux jeunes pousses
s’étaient solidement implantées. Avec des docu-
mentaires historiques, visuellement forts, ils sont
passés maîtres dans l’art de susciter des am-
biances et des questions qui font la différence.
En 2009, ils créent leur propre groupe : Steigeisen.
Steigeisen ?
J: « Nous devions rapidement trouver un nom et
Thomas l’a mis sur le tapis. »
T: « À défaut de trouver un nom qui reflète ce que
l’on fait, on espère quand même que ce que l’on fait
soit associé à notre nom. J’étais en train de feuil-
leter Der Grosse Duden, un dictionnaire illustré al-
lemand des années trente, lorsque j’ai vu le mot
‘Steigeisen’. Il a une consonance chaude, c’est un
mot ‘confortable’, mais il désigne en fait une bot-
tine munie de gros clous. C’est un crampon pour
gravir les glaciers. Le correcteur orthographique le
transforme toujours en ‘steengeiten’ : ‘chamois’ en
néerlandais. »
L’une de vos marques de fabrique est une
énorme attention accordée au commun des
mortels dans l’immensité des événements.
Et une fascination pour une réalité politique
et ses répercussions sur la vie des gens
ordinaires.
T: « Je veux faire des choses en rapport avec le
monde dans lequel je vis, des choses qui me fâchent
ou qui m’abasourdissent. C’est le point de départ
de De Onkreukelbare, qui s’inspire du personnage
de Robespierre et de la révolution française. Mais
par ailleurs, le Printemps arabe donne également à
ce spectacle un double cadre. Je veux parler de ce
qui se passe autour de moi. Parfois, cela s’exprime
à travers des actions plus politiques, parfois à tra-
vers le théâtre. »
J: « Quand quelque chose m’étonne, je veux es-
sayer de m’en approcher. Et cela, j’y parviens en
créant un spectacle. Je veux communiquer cet
étonnement. Et surtout, je veux savoir en quoi
consiste l’histoire du citoyen lambda dans une si-
tuation politique dans laquelle il est enfermé ou
tient lieu de modèle. »
Thomas, on t’a vu dans la série documentaire
Leuven Hulp, en tant que metteur en scène
d’une pièce de théâtre en prison. Tu travailles
avec des détenus et avec des patients
psychiatriques. Avec Jeroen, tu as fait
exploser un œuf de Pâques devant le ministère
pour attirer l’attention sur le problème
des sans-papiers. Dans quelle mesure cet
engagement social concret détermine-t-il vos
pièces de théâtre ?
T: « Je ne suis pas quelqu’un qui défile facilement
dans des manifestations derrière des banderoles.
Je ne me lancerai pas à la légère dans un spectacle
sur les sans-papiers, car je sais qu’il deviendrait
un pamphlet. Par contre, parce que je connais per-
sonnellement des sans-papiers et des gens qui ont
mené des grèves de la faim, ce sont des situations
qui me mettent profondément en colère. J’aime aus-
LES GARÇONS
EN CRAMPONS
INTERVIEW AVEC THOMAS BELLINCK ET JEROEN VANDER VEN DE STEIGEISEN
– ANNA LuytEN
FoBBiT © kristien Verhoeyen
billY, sallY,
jerrY…
p. 03
De on-
kreukelbare
p. 20
1
/
1
100%