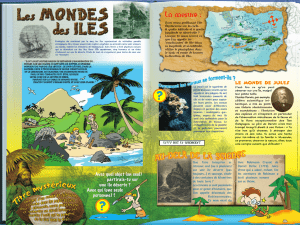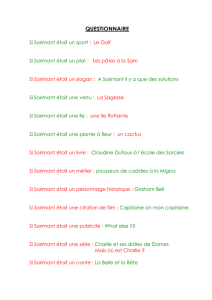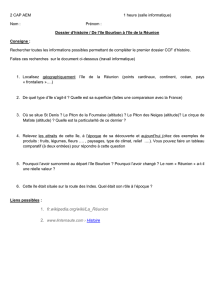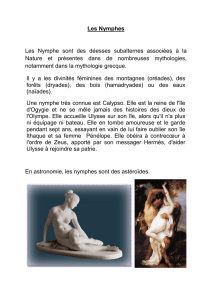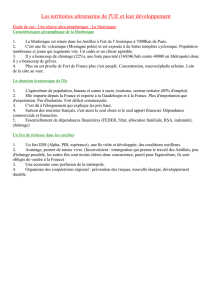sample - City Heights Initiative


GILLES DELEUZE
L’ÎLE DÉSERTE
Textes et entretiens 1953-1974
édition préparée par David Lapoujade
LES ÉDITIONS DE MINUIT

Table des matières
PRÉSENTATION
1 - CAUSES ET RAISONS DES ÎLES DÉSERTES
2 - JEAN HYPPOLITE, LOGIQUE ET EXISTENCE
3 - INSTINCTS ET INSTITUTIONS
4 - BERGSON, 1859-1941
5 - LA CONCEPTION DE LA DIFFÉRENCE CHEZ BERGSON
6 - JEAN-JACQUES ROUSSEAU PRÉCURSEUR DE KAFKA, DE CÉLINE ET DE PONGE
7 - L’IDÉE DE GENÈSE DANS L’ESTHÉTIQUE DE KANT
8 - RAYMOND ROUSSEL OU L’HORREUR DU VIDE
9 - EN CRÉANT LA PATAPHYSIQUE JARRY A OUVERT LA VOIE A LA PHÉNOMÉNOLOGIE
10 - « IL A ÉTÉ MON MAÎTRE »
11 - PHILOSOPHIE DE LA SÉRIE NOIRE
12 - GILBERT SIMONDON, L’INDIVIDU ET SA GENÈSE PHYSICO-BIOLOGIQUE
13 - L’HOMME, UNE EXISTENCE DOUTEUSE
14 - LA MÉTHODE DE DRAMATISATION
Discussion
15 - CONCLUSIONS SUR LA VOLONTÉ DE PUISSANCE ET L’ÉTERNEL RETOUR
16 - L’ÉCLAT DE RIRE DE NIETZSCHE
17 - MYSTIQUE ET MASOCHISME
18 - SUR NIETZSCHE ET L’IMAGE DE LA PENSÉE
19 - GILLES DELEUZE PARLE DE LA PHILOSOPHIE
20 - SPINOZA ET LA MÉTHODE GÉNÉRALE DE M. GUEROULT
21 - FAILLE ET FEUX LOCAUX
22 - HUME
Signification de l’empirisme

La nature de la relation
La nature humaine
La fiction
L’imagination
Les passions
Une philosophie populaire et scientifique
23 - A QUOI RECONNAIT-ON LE STRUCTURALISME ?
Premier critère : le symbolique
Deuxième critère : local ou de position
Troisième critère : le différentiel et le singulier
Quatrième critère : le différenciant, la différenciation
Cinquième critère : sériel
Sixième critère : la case vide
Derniers critères : du sujet à la pratique
24 - TROIS PROBLÈMES DE GROUPE
25 - « CE QUE LES PRISONNIERS ATTENDENT DE NOUS... »
26 - LES INTELLECTUELS ET LE POUVOIR
27 - APPRÉCIATION
28 - DELEUZE ET GUATTARI S’EXPLIQUENT...
29 - HÉLÈNE CIXOUS OU L’ÉCRITURE STROBOSCOPIQUE
30 - CAPITALISME ET SCHIZOPHRÉNIE
31 - « QU’EST-CE QUE C’EST, TES “MACHINES DÉSIRANTES” À TOI ? »
32 - SUR LES LETTRES DE H. M.
33 - LE FROID ET LE CHAUD
34 - PENSÉE NOMADE
Discussion
35 - SUR LE CAPITALISME ET LE DÉSIR
36 - CINQ PROPOSITIONS SUR LA PSYCHANALYSE
Discussion
37 - FACES ET SURFACES
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%