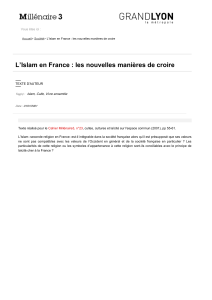« Le cadre de la laïcité à la française. Présentation et discussion du

Pôle de Recherche 1
Assistante : Chrystel CONOGAN chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95
« Le cadre de la laïcité à la française. Présentation et discussion du
programme de travail»
Mots clefs : Islam en France, laïcité, intégration, compréhension, loi de 1905
Ce séminaire de recherche vise à mener une réflexion sur les voies et moyens de l’insertion la plus
sereine possible de l’Islam en France. Prenant en compte les particularismes culturels et les difficultés de
compréhension dans la société française (notamment sur le terrain de la laïcité), ce séminaire s’interrogera
sur la question de savoir si l’islam en France doit et peut-être un « islam de France ».
Cette première séance a permis, au moyen d’un tour de table, de mener une première réflexion sur le thème
et s’est terminée par un rappel de la situation historique de la laïcité française.
I- Echanges sur le thème « Islam de France, Islam en France ? »
a. Un sujet « maltraité » par l’actualité sur lequel il convient de porter un regard objectif et sans préjugés
Nécessité d’étudier ce sujet dont l’actualité nous montre chaque jour la pertinence. Il y a bien un islam en
France, faut- il qu’il soit un islam de France ? La question est posée notamment car l’islam en France se trouve
confronté aux caractéristiques propres de la culture française dont celle de la laïcité ?
Importance de travailler à une meilleure connaissance de l’islam dans sa diversité religieuse et culturelle dans
un esprit recherche du vivre ensemble dans la société française. Pour éviter tout clivage a priori, il est en effet
nécessaire de partir d’une perception ouverte, à partir d’un état des lieux objectif et en faisant intervenir des
responsables de la religion musulmane de différentes sensibilités. En revanche, l’idée de faire participer
différents courants de l’islam au groupe a été abandonnée parce que d’une réalisation trop complexe.
b. Face aux incompréhensions, un besoin d’approfondissement de la connaissance
Nécessité d’analyser une situation de défiance en France vis-à-vis de l’islam et des musulmans accentuée par
les amalgames, immigration et islam, intégrisme et islam, terrorisme et intégrisme musulman.
Département SLP
Séminaire 2013-2014
« Islam en France, Islam de France »
Séance du 19 Novembre 2013
Intervenant : Alain Christnacht
Compte-rendu : Véronique de Waru

Pôle de Recherche 2
Assistante : Chrystel CONOGAN chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95
Reconnaissance de l’islam en tant que réalité religieuse et sociale dynamique et nécessité d’offrir en France
une formation aux religions et à la laïcité, aux cadres et fonctionnaires, d’autant que de plus en plus
d’entreprises comme de services publics sont confrontés à la présence de l’islam dans leur espace social.
Une étude à travers différents prismes :
- Le prisme culturel : une compréhension de l’islam par ses différentes origines : marocaine, algérienne,
noire africaine ou encore asiatique
- Le prisme sociologique : une compréhension de l’Islam par l’étude de l’évolution générationnelle, des
particularismes des « quartiers », par la prise en compte de l’exclusion dont les fidèles de cette
religion peuvent s’estimer victimes.
- Le prisme juridique : une compréhension de l’Islam et de son acculturation française par une réflexion
sur les droits et devoirs, dans le cadre de la laïcité à la française.
II- Mise en perspective de la laïcité française :
a. Rappel historique de la laïcité française
C’est avec la Révolution française que les relations entre les religions, principalement catholique, et l’Etat se
sont profondément modifiées. Le catholicisme était auparavant la religion d’Etat et des Français, le clergé
catholique étant un des trois ordres de l’Etat, le culte réformé et le judaïsme étant quant à eux acceptés sous
des statuts précaires. La Révolution française n’était pas au départ en faveur d’une séparation de l’Eglise et de
l’Etat puisqu’elle avait pour projet de créer une église nationale. Ce projet a profondément divisé l’Eglise en
France. En introduisant un clivage entre prêtres constitutionnels et prêtres réfractaires la Révolution a conduit
à un mouvement anticlérical sinon antireligieux.
Napoléon réintroduit une forme de paix religieuse en signant le Concordat et des décrets avec les
catholiques, les protestants et les israélites donnant ainsi certaines prérogatives dans l’Etat aux religions tout
en les contrôlant.
La loi de 1901 qui a permis de reconnaitre la liberté d’association en a exclu les congrégations religieuses qui
restent soumises à autorisation – signe de méfiance. Cette loi de 1901 est très marquante car ni la Révolution
ni Napoléon 1er n’avaient reconnu la liberté d’association et il est significatif que les congrégations religieuses
aient été exclues de cette liberté nouvelle.
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat a renversé les principes antérieurs en
reconnaissant la liberté de religion mais en posant le principe de la laïcité de l’Etat, séparé de la religion. Elle
édicte également le principe du non-subventionnement des cultes sauf pour l’entretien des lieux de cultes
édifiés avant 1905, puisqu’ils deviennent propriété des communes (églises) ou de l’Etat (cathédrales).
Il est à noter que la grande mosquée de Paris a été construite après guerre sur des deniers publics en
application d’une loi de finances, dérogeant ainsi à la loi de 1905, et en remerciement des sacrifices
musulmans pendant la guerre.
b. Situation actuelle de la laïcité française
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat n’est pas remise en cause, l’Eglise catholique considérant
notamment qu’elle maintient des équilibres précieux qu’il serait périlleux de remettre en cause.
- Les églises et leurs représentations face à l’Etat
Les Eglises étant des forces sociales, la nécessité de rétablir des instances de dialogue et de rencontre s’est
très vite fait ressentir, avec l’Eglise catholique par le rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint
Siège en 1924 et la présence de religieux dans les instances consultatives, plus récemment avec l’instance de
dialogue mise en place en février 2001 entre l’Eglise en France et le Gouvernement, mais tout autant avec les

Pôle de Recherche 3
Assistante : Chrystel CONOGAN chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95
protestants (Fédération protestante de France et le judaïsme (Crif et consistoire). Etant donnée l’absence de
clergé dans l’Islam, les gouvernements, à la recherche d’interlocuteurs, ont poussé à la création du Conseil
français du culte musulman (CFCM). Cette instance a pour ambition de représenter les différents courants de
l’islam en France, sur la base d’une élection par les fidèles, en vue d’être l’interlocuteur des pouvoirs publics.
- Une difficile compatibilité de la laïcité avec l’Islam, cristallisée sur les signes extérieurs d’appartenance
religieuse
Aujourd’hui, la séparation issue de la loi de 1905, qui tend à limiter l’expression religieuse dans la sphère
publique, entraine des difficultés de perception dans l’opinion avec l’Islam, religion où les signes extérieurs
sont assez présents. L’état de l’opinion sur la question du voile à l’école a conduit le législateur à poser le
principe, dans la loi du 15 mars 2004, de l’interdiction du port de tenues manifestant ostensiblement une
appartenance religieuse, dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire publics. La
polémique sur la « burka » a conduit à adopter la loi 11 octobre 2010, qui interdit la dissimulation du visage
dans l’espace public, sans se référer à un signe religieux mais en visant implicitement certaines tenues
islamiques féminines.
Alors que le but initial de ces lois a été d’apaiser les tensions existantes, on ne peut que constater
qu’elles n’ont pas atténué sensiblement la méfiance d’une partie de l’opinion.
Les six séances déjà prévues jusqu’en juin prochain permettront de faire l’état des lieux objectif de la situation
de la religion musulmane en France. Il conviendra de poursuivre, l’année suivante, les travaux de recherche
au sein de ce séminaire avec l’objectif d’aboutir à un colloque conclusif et à des recommandations. Ce
séminaire conservera son caractère de lieu de recherche et ne pourra pas, en dehors de ce ou ces colloques,
être ouvert au public.
1
/
3
100%