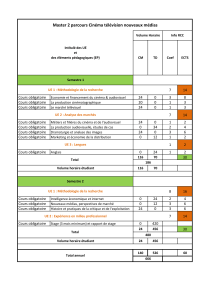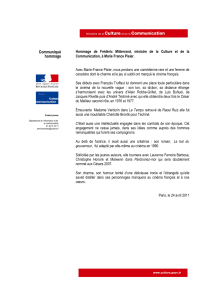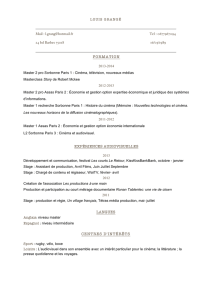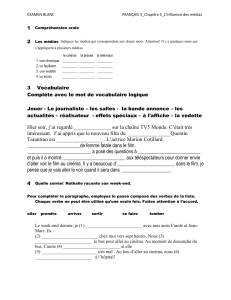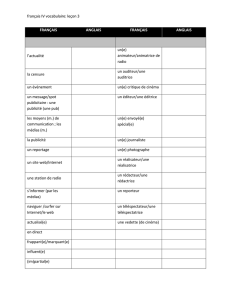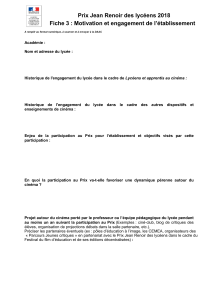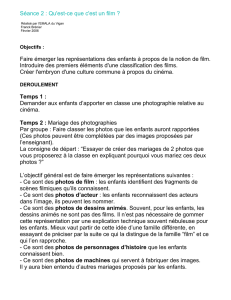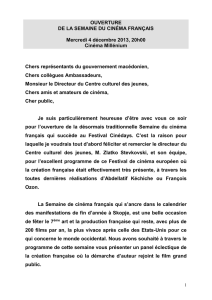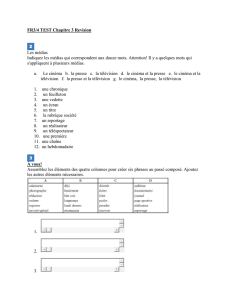Sauvegarder

critikat.com - le site de critique de films
le site de critique de films
http://www.critikat.com
Michel Foucault va au cinéma
Author : Pierre Eugène
Date : 17 mai 2011
Patrice Maniglier et Dork Zabunyan proposent sous la forme de deux longs articles
regroupés en livre, et accompagnés d’une sélection de textes de Michel Foucault, une
passionnante étude ouverte, rencontre politique entre le philosophe et le cinéma. Un
ouvrage aux multiples intérêts, animé de superbes mouvements de pensée.
Le cinéma, en même temps qu’art impur, se retrouve peut-être aussi, comme le disait Godard,
entre le télescope et le microscope : un instrument scientifique destiné à l’échelle humaine. Ces
deux raisons pourraient expliquer l’engouement singulier des dites « sciences-humaines » à aller-y-
voir du côté du cinéma, d’autant plus qu’il semble a priori l’art le moins effrayant. C’est
cette qualité (aux deux sens du terme) démocratique qui, dissipant les mirages de la légitimité ou
l’illégitimité à parler de lui, ouvre le cinéma à tout type de pensée. Cette chance de pouvoir
appréhender le cinéma d’une multitude de manières est aussi une chance pour le cinéma lui-
même : le penser autrement est un relais pour le faire autrement.
Patrice Maniglier avait déjà participé au remarquable ouvrage sur Matrix (Matrix, machine
philosophique [1]) qui entendait penser conjointement le cinéma et la philosophie, ouvrant la
pensée de l’un et de l’autre. Chose rare, la philosophie n’y venait pas cueillir Matrix pour l’élever
vers des cieux prétendument plus nobles ou plus riches ; au contraire : cette tentative
(expérimentale) n’appelait ni illustration, ni ironie, ni même cette bonne intention de réhabilitation
qui a si souvent les accents du surplomb, voire d’une haine mal dissimulée pour un cinéma qui ne
serait pas « grand public ». Matrix, machine philosophique nous proposait joyeusement (laissant
toute prétention au placard) de penser avec Matrix, de nous guider pour apprécier au mieux les
sensations toutes enivrantes de vivre des émotions philosophiques en même temps que
cinéphiliques.
Si Matrix, machine philosophique nous permettait de ressentir effectivement l’intelligence et la
créativité d’un film, Foucault va au cinéma se propose d’étudier les rapports cinéma-histoire, tels
qu’ils ont pu se poser conjointement pour Michel Foucault tout au long de son œuvre, et dans les
années 1970 pour des critiques (Pascal Bonitzer, Serge Daney, Serge Toubiana) et des cinéastes
(René Allio et Alain Resnais). Ces rapports cinéma-histoire sont sous-tendus par la politique, ou
plutôt une politique qui est celle de la représentation.
Après une introduction très claire sur leur sujet, leur position (« une pensée en acte » voulant
chercher à « penser autrement », tout comme Foucault, dont l’expression est sienne, entendait
trouver une nouvelle manière de faire de l’histoire), et leur projet (confronter les pratiques
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

philosophiques et cinématographiques de et pour réfléchir l’histoire), les auteurs l’abordent
chacun sous des angles de départ différent qui finissent par se rejoindre dans leurs lignes de fuite :
les possibles d’un film pour Dork Zabunyan, le concept d’événement, pour Patrice Maniglier.
Que peut un film ?
C’est par cette question, parallèle à celle d’un Spinoza relu par Deleuze, que Dork Zabunyan
ouvre son article. L’auteur commence par analyser l’impact de la pensée foucaldienne sur
les Cahiers du Cinéma du milieu des années 1970, en pleine vague militante [2], et du fameux
entretien « Anti-Rétro » (CC n°251-252 juillet-août 1974) mené par Pascal Bonitzer, Serge Daney
et Serge Toubiana contre une vague de film « rétros », transformant le passé en fresque
décorative. Patrice Maniglier (voir plus bas) parachève une analyse du film de René Allio (Moi,
Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…|critique du film Moi, Pierre Rivière,
ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…) entamée ici. Mais Zabunyan s’intéresse plus ici à
ce qui retenait l’attention de Foucault dans le cinéma, à savoir, une esthétique de la pauvreté, une
absence de décorum ou d’effets. Les effets ne pouvant que réduire l’impact politique ou détourner
l’attention des enjeux de la représentation. « S’il existe une spécificité positive du cinéma chez
Foucault, […] il s’agit de concevoir un art cinématographique délesté de toute approche
esthétisante [3]: (« rétro » ou pas) […] un art où une forme d’ascèse visuelle et sonore entraine une
plongée dans les méandres arides de l’archive, la dureté de notre rapport au pouvoir ou l’inconnu
mouvant des corps. » (p.32) Zabunyan analyse le rapport distancié du philosophe au cinéma par la
distance que l’archiviste peut prendre par rapport à des fait trop récents, où la durée écoulée reste
trop proche et trop ambiguë.
Une « affair » légitime
Foucault, bien que cinéphile, n’a jamais écrit de livre sur le cinéma, et ne s’est jamais reconnu lui-
même comme habilité à parler d’esthétique cinématographique. Ses interventions se retrouvent
dispersées dans une poignée d’articles et d’entretiens, qui ont justement à voir, dans leur
catégorie de discours, avec une actualité et des luttes concrètes. Comme le dit joliment Patrice
Maniglier, « on imagine mal les métaphysiciens en toge manifester avec le Groupe Information
Prison. On imagine mal le penseur spéculatif dire avec Foucault qu’il ne faut pas hésiter à faire le
coup de poing avec la police, car les flics sont faits pour ça, exercer la violence physique. »
L’archiviste et le « militant » peuvent cohabiter (j’ajouterai « doivent »), mais, peut-être, justement
pas dans le même temps. Malgré cette protestation d’illégitimité, il se peut bien qu’entre Foucault
et le cinéma ait eu lieu quelque chose comme une « affair » (pour jouer sur les mots), échange
réciproque sous la forme d’un questionnement.
Tout d’abord, et c’est la première partie de l’intervention de Patrice Maniglier (qui s’additionne
aux réflexions de Dork Zabunyan), Foucault voit dans le cinéma une possibilité inédite de montrer
une histoire « moléculaire. » Foucault élabore une conception radicalement nouvelle de l’histoire,
conception politique que l’on pourrait déjà résumer par cette phrase du philosophe : « Quelqu’un
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

prend la parole ne l’ayant pas » ; soit : une personne (tel Pierre Rivière, et tels ses « hommes
infâmes » dont Foucault voulait faire l’histoire) illégitime [4] prend en charge sa propre histoire
singulière, s’opposant à des forces légitimes (police, médecins, avocats etc.). À l’histoire officielle,
héroïque, d’une entité quelconque (Grand homme, Nation, Classe) Foucault oppose une mémoire
populaire, un « processus sans sujet » (comme la définissait Althusser). Le populaire, ce ne sont
pas les paysans ou les ouvriers, ce ne sont pas des classes, ce sont « des traitres : ils sont dans
l’histoire, mais comme un virus. Ils hantent notre histoire, mais notre histoire n’est pas la leur. »
(p.63) Cette mémoire minoritaire est toujours au présent, même si vieille de plusieurs siècles, car
elle tient précisément de l’événement (longuement et fort bien expliqué par Maniglier par la suite).
Disjonctions
La mémoire populaire est une histoire qui n’intégrerait pas un point de vue surplombant (supra-
historique), mais où l’événement, pour dire rapidement ce qui apparaît dans l’écart creusé par la
mutation et la rencontre de plusieurs forces historiques, épistémologiques, pourrait justement faire
jour à travers les possibilités de disjonctions du médium cinématographique : entre la parole, le son
et l’image, entre les plans – effet Koulechov. C’est en ce sens que le film de René Allio, Moi, Pierre
Rivière…|critique du film Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…
(analysé brillamment par Maniglier), adaptation à la lettre du texte original qu’avait découvert
Foucault, jouant des disjonctions de la parole pour montrer tout un ensemble de forces discursives
qui coexistent et s’affrontent, peut être opposé par les critiques des Cahiers du Cinéma à la mode
rétro (dans laquelle s’inscrivent Portier de nuit|critique du film Portier de nuit [5] et Lacombe Lucien
[6], et à la fin des années 1980 mais tout pareillement, Uranus de Claude Berri contre lequel Daney
s’élèvera).
Maniglier entre alors plus profondément dans les concepts d’événement, de série (dans une
lecture peut-être plus deleuzienne de Foucault), pour aboutir en fin d’article à un ensemble de
propositions théoriques et d’analyse filmiques éblouissantes, qui tiennent presque à de la grâce :
des visions, manières de concevoir et de parler des films, d’une très grande force, à la fois
stylistique et théorique. Citons par exemple cette assertion de toute beauté: « Non pas un train qui
entre en gare, mais la gare telle qu’elle s’actualise dans un morceau de train. » (p.87) ou celle-ci :
« Ainsi, le cinéma nous montrerait non pas des mains qui se crispent, mais des crispations qui
surgissent au milieu d’autres forces, non pas des yeux qui fixent quelque chose, mais des regards
qui s’emparent d’un visage, non pas des serpes qui coupent des gorges, mais des égorgements
qui traversent le temps… » (p.102) Ces pages étonnantes, et je ne peux pas résister à la tentation
de le citer, me font penser à cette intervention de Deleuze dans un de ses cours sur le visage au
cinéma :
« Ce que fait un visage est deux choses : un visage ressent, un visage pense-à. […] Le mari rentre
chez lui, le soir, épuisé d’un long travail. Il ouvre la porte, il traîne des pieds, sa femme le regarde.
Et il lui dit, hargneux : à quoi tu penses ? Et elle lui répond : Qu’est ce que t’as ? — “à quoi tu
penses” ? c’est-à-dire : quelle qualité émane de ton visage ? Et l’autre répond “qu’est-ce qui te
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

prend ?”, quelle est cette étrange série intensive que tu parcours en montant et en descendant. »
Cette superbe faculté d’invention, de montrer et de penser en même temps, de concilier les deux
en une seule phrase, discrédite par le style toute tentative de surplomb de la philosophie sur le
cinéma : il y a là aussi une véritable rencontre, quelque chose d’assez merveilleux qui se produit,
et qui est en parallèle direct avec les quelques tentatives de Foucault de penser le cinéma comme
un moyen d’expérience. Et les citations d’Epstein, lui même théoricien et praticien du cinéma, sont
dans la même lignée (ou devrais-je dire « série »).
Car les deux auteurs insistent sur les rapport du corps reconfiguré au cinéma et du cinéma lui-
même comme grand corps moléculaire : la manière dont Foucault voit dans les films de Werner
Schroeter un « bourgeonnement du corps », ou chez Duras « un brouillard sans forme » (voir à ce
sujet la deuxième moitié de l’article de Zabunyan, ainsi que ses analyses de la représentation du
pouvoir). Or c’est dans l’exercice de ces facultés dispersives que peut s’élaborer à la fois un
cinéma de l’histoire selon Foucault, mais aussi une manière d’appréhender le cinéma inédite, en
puissance.
Car (et c’est précisément la dernière partie de l’article de Maniglier) c’est grâce à cette faculté
d’appréhension, ce mode de vision que le cinéma de la mémoire peut renouer avec le présent. Si
les livres de Foucault s’intéressaient à des époques très éloignées de nous, ses articles et
entretiens étaient très liés à l’actualité, or le cinéma actualise la mémoire (et c’est la théorie de
Maniglier) en s’interrogeant perpétuellement sur ses propres images. L’écran comme cache
(selon Bazin) offre à l’image son dehors, toute image cinématographique est incomplète. Par une
analyse incroyable et de l’incroyable dans Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, Maniglier décrit les
puissances de l’image et la représentation de devenirs, qui s’ébauchent entre les disjonctions
(temporelles, spatiales, esthétiques) réalisées par le film. On voit bien ce que ces analyses offrent
aussi au discours sur le cinéma, sa manière d’en parler, de le décrire, facultés à la fois concrètes
et imaginatives.
En conclusion, Maniglier détaille un autre nombre de films qu’il serait intéressant d’étudier,
précisant que ce livre n’est qu’un exemple possible de ce que les confrontations de Foucault et
du cinéma peuvent apporter. Patrice Maniglier, dans un bel élan de modestie (« je ne suis ni
historien ni cinéaste ni critique de cinéma », p.53 – timidité d’une illégitimité, encore ?), se défend
de proposer des modèles pratiques pour le cinéma. Mais s’il ne le fait pas directement, il le
fait effectivement dans ses modes d’approche des films, et de ce qu’il nous en passe, via
l’écriture.
Il serait impossible et idiot de répéter à la lettre, sauf à devenir une sorte de Pierre Ménard, tout ce
que ces deux textes contiennent de passionnant, et surtout d’ouvert, comme possibilité d’études.
Ce qui touche particulièrement, et ce qui sous-tend l’entreprise, c’est cette volonté de devenir, ce
désir de nouveau, tenant du savant-fou ou de la sorcière, qui s’ébauche à la fois dans le désir de
voir « autre chose », et de le dire autrement, conjointement dans les deux disciplines. Voici
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

pourquoi la (fausse) liste de départ que les auteurs avaient dressé en introduction (les quatre effets
voulu par ce livre: sur les critiques, les théoriciens, les cinéastes, et la philosophie elle-même) ne
pouvait qu’être dispersée, décomposée en autant de points singuliers, non unifiables. Contre
l’unification, les universaux : le multiple, l’Ouvert. Les auteurs nous passent la main : à nous de
prendre un relai, d’eux, de Foucault ou d’autres, pour faire jouer le cinéma avec d’autres savoirs,
jouer au petit chimiste ou au magicien, faire précipiter le médium.
Pierre Eugène
Notes
1. [1] Matrix machine philosophique, textes d’Alain Badiou, Thomas Benatouil, Elie During,
Patrice Maniglier, David Rabouin, Jean-Pierre Zarader, éd. Ellipse, 2003.
2. [2] Militance qui commence à peine à se dégager du maoïsme.
3. [3] Il est à noter que Serge Daney, tout au long de son activité critique, ne cesse de
critiquer ou se dire indifférent aux « belles images », dont il tirera par la fréquentation de la
télévision l’équivalent de « visuel » (veulerie des images « prostituées »).
4. [4] Et c’est là qu’à mon sens, même si les auteurs n’utilisent pas cet adjectif, il est d’une
grande utilité pour comprendre l’enjeu politique qui anime à ce moment là le cinéma
militant.
5. [5] Liliana Cavani, 1974.
6. [6] Louis Malle, 1974.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© 2017 critikat.com - tous droits réservés
1
/
5
100%