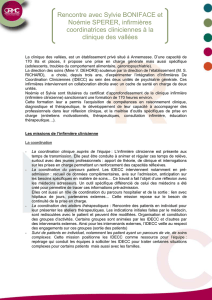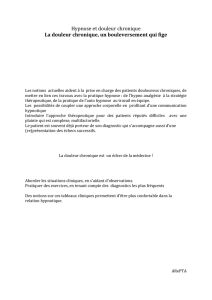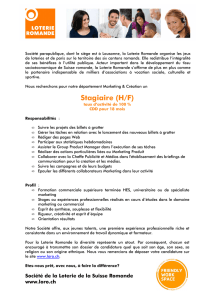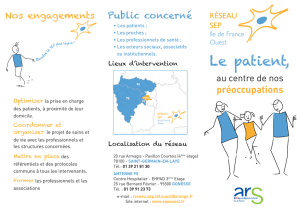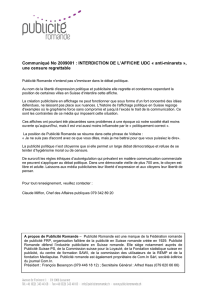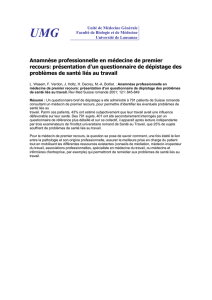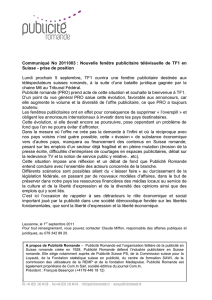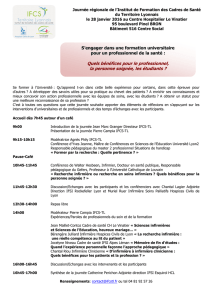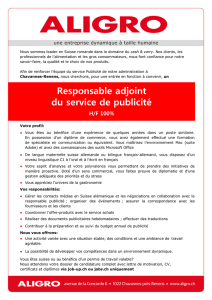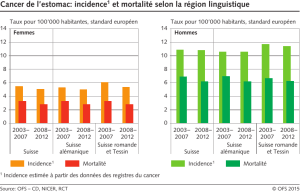Cap sur la promotion de la santé

66
Introduisant son discours par la citation
de Copernic «On ne peut pas apprendre
aux adultes, mais leur révéler ce qu’ils
savent déjà», Bernard Carrel, consultant
RH, met en évidence le processus de
doute et de questionnement nécessaire
pour faireévoluer l’individu et la rela-
tion dans une communication construc-
tive.
Promouvoir la santé
des soignants
Dans le cadre de la gestion des res-
sources humaines, Bernard Carrel dé-
montre l’intérêt de développer le capital
humain. En termes d’«épidémie des
risques psychosociaux», dans un con-
texte où l’individualisme règne,il a mis
en évidence tant les mécanismes pou-
Journée romande des cliniciennes
Cap sur la promotion de la santé
recherchée en termes de capital humain
à renforcer: créer un espace de parole
bienveillant permettant d’accueillir l’er-
reur et l’apprentissage du processus l’y
amenant, accompagné de démarches
visant à redonner vie et efficacité aux
collectifs de travail.
vant amener un employé à une situation
de vulnérabilité que les solutions d’ac-
compagnement possible.
L’intensification de la charge de travail
et le corporatisme par métier induit une
précarisation des actions collectives et
des collectifs de travail. La prévention se
trouve reportée sur l’individu, victime et
responsable de son état de santé et de
bien-être: il doit ainsi faireface seul aux
problèmes se posant à lui. En stigmati-
sant l’individu comme seul responsable,
la collectivité induit un comportement
néfaste à l’apprentissage: l’individu
cherche alors à cacher son erreur pen-
dant que le groupe le couvre.
La personne vulnérable identifiée com-
me révélatrice d’un problème posé au
sein de l’entreprise, la solution doit être
Dans le cadre de la Journée Romande des Cliniciennes, l’Assemblée Suisse Romande
des Infirmières Cliniciennes (ASRIC) a rassemblé une centaine de soignants autour
de la thématique de la promotion de la santé, mettant en évidence la contribution
indispensable de la discipline infirmièreauprès des usagers.
Texte: Anne Burkhalter, Florie Baumgartner, Olivier Le Dizès, Laure Piccand, Vanessa Viénat / Photos: Fotolia
Anne Burkhalter est responsable de
secteur Clinique et soins chez Espace
Compétences.
Florie Baumgartner, Olivier Le
Ditès, Laure Piccand et Vanessa
Viénat sont étudiants cliniciens à
Espace Compétences.
Contact: anne.burkhalter@espace-
competences.ch
Les auteurs
Profession

6767
nté
Krankenpflege ISoins infirmiers ICure infermieristiche 9/2016
vespéral de J.Savatovski auprès de l’en-
semble du personnel, puis des massages
d’une durée de 5 minutes par patient, au
lit ou sur chaise ont été pratiqués.
Al’issue de l’étude, un changement posi-
tif significatif du comportement des pro-
fessionnels a été relevé: entre autres,
60% d’entre eux pratiquent encore le
massage après l’étude, 80% expriment
un sentiment de bien-être. En effet,
prendre le temps de masser la main de
quelqu’un est ressenti comme apaisant,
permettant de se poser, de respirer calme-
ment, de fermer la boucle des soins de la
journée avec le patient, puis de rentrer à
la maison moins stressé.
Pour les personnes âgées massées régu-
lièrement, si le nombre de chutes n’a pas
diminué, une augmentation significative
de la vitesse de marche a été évaluée par
les physiothérapeutes. Les appels de nuit
et la médication antalgique de réserve
semblent diminuer; cependant, il est en-
coreactuellement difficile de se pronon-
cer dans le cadrede cette étude.
Evaluation ergothérapeutique
S’engager dans le domaine de la promo-
tion de la santé implique une connaissan-
ce précise des ressources de nos clients,
de leurshabitudes et projets de vie.Anne
Lachat, première ergothérapeute clini-
cienne de l’hôpital neu-
châtelois, s’est attelée à
uniformiser et à actua-
liser les pratiques de
l’évaluation ergothéra-
peutique des clients
hospitalisés pour un
accident vasculaire cé-
rébral. Pour cela, elle
s’est basée sur une soli-
de revue de littérature
dans son domaine, offrant aux clients, à
ses collègues et à son institution une réel-
le plus-value.
Au-delà de l’aspect de l’évaluation, l’in-
térêt de cette démarche réside dans l’ac-
cent mis sur l’évaluation des capacités
de la personne dans une visée de déve-
loppement de ses compétences dans son
environnement et en adéquation avec sa
participation à la société. En effet, trop
souvent, les soignants restent centrés sur
les déficits, y palliant en prenant en char-
ge l’incapacité de leur patient; le paradig-
me présenté par A. Lachat relève de
l’accompagnement du client, acteur in-
contournable participant activement à la
reconstruction de ses compétences, sur la
base de ses ressources et ses objectifs
d’action au quotidien. Ceci constitue le
cœur même de la profession d’ergothéra-
peute, précisément centrée sur le déve-
loppement et le maintien de la capacité
d’agir des personnes.
Les concepts centraux de l’ergothérapie
reposent sur la personne, son environne-
ment, ses activités et ses occupations. Ar-
ticulés les uns avec les autres, ils permet-
tent de définir le profil occupationnel du
client. Celui-ci, conjugué avec l’observa-
tion des performances occupationnelles,
permet de le situer dans son contexte et
son projet de vie. L’évaluation ergothéra-
peutique a été construite sur la base de
la CIF (Classification Internationale du
Fonctionnement, du Handicap et de la
Santé) faisant correspondre sa cotation à
celle de la MIF (Mesure d’Indépendance
Fonctionnelle) pour les activités quoti-
diennes. Les résultats de l’évaluation
ergothérapeutique permettent de cibler
la problématique et définir des objectifs
de traitement ergothérapeutique avec le
client; la finalité visée est de favoriser la
reprise de ses occupations au quotidien
et de faciliter ainsi sa participation à la
société. Ausein de l’équipe interdiscipli-
naire,ces résultats permettent aussi de
coordonner et de potentialiser les inter-
ventions dans le but de construire un pro-
jet de soins en adéquation avec le projet
de vie du client. Sa finalité thérapeutique
vise l’impact sur la participation de l’in-
dividu et l’amélioration de sa santé et de
sa qualité de la vie.
L’accueil, un acte pas banal?
Corinne Wirth, infirmièrecheffe d’unité
adjointe & clinicienne à l’hôpital neuchâ-
telois s’est interrogée sur la difficulté
d’adaptation du patient dans son service
de CTR – Centrede Traitement et de Ré-
adaptation, relevant la pratique routiniè-
re et banalisée de l’accueil, sans véritable
prise en compte des besoins du patient.
Une revue de littératurelui a permis de
définir son projet. Les enjeux de l’accueil
www.sbk-asi.ch >Infirmières cliniciennes >Promotion de la santé >Alternatives
Le partenariat stratégique,dynamique et
stimulant, basé sur des valeurs telles que
la confiance et le respect, la posture per-
sonnelle forte ainsi qu’un positionne-
ment clair sont montrées comme contri-
bution à la bonne santé au travail.
Massage vespéral en gériatrie
Après cette entrée en matièreportant sur
la santé des professionnels, Geneviève
Delèze,infirmièrecheffe, spécialiste cli-
nique, présente une démarche clinique
auprès des personnes âgées hospitalisées
souffrant d’isolement; elle pointe l’ab-
sence de contact physique en dehors des
soins techniques. En 2012, cette problé-
matique l’a conduite à mener une étude
interventionnelle contrôlée avec le Dr
Coutaz sur l’influence du toucher vespé-
ral dans les soins à la personne âgée.
S’appuyant sur une revue de littérature
en lien avec le toucher – massage, dans
une approche interdisciplinaire, intégrant
les infirmières, les médecins et les phy-
siothérapeutes, elle a cherché à évaluer
l’impact du toucher, entre autres, sur la
prise médicamenteuse, le sommeil, les
appels et la marche.
Une formation courte a été mise en place
selon le modèle du toucher – massage
Achacun, profes-
sionnel de la santé
ou patient, de
prendre soin de a
santé, à sa façon.
«L’intensification de la charge de
travail et le corporatisme par métier
induisent une précarisation des
collectifs de ravail.»

ont été identifiés, visant à sécuriser le pa-
tient, à promouvoir son individualité et à
renforcer son espoir de soulagement et de
guérison.
Les données probantes amènent encore
d’autres éléments, dont la notion de plus
grande vulnérabilité de la personne hos-
pitalisée durant les 72 premières heures
d’où la nécessité d’anticiper l’accueil en
mobilisant les ressources des proches
dans cette étape de crise.Les concepts
théoriques de bien-être subjectif, de co-
ping et d’autorégulation du comporte-
ment viennent renforcer le projet d’ac-
cueil; des outils simples, tels que créer
autour de la personne un environnement
aussi familier que possible devient une
évidence!
Valorisation de l’interdisciplinarité
L’objectif de cette démarche est défini:
favoriser l’adaptation du patient en CTR
grâce à un accueil anticipé. Les 3 axes
stratégiques ont porté sur la préparation
du projet, sa mise en place et son main-
tien au sein du service: les soignants ont
été formés en laissant émerger les repré-
sentations en termes d’accueil et en s’im-
pliquant dans des jeux de rôles,puis ils
ont été accompagnés dans la démarche
d’implantation. Parallèlement, une orga-
nisation en binôme aide-soignante – in-
firmière est instaurée, un itinéraire cli-
nique décrivant le processus d’accueil
guide la démarche,une brochured’ac-
cueil est diffusée.
Cette démarche a rendu visible à la fois le
rôle de la clinicienne auprès des usagers
et de ses proches,comme auprès des col-
laborateurs. Elle a aussi permis de valori-
ser et de développer le travail interdisci-
plinaire. La transférabilité de la démarche
du CTR au service de gériatrie aiguë est
devenue incontournable.
L’hypnose auprès
du patient brûlé
Infirmière clinicienne au CHUV, Maryse
Davadant a clos cette journée de confé-
rences en présentant l’impact de l’hypno-
se dans les soins aux grands brûlés. Par-
tant de la persistance des douleurs sé-
vères, malgré les opiacés, engendrant
anxiété, dépression et douleurschro-
niques,elle offreaux grands brûlés la
possibilité de modifier leur état de
conscience et leurs symptômes grâce à
l’hypnose. Sans en avoir conscience,
nous connaissons tous des états de tran-
se naturelle se traduisant par exemple par
être dans la lune, très concentré, captivé
ou au volant de notre voiture perdant la
notion de temps. Ces moments nous per-
mettent de nous ressourcer. La transe
hypnotique, par exemple, se définit par
une expérience subjective, un état d’hy-
perconscience. Elle se manifeste clinique-
ment par une baisse de la fréquence res-
piratoire, une relaxation des muscles
du visage, une accélération des mouve-
ments oculaires, une déglutition plus
lente et plus importante.
Impact sur la douleur
Lors d’une séance d’hypnose, l’attention
est focalisée sur des images de vécu posi-
tif du patient/lieu de sécurité propre à
chaque patient, l’amenant à diminuer sa
vigilance périphérique; il est alors en état
de veille et d’alerte et non de sommeil:
son activité cérébrale est modifiée.
Si les séances d’hypnose ont un impact
direct sur la douleur et les soins, elles
agissent aussi sur l’humeur du patient et
sur son anxiété, diminuant le risque de
dépression et de douleurschroniques.
Peu à peu, au fildes séances,les patients
sont capables de pratiquer l’auto-hypno-
se: devenant acteurs de leur processus de
guérison, ils s’approprient une partie de
leurstraitements et sauront utiliser l’au-
to-hypnose dans d’autres situations diffi-
ciles.
Une étude réalisée en 2006–2007 sur
deux groupes,cas – témoins chez les
grands brûlés a montré une meilleure
analgésie avec réduction de la sensation
de douleur (utilisation de l’échelle EVA –
Échelle Visuelle Analogique,diminution
des opiacés, de la sédation, des antal-
giques avant et durant les soins), une
meilleure cicatrisation chez un patient
moins stressé par les soins, une diminu-
tion de la durée de séjour aux soins inten-
sifs de cinq jours représentant une écono-
mie de 19000.–/patient.
Journée romande des cliniciennes – JRC,
10 juin 2016 à Neuchâtel, Hôpital de Pourtalès
sur le thème: La discipline infirmière, une con-
tribution indispensable à la promotion de la
santé.
Les présentations de cette Journée Romande
des Cliniciennes sont disponibles sur le site
de l’ASRIC:
http://www.asric-site.ch/presentations-de-la-
vieme-jrc/
Profession
68 Krankenpflege ISoins infirmiers ICure infermieristiche 9/2015
Douze nouveaux cliniciens
Remise des certificats
Cette Journée Romande des Cliniciens
s’est terminée par la remise des certifi-
cats de cliniciens aux finalistes de la
volée 2014–2016, ayant participé avec
succès à leur formation à Espace Com-
pétences. Neuf d’entre eux ont suivi la
filière de cliniciens généralistes, deux
celle en diabétologie et une en santé
mentale et psychiatrie. Grâce aux com-
pétences acquises, ils ont conduit des
projets amenant à revisiter les bonnes
pratiques dans leur domaine allant des
soins psychiques aux soins intensifs,
de l’ambulatoire et des soins à domici-
le à l’hôpital, favorisant l’avancée des
pratiques soignantes.Experts dans leur
domaine, leaders cliniques au sein de
leur institution, ils ont démontré leur
capacité à intégrer leur rôle en termes
de Pratique Avancée. Les résultats ob-
tenus durant leur démarche de gestion
de projet témoignent non seulement de
l’impact sur la santé des usagers et sur
la satisfaction des collaborateurs, mais
aussi sur la plus-value au niveau de la
collectivité et de l’institution. Ils sont
félicités pour leur empreinte en termes
de développement durable,sur les 3
axes, social, économique et environne-
mental: leurs projets sont viables,
vivables et équitables.Nous leur sou-
haitons plein succès et durabilité!
1
/
3
100%