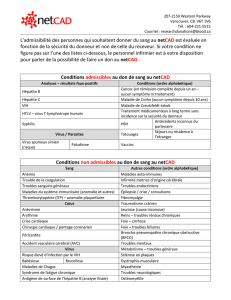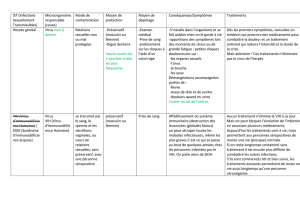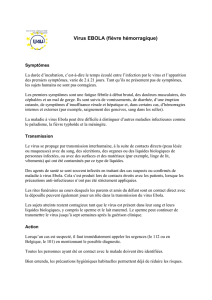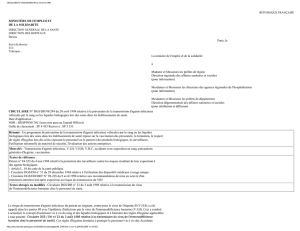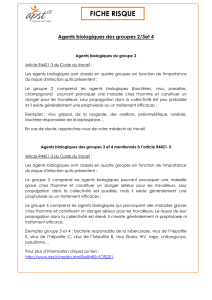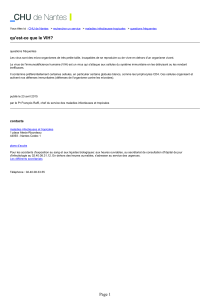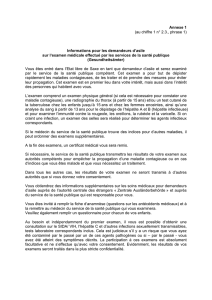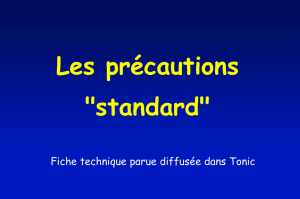Risques de contamination accidentelle par le virus de l

MISE AU POINT Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341
330
Risques de contamination accidentelle par le virus
de l’immuno-déficience humaine (VIH) :
mise au point et conduite à tenir
Sophie CONQUY, Eric CHARTIER, Marc ZERBIB, Nicolas THIOUNN, Thierry FLAM, Bernard DEBRE
Service d’Urologie, Hôpital Cochin, Paris, France
Les professionnels de santé sont parmi les plus exposés
au contact accidentel avec du sang contaminé par le
VIH. Toutefois, pour parler de séro-conversion certai-
ne, il faut que :
1) le soignant ait une sérologie négative, contrôlée au
moment de l'accident,
2) un contact avec du matériel biologique contaminé
provenant d'un sujet VIH positif,
3) et qu'il développe une séropositivité au VIH dans les
6 mois qui suive le contact [7].
En chirurgie, le risque de contamination VIH est en
réalité faible, inférieur à 0,3% [4], car celui-ci est
maximal au stade terminal de la maladie, alors qu'à
cette période, peu d'interventions chirurgicales, sauf
en urgence, sont réalisées. De plus, le port de gants
est systématique et les instruments utilisés (aiguilles
ou objets coupants) sont pleins. Les textes réglemen-
taires sont peu nombreux et peu précis, ce qui
explique les précautions fort différentes prises d'un
établissement à l'autre, mais il est à noter que la situa-
tion est pire pour les virus de l'hépatite où le risque
est 10 fois supérieur.
En France, dans le cadre d'une surveillance nationale
mise en place à partir de 1990, on distingue deux situa-
tions fort différentes : l'infection professionnelle prou-
vée qui est définie par une séro-conversion documen-
tée (sérologie négative se positivant entre 4 semaines
et 6 mois après l'accident chez un personnel de santé
ayant eu une exposition professionnelle à un liquide
contenant du VIH) et l'infection professionnelle présu-
mée qui correspond à la découverte d'une séropositivi-
té VIH chez une personne ayant des antécédents d'ac-
cident avec exposition à du sang dont on ne connait pas
le statut sérologique. Sont exclus de ces données les
sujets ayant à la fois un risque d'exposition profession-
nel et un risque d'exposition privé. Avec ces critères,
un recensement au 31 décembre 1995 a montré en
France 37 cas d'infections, 10 étant des infections
prouvées et 27 des infections présumées. Dans la
majorité des cas, il s'agit de personnels utilisant des
aiguilles creuses. 4 facteurs de risques sont principale-
ment retrouvés :
- la profondeur de la plaie du soignant,
- les traces de sang du patient visibles sur l'aiguille,
- une ponction veineuse ou artérielle (ce qui signifie
que l'aiguille contient du sang non dilué),
- le stade avancé du SIDA du patient.
Bien que ce risque soit modéré, des règles générales
doivent être systématiquement appliquées et pour cela
une information précise doit figurer dans tous les lieux
où les accidents peuvent se produire (salle de soins,
bloc opératoire...) [2]
Manuscrit reçu : mars 1998, accepté : juillet 1998.
Adresse pour correspondance : Dr.S. Conquy, Service d’Urologie, Hôpital Cochin,
27, rue du Faubourg Saint Jacques, 75674 Paris Cedex 14.
RESUME
Bien que la contamination accidentelle par le virus de l'immunodéfience humaine soit
rare en chirurgie, les mesures à prendre en urgence et la prévention sont analysées.
Outre les soins locaux et les déclarations, la place de la chimioprophylaxie disponible
en urgence semble essentielle quand le statut du malade source est inconnu et/ou le
risque élevé.
La prévention repose sur l'information et la réalisation des actes par du personnel
expérimenté.
Mots clés : Chirurgie, SIDA, accident professionnel.

331
Les soins locaux
Ils consistent dans un premier temps à faire saigner la
plaie et à pratiquer une antiseptie de celle-ci pendant au
moins 3 minutes avec un dérivé chloré (Dakin ou eau
de javel à 12° diluée au 1/10 ou au pire alcool à 70°).
Il convient alors de déterminer le statut du malade
source
Ceci ne peut être effectué qu'après avoir demandé au
patient l'autorisation de le prélever, ce qui permettra de
déterminer une sérologie (J0) et simultanément un pré-
lèvement sérologique est effectué pour le soignant.
Parallèlement, des signes pouvant évoquer la séroposi-
tivité seront recherchés chez le patient. En cas de refus
de celui-ci de procéder au prélèvement sérologique, il
sera considéré de principe comme séropositif. Les pré-
lèvements sérologiques réalisés à J0 concernent bien
sûr le VIH 1 et 2 mais également HCV, l'antigène HBS,
l'antigène HBE et l'on effectue également un dosage
d'ARN plasmatique VIH.
Les déclarations
Il est obligatoire de réaliser dans les 24 heures une
déclaration en respectant l'anonymat du malade source.
Cette déclaration, qui est nécessaire pour obtenir une
prise en charge ultérieure, est réalisée sur le cahier d'in-
firmerie, sur un imprimé type (imprimé A572) et
auprès de la médecine du travail.
La chimioprophylaxie
En dehors des cas de blessures minimes (blessures
superficielles avec une aiguille pleine) chez un patient
dont on est sûr que la charge virale est faible, la chi-
mioprophylaxie est recommandée et elle permettrait
une réduction d'environ 79% du risque de séro-
conversion [3]. Cette chimioprophylaxie doit être
débutée dans l'idéal dès la première heure après l'ac-
cident, en tout cas au plus tard dans les 4 premières
heures, ce qui nécessite une possibilité de dispensa-
tion d'urgence des médicaments et donc la présence
d'une quantité suffisante pour débuter le traitement
auprès d'un pharmacien de l'établissement dans lequel
travaille le chirurgien. En l'absence d'une telle possi-
bilité, il est prévu par la réglementation que les
centres hospitaliers de référence doivent prendre en
c h a rge outre leurs personnels, les libéraux et les per-
sonnels d'établissements privés ne disposant pas des
médicaments anti-rétroviraux. Les protocoles de trai-
tement actuellement proposés comportent une bithé-
rapie systématique avec AZT (Retrovir 250 mg matin
et soir) et 3TC (Epivir 150 mg matin et soir), cette
association étant dictée par la bonne synergie des
médicaments et leur excellente tolérance à ces doses.
Il est néanmoins indispensable de prévenir les sujets
de l'incertitude concernant l'efficacité de cette pro-
phylaxie et de ses effets indésirables (8). La grosses-
se reste en particulier une contre-indication relative et
il conviendra d'évaluer le rapport bénéfice/risque au
cas par cas selon la gravité de l'exposition. En cas
d'accidents sévères liés au mode de contamination
(blessure profonde) ou au statut de patient (SIDA
avéré), il est conseillé d'utiliser une trithérapie en
ajoutant aux médicaments précédents une anti-protéa-
se, par exemple l'Indinavir 800 mg, toutes les 8
heures. Il faut également tenir compte des traitements
déjà reçus par le patient qui peuvent induire des résis-
tances potentielles. Ce traitement est poursuivi jus-
qu'à l'obtention des résultats des prélèvements du
patient. Si celui-ci était en réalité séronégatif, le trai-
tement peut être arrêté. Dans le cas contraire, il est
poursuivi 4 semaines.
Le suivi sérologique et clinique
Un médecin référent consulté dans les 48 premières
heures pourra expliciter le suivi nécessaire et notam-
ment concernant la tolérance du traitement et les sérolo-
gies VIH. Habituellement, 3 examens ont lieu : un avant
le 8ème jour, un au 3ème mois et un au 6ème mois. La
mesure de l'ARN plasmatique et les techniques d'identi-
fication virale ne sont pas utilisées en surveillance de
routine mais une consultation à 6 semaines peut être pré-
conisée avec une sérologie complète et une antigénémie
p24. Chez les femmes, une contraception efficace s'im-
pose pendant la durée du traitement et des précautions
doivent être prises pendant 6 mois pour éviter une trans-
mission sexuelle ou sanguine. En cas de séro-conver-
sion, une indemnisation survient dès le stade de séropo-
sitivité asymptomatique [5].
Prévention-conclusions
La prévention de tels accidents passe avant tout par
une formation et une information des personnels
concernant les risques particuliers liés au VIH, mais
également aux autres maladies transmissibles comme
l'hépatite [6]. A cet effet, dès lors que des soins sont
réalisés chez des patients séropositifs ou ayant un fort
risque de l'être, ceux-ci ne doivent être exécutés que
par une équipe expérimentée et jamais par du person-
nel en formation. L'utilisation de matériels à usage
unique est un élément essentiel de la réduction de l'in-
cidence des accidents, de même que le port de masque
et de lunette. Concernant l'utilisation des gants, l'inté-
rêt de la double paire de gants est discutable car s'il
réduit le risque de perforation du gant neuf ou en per-
opératoire, cette technique induit une diminution de
dextérité, or il semble avant tout que la prévention des
accidents repose sur la dextérité et l'expérience des
personnels soignants en modifiant le moins possible
leurs habitudes de travail [1].
S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

REFERENCES
1. ABLETT M.J., HUGHES T., GIBSON C.J. Is routine double-gloving
worthwile during interventional radiologic procedures? A.J.R., 1996,
166, 1335-1336.
2. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 1996, 49, 213-216.
3. BRUCKER G. Note relative à la prévention des risques de transmis-
sion du VIH lors des accidents par exposition au sang pour les per-
sonnels de santé, 7/1996
4. CARDO D.M., CULVER D.H. A case control study of HIV serocon-
version in health care workers after percutaneous exposure. N. Engl..
J. Med., 1997, 337, 1485-1490.
5. Circulaires DSS/AT/95-22 et DH/FH3/95-14 du 3 mars 1995.
6. Décret n°94-352 du 04.05.1994, Journal Officiel du 6 mai 94 pp 6620-
6623.
7. Rapport Dormont juin 1996.
8. Note d'information DGS/DH/DRT n°666 du 28/10/96
Commentaire de J.F.Hermieu, Service d’Urologie, Hôpital
Bichat, Paris.
Cet article fait un intéressant point sur la conduite actuelle devant
un accident professionnel d’exposition au sang (AES).
L’intérêt de la chimioprophylaxie est en effet discuté. Si le risque
de séroconversion après AES est faible (0,3%), certains travaux
ont montré la survenue de réplication virale et de certaines
réponses cellulaires à certains antigènes viraux chez ces sujets
exposés mais «non infectés».
Le rôle de la chimioprophylaxie serait plutôt de limiter la quan-
tité de virus au-dessous d’une certaine valeur au-delà de laquel-
le l’infection serait irréversible.
Une étude cas-témoins anglaise, américaine et française, mal-
heureusement rétrospective, estimerait que la chimioprophy-
laxie diminuerait le risque de séroconversion de 80%, ce qui est
loin d’être négligeable.
Le risque de transmission du VIH (0,3%, environ 100.000 por-
teurs) ne doit pas faire oublier celui de l’hépatite B (30%, envi-
ron 300.000 porteurs), ayant quasiment disparu du fait de la
vaccination du personnel soignant et celui de l’hépatite C (3%).
1% de la population française serait porteur du virus de l’hépa-
tite C (dont seulement 15% en aurait connaissance) l’hépatite C
pouvant représenter un des problèmes majeurs de santé
publique de demain.
____________________
SUMMARY
Risks of accidental contamination by the human immuno-
deficiency virus (HIV) : review and management.
In surgery pratice, everyone must know what to do in case of
injury with exposure to body fluids. The chimioprophylactic
treatment has to be easy to take in case of high risk of VIH
transmission.
To prevent these accident, surgery on infected people must
always be done by surgeon who have experience.
Key words : Surgery, AIDS, professional accident.
332
____________________
S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

Note de l’auteur (Sophie Conquy, Service
d’Urologie, Hôpital Cochin, Paris)
Domaine en constante évolution et faisant l’objet d’une
prise de conscience de toutes parts, la prévention des
AES a justifié un rapport de la DGS postérieur à la
rédaction de notre article. Bien que ne modifiant pas le
fond du problème, il nous a paru utile de l’adjoindre à
notre travail pour une information aussi exhaustive que
possible.
Circulaire DGS/DH - N° 98/249 du 20 avril 1998
relative à la prévention de la transmission d’agents
infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biolo-
giques lors des soins dans les établissements de
santé.
R é s u m é : Un programme de prévention de la transmis-
sion d’agents infectieux véhiculés par le sang ou les
liquides biologiques lors des soins dans les établisse-
ments de santé repose sur la vaccination des personnels,
la formation, le respect de règles d’hygiène lors des soins
exposant le personnel ou le patient à des produits biolo-
giques, la surveillance, l’utilisation rationnelle de maté-
riel de sécurité, l’évaluation des actions entreprises.
Mots clés : Transmission d’agents infectieux, V.I.H.,
V.H.B., V.H.C., accidents avec exposition au sang, pré-
cautions générales d’hygiène, vaccination.
Textes de référence
- Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques résultant de leur
exposition à des agents biologiques.
- Article L. 10 du code de la santé publique.
- Circulaire DGS/DH n° 51 du 29 décembre 1994 rela-
tive à l’utilisation des dispositifs médicaux à usage
unique.
- Circulaire DGS/DH/DRT n° 98-228 du 9 avril 1998
relative aux recommandations de mise en oeuvre d’un
traitement antirétroviral après exposition au risque de
transmission du VIH.
Texte actualisé : Circulaire DGS/DH n° 23 du 3 août
1989 relative à la transmission du virus de l’immuno-
déficience humaine chez le personnel de santé.
Le risque de transmission d’agents infectieux du
patient au soignant, connu pour le virus de
l’hépatite B (V.H.B.) a été rappelé dans les années 80
avec l’épidémie d’infections par le virus de l’immuno-
déficience humaine (V.I.H.). Ceci a conduit à actualiser
le concept d’isolement vis-à-vis du sang et des liquides
biologiques et à formuler des règles d’hygiène appli-
cables à tout patient1. Ces règles d’hygiène destinées à
protéger le personnel vis-à-vis des Accidents avec
Exposition au Sang (A.E.S.)2, constituent également
des recommandations permettant de diminuer le risque
de transmission croisée d’agents infectieux véhiculés
par le sang et les liquides biologiques.
Huit ans après ces premières recommandations, il
apparaît que :
- le virus de l’hépatite C (V.H.C.), identifié plus récem-
ment, est à l’origine de plusieurs cas de transmission en
milieu de soins indépendamment de la transmission
transfusionnelle [1 - 3].
- les modes de transmissions sont multiples : transmis-
sion de patient à soignant, de patient à patient et de soi-
gnant à patient [4 - 13].
- les règles d’hygiène précédemment citées sont insuf-
fisamment appliquées d’après les enquêtes menées
dans les unités de soins [14, 15].
- enfin, la nécessité de maîtriser le risque de transmis-
sion de l’ensemble des agents infectieux conduit à évo-
luer vers l’application des précautions générales
d’hygiène ou précautions «standard» en référence
aux «standard précautions» définies par les Centers for
Disease Control and Prevention3.
Le risque de transmission d’agents infectieux est un
risque permanent qui concerne l’ensemble des
germes véhiculés par le sang ou les liquides biolo-
giques. Toutefois, du fait de l’évolution des données
épidémiologiques, la présente circulaire détaille plus
particulièrement les risques liés à certains agents
viraux transmissibles par le sang (V.I.H., V. H . B . ,
V.H.C.), et a pour objectifs :
- de rappeler aux établissements de santé l’importance de
la mise en oeuvre d’un programme de prévention eff i c a-
ce pour maîtriser les risques de transmission virale dans
les unités de soins; ce programme s’intègre dans une stra-
tégie de prévention des risques infectieux nosocomiaux,
définie, au niveau national, par le comité technique des
infections nosocomiales (C.T.I.N.) et animée, au niveau
i n t e r-régional, par les centres de coordination de lutte
contre les infections nosocomiales (C.C.L.I.N.).
- de les aider à cette mise en oeuvre en rappelant les
dispositions réglementaires applicables dans ce domai-
ne4et en actualisant les recommandations techniques
pour tenir compte de l’évolution des connaissances épi-
démiologiques.
333
1. Circulaire DGS/DH n° 23 du 3 août 1989 relative à la transmission du virus de
l’immunodéficience humaine chez le personnel de santé.
2. Un accident avec Exposition au Sang (A.E.S.) est défini comme tout contact
avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une
effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une projection sur une muqueuse (oeil) ou
sur une peau lésée.
3. Les précautions générales d’hygiène ou précautions «standard» doivent être
appliquées pour tout patient dès lors qu’il existe un risque de contact ou de pro-
jection avec du sang, des liquides biologiques mais aussi avec des sécrétions ou
excrétions et pour tout contact avec une peau lésée ou une muqueuse.
Ces recommandations ont été présentées dans le guide de «recommandations
d’isolement spetique» préparé par la Société Française d’Hygiène Hospitalière et
le Comité Technique des Infections Nosocomiales dont une version temporaire est
paru dans la revue Hygiènes - Hors série n°1 - 1996.
4. Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les
risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et article L. 10 do
code de la santé publique.
S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341

LES RISQUES DE TRANSMISSION D’AGENTS
INFECTIEUX PAR LE SANG ET LES LIQUIDES
BIOLOGIQUES
I - Les risques pour le personnel de santé
Le sang ou les liquides biologiques peuvent véhiculer
des agents infectieux très divers (bactéries, virus, para-
sites et champignons).Parmi ces agents infectieux, le
V.I.H., V.H.B., V.H.C. représentent un risque particulier
du fait de la possibilité d’une virémie prolongée et de la
gravité des infections engendrées. De nombreuses
études ont permis de préciser ce risque.
Le V.I.H. : Bien que ce virus soit retrouvé dans divers
liquides biologiques, seuls le sang et les liquides biolo-
giques contenant visiblement du sang et provenant de
patients dont la virémie est élevée ont été jusqu’alors
impliqués dans la transmission en milieu de soins [4,
17]. Le risque de transmission du V.I.H. après exposi-
tion au sang d’un patient porteur du V.I.H. est estimé à
0,32%.
Le V.H.B. : Le risque de transmission du V.H.B. à par-
tir d’un patient infecté est très élevé (1 à 40%).Cette
forte contagiosité est liée à la quantité importante de
virus présents dans le sang et les liquides biologiques
(106à 109particules virales par ml).. Depuis janvier
1991, date à laquelle la vaccination contre l’hépatite B
a été rendue obligatoire en France chez le personnel de
santé (article L.10 du Code de la Santé Publique)), le
risque de contamination des soignants est en nette
régression. Toutefois, ce risque persiste encore, notam-
ment pour certaines catégories professionnelles (méde-
cins) pour lesquelles la couverture vaccinale reste
insuffisante [18].
Le V.H.C. : En raison de la prévalence estimée de cette
infection dans la population générale (de l’ordre de 1%)
et de son caractère asymptomatique, le risque théorique
de contamination est élevé [19]. Les données épidé-
miologiques actuelles montrent que le risque profes-
sionnel de contamination par le V.H.C. après exposition
au sang d’un patient porteur du V.H.C. varie entre 2 et
3%. Ce risque est faible comparé à celui de l’hépatite B
et peut s’expliquer par une virémie moins importante
(103à 104particules virales par ml de sang).
Le tableau de l’annexe I résume les informations dis-
ponibles concernant les risques de contamination pour
les soignants, après un A.E.S., par ces trois virus.
Les autres agents viraux : De nombreux agents viraux
peuvent être véhiculés par le sang ou liquides biolo-
giques. La transmission de ces agents au personnel soi-
gnant est donc toujours possible notamment pour des
infections graves telles les fièvres hémorragiques, dont
plusieurs cas de transmission au personnel de santé ont
été rapportés.
Le risque de contamination professionnelle dépend
également des circonstances de l’exposition. Bien que
des cas de contamination par le V.I.H. après projections
cutanées soient rapportés [4, 20], il a été établi que les
piqûres profondes avec une aiguille creuse ayant servi
à un abord vasculaire ou contenant du sang sont majo-
ritairement en cause dans la transmission du V.I.H.
chez les soignants [17]. Différentes enquêtes menées
dans les unités de soins montrent que les accidents par
piqûre surviennent [14, 15] :
- pendant le geste, notamment lors du retrait de l’ai-
guille de la veine du patient.
- mais aussi après le geste invasif, lors de l’utilisation
de conteneurs trop remplis, lors de la manipulation
d’instruments souillés, lorsque les précautions univer-
selles ne sont pas respectées : recapuchonnage, désa-
daptation manuelle de l’aiguille, port de gants non sys-
tématique lors de la réalisation de gestes à risques,
alors que le gant constitue une barrière efficace de pro-
tection en permettant de diminuer l’inoculum sanguin
reçu par le soignant en cas de blessure. Ces accidents,
liés au non respect de recommandations de prévention,
sont évitables.
II. Les risques pour les patients
1 - La transmission aux patients par l’intermédiaire
d’instruments contaminés :
Plusieurs exemples de contaminations de patient à
patient par ces mêmes agents viraux (V.I.H., V.H.B.,
V
.H.C.) sont rapportés dans la littérature.
Ils consti-
tuent de véritables épidémies nosocomiales et résultent
le plus souvent d’une gestion inadaptée du matériel ou
des soins ou du non respect des précautions d’hygiène.
Cette possible transmission virale doit être envisagée
devant toute procédure comportant une effraction cuta-
née ou un abord vasculaire, et peut se faire, notamment
:
- par le viais d’instruments ayant subi une procédure de
stérilisation ou de désinfection inefficace ou de dispo-
sitifs à usage unique réutilisés (pinces à biopsie au
cours d’endoscopies, autopiqueurs pour glycémie digi-
tale [6, 7].
- par le giais d’instruments déconditionnés à l’avance
et exposés, avant utilisation, à une contamination par
projection de microgouttelettes de sang générées lors
de la purge d’une seringue contenant du sang, ou lors
d’un abord vasculaire réalisé avec un dispositif ne
comportant pas de valve anti-retour (biopsies endo-
myocardiques [8], radiologie interventionnelle...).
- par le biais de gants lorsque ceux-ci ne sont pas chan-
gés entre deux patients (par exemple en dialyse [5]).
334
S. Conquy et coll., Progrès en Urologie (1999), 9, 330-341
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%