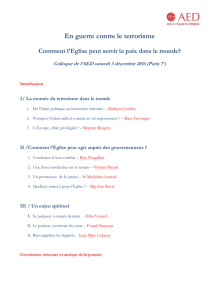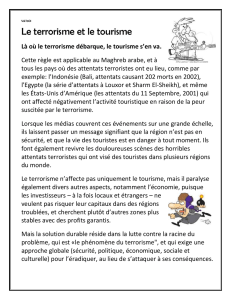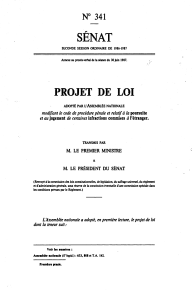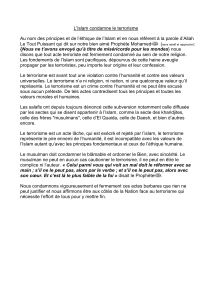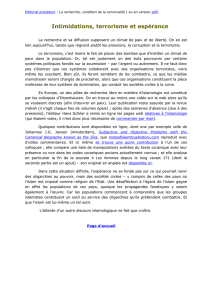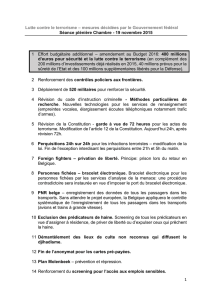Entre guerre et paix : le terrorisme

Entre guerre et paix :
le terrorisme
C
omment comprendre la suc-
cession des actions terroristes
aujourd’hui ? Le monde contem-
porain présente des contrastes accusés. Il
est parcouru par un processus de civili-
sation, il accroît les relations d’interdé-
pendance entre ses parties constitutives,
il élabore des mécanismes de régulation
des conflits qui le traversent, mais en
même temps il ménage la possibilité
récurrente de meurtres impromptus et
concertés qu’il peine à enrayer. Il a
même de grandes difficultés, dans les
instances internationales notamment,
à s’accorder sur une définition com-
mune du terrorisme. Ce terme, employé
avec une complaisance inflationniste et
doté de multiples significations méta-
phoriques (le terrorisme intellectuel ou
informatique par exemple), suscite le
consensus au moins sur un point : il peut
s’appliquer à d’autres mais rarement à
soi-même. Il sert avant tout à disquali-
fier un ennemi et à s’autoriser tous les
moyens pour le combattre. Il est ainsi
pris dans un tourbillon de confusions
qui l’apparentent au mal, à la guerre,
voire à une aire culturelle, idéologique
ou religieuse réprouvée. Pour contri-
buer à démêler cet écheveau, il convient
d’abord de s’interroger sur les rapports
entre guerre et terrorisme puisque les
deux termes sont aujourd’hui volon-
tiers associés. Nous nous intéresserons
également aux significations que revêt
aujourd’hui le terrorisme, aux raisons
susceptibles de pousser à y recourir, aux
caractéristiques de la stratégie qu’il met
en œuvre. Cela nous permettra de mettre
en relief la surenchère contemporaine,
mais aussi les limites de ce type d’en-
gagement.
La guerre consiste en un recours illi-
mité à la force visant à imposer sa propre
volonté et à briser celle de l’ennemi afin
d’obtenir sa soumission. Elle est «un
acte de violence destiné à contraindre
l’adversaire à exécuter notre volonté »
1
.
Elle comporte une dimension psycho-
logique essentielle puisqu’il s’agit de
faire plier l’ennemi, de le faire passer
de l’exaltation au découragement, de
le priver de ses capacités de résistance
et de riposte. Faire la guerre, c’est donc
tenter d’inspirer la peur aux forces que
l’on combat
2
. En fait celles-ci ne se
composent souvent que d’une partie de
la population d’un territoire. Ainsi, au
Moyen-âge, les guerres sont avant tout
une affaire de privilégiés qui se définis-
sent par la possession des armes et de
l’équipement appropriés, la maîtrise de
leur maniement, la capacité à conduire
des opérations militaires. Elles sont à la
fois incessantes, intermittentes et saison-
nières. Elles se réactivent au printemps
et s’interrompent lorsque les armées
prennent leurs « quartiers d’hiver ». Elles
peuvent se prolonger pendant de longues
périodes, jusqu’à cent ans, voire devenir
endémiques. De telles durées signalent
toutefois de grandes différences avec les
guerres ultérieures. La distinction entre
l’état de guerre et l’état de paix n’a pas
été toujours aussi nette qu’on l’imagine
à l’époque moderne. La guerre médié-
vale est une activité spécialisée, séparée,
qui n’affecte pas toute la vie sociale.
Elle s’impose aussi des limitations en se
conformant plus ou moins à des règles
dans l’affrontement et à une déontologie
fondée sur le sens de l’honneur et la
protection des plus vulnérables.
Les restrictions à l’usage incontrôlé
de la violence s’amplifient à mesure que
le pouvoir royal parvient à établir son
ascendant sur la noblesse d’épée et à la
subordonner étroitement à ses intérêts.
Il s’efforce de faire prévaloir le mono-
pole de la violence physique légitime
sur un territoire déterminé. La guerre
devient alors sa prérogative exclusive.
Il y recourt pour accroître sa puissance
par rapport aux autres États. Il entretient
avec ceux-ci des relations suivies, obéis-
sant à des usages protocolaires précis,
susceptibles d’exprimer les nuances des
relations mutuelles. Lorsque ces derniè-
res se détériorent, la tension est marquée
par une gradation de signes, du rappel
de l’ambassadeur jusqu’à la rupture des
relations diplomatiques, l’adresse d’un
ultimatum, l’ouverture des hostilités.
L’entrée en guerre est solennisée par
une déclaration qui introduit dans un
46
PASCAL HINTERMEYER
Laboratoire “Cultures et sociétés en Europe”
(UMR du CNRS n° 7043)
Université Marc Bloch, Strasbourg

47
Pascal Hintermeyer Entre guerre et paix : le terrorisme
autre univers moral,
3
. La guerre a été
analysée comme une inversion des prin-
cipes de la vie sociale. Elle transforme
les incitations à la coopération et à l’ac-
cumulation des richesses en impératif de
destruction
4
. À la rationalité, la commu-
nication, la délibération, elle substitue la
haine à l’égard de l’ennemi et l’injonction
de le tuer. Elle lève l’interdit du meurtre
au nom de la défense des intérêts fonda-
mentaux de la collectivité et de l’ordre
donné par ceux qui assument la charge de
la protéger. Le resserrement hiérarchique
rend le commandement absolu et l’obéis-
sance complète. L’autonomie de chacun
est étroitement subordonnée au groupe
et à ses dirigeants. « La possession de
l’individu par l’État est le caractère de
l’état social adapté à la guerre »
5
. Comme
celle-ci modifie profondément la tonalité,
l’organisation et les principes de la vie
sociale, des règles régissent le début, le
déroulement et la suspension des hosti-
lités. Ces efforts pour imposer un cadre
et des limites à la guerre se prolongent,
à partir du début du XIXe siècle, par
l’adoption d’autres conventions portant,
même en situation de guerre, sur la pro-
tection des blessés, des prisonniers et des
civils. Mais ces dispositions n’ont pas
suffi à atténuer les horreurs des guerres.
Les efforts pour juguler la sauvagerie
des passions belligènes se heurtent bien
sûr aux contextes où les États ne par-
viennent pas à se réserver le monopole
de l’exercice de la violence. Celle-ci est
difficile à contrôler là où elle résulte
d’initiatives privées, soit à l’intérieur des
frontières étatiques du fait d’exactions
provoquées par des bandes armées, soit
sur les eaux internationales en raison
d’entreprises de piraterie. Surtout, l’inca-
pacité à restreindre la violence est impu-
table aux États eux-mêmes. En effet, les
guerres qu’ils mènent sont susceptibles
de basculer dans la violence générali-
sée, pour peu qu’elles visent à conqué-
rir des populations ou encore qu’elles
comportent des dimensions religieuses,
idéologiques ou nationales exacerbées.
Les guerres de conquête, comme celles
menées par les Mongols au XIVe siècle,
visent à dominer de vastes territoires en
inspirant systématiquement la terreur aux
populations civiles, dans l’espoir de s’as-
surer leur docilité . Celles-ci deviennent
aussi une cible privilégiée de ces guerres
que Clausewitz appelle absolues parce
qu’elles cherchent à annihiler l’ennemi.
Ce fut le cas des grandes guerres reli-
gieuses, notamment celle de Trente ans,
qui décima une proportion importante de
la population allemande dans la première
moitié du XVIIe siècle et qui fut émaillée
de massacres comme le sac de Magde-
bourg en 1631. Les initiatives de régé-
nération collective ont une propension
remarquable à faire couler massivement
le sang.
Dans le but d’affranchir et de libérer
les hommes, la Révolution française en a
tué beaucoup. Elle a aussi représenté une
inflexion majeure dans l’évolution de la
guerre. Ayant supprimé les privilèges et
donc l’ordre constitué par la noblesse,
dont la vocation était de porter les armes,
elle fut prise au dépourvu lorsque son
idéal de fraternisation universelle et de
paix perpétuelle se transforma en une
situation où elle dut mener la guerre
contre l’Europe coalisée. Elle eut alors
recours, pour compenser son infériorité
technique par une supériorité numérique,
à la conscription, à la levée en masse,
à l’offensive à outrance. Le terme de
terrorisme apparut dans ce contexte en
référence à un système de gouvernement
appelé La Terreur. Celle-ci met en place
systématiquement des mesures excep-
tionnelles de coercition et de répression
conçues comme un moyen de sauver la
patrie en danger et de conduire la guerre.
Les premiers terroristes furent des parle-
mentaires, des membres de la Convention
envoyés en tant que représentants en mis-
sion dans les provinces pour y galvaniser
les énergies et y exercer des pouvoirs
exceptionnels illimités les autorisant à
prendre toute disposition propre à stimu-
ler la défense nationale.
De moyen de mener la guerre, le ter-
rorisme se transforme ensuite en tentative
visant à l’anticiper. Le long XIXe siècle
est agité par les revendications sociales
et nationales. Ceux qui souhaitent les
amplifier et les faire déboucher sur la
guerre de classe ou la guerre d’indé-
pendance peuvent adopter des méthodes
visant à précipiter le conflit. Dans l’espoir
de provoquer une escalade des hostilités,
ils tentent en particulier d’assassiner les
dirigeants de l’État abhorré. Il arrive
que de tels procédés aboutissent à un
engrenage irréversible de la violence.
Le succès le plus complet de ce point de
vue a sans doute dépassé l’attente de son
auteur. Il s’est produit en août 1914 lors
de l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc
François-Ferdinand, héritier de l’empire
austro-hongrois. Cet attentat a provoqué
la Première guerre mondiale en déclen-
chant un processus fréquemment analysé
par les historiens comme une réaction en
chaîne. Le terroriste se veut l’augure, le
catalyseur et l’avant-garde de la guerre. Il
est rare que son rôle soit aussi décisif.
Les rapports entre le terrorisme et la
guerre sont liés aux évolutions que cette
dernière a connues au cours des deux der-
niers siècles. Pendant cette période, elle
a considérablement accru ses capacités
meurtrières. Mettant en œuvre des techni-
ques toujours plus efficaces, elle absorbe
aussi des ressources croissantes des belli-
gérants et n’épargne rien ni personne. La
dimension psychologique, fondamentale
dans toute guerre, a pris des proportions
considérables. Elle a conduit à terroriser
et à bombarder des populations civiles,
notamment à Londres, Dresde, Hiroshi-
ma. Avec l’utilisation de l’arme nucléaire
contre cette dernière ville, le crescendo
dans l’horreur a connu son acmé. Depuis,
les principales puissances se livrent à une
course aux armements tout en s’interdi-
sant l’emploi de leur arsenal atomique
dont les effets destructeurs sur l’humanité
seraient imprévisibles. Ce coup d’arrêt
n’a pas aboli les confrontations armées,
qui sont souvent devenues plus indirec-
tes. Les plus puissants les mènent par
alliés périphériques interposés (en Corée,
Indochine, Amérique latine) et plus sou-
vent encore dans l’ombre des services
secrets. Le processus de décolonisation a
aussi démultiplié des conflits volontiers
présentés par les métropoles en fonction
de la nécessité d’assurer l’ordre public.
Malgré les euphémismes utilisés, des
« événements » d’Algérie aux opérations
de maintien de la paix, l’instabilité et les
affrontements armés sont présents dans
beaucoup d’endroits de la planète.
Dès les années 1960, Raymond Aron
remarque que le monde contemporain
recèle de nombreuses situations inter-
médiaires entre la guerre et la paix
6
.
Le terrorisme participe de ce brouillage
des repères. Il trouble la vie sociale par
l’irruption inopinée d’actes d’hostilité. Si
la distinction entre guerre et paix impli-
que des relations sociales différentes,
leur indistinction provoque de profondes
perturbations dans les manières de vivre

48 Revue des Sciences Sociales, 2006, n° 35, “Nouvelles figures de la guerre”
ensemble. Elle ramène les sociétés à un
stade où la sûreté reste incertaine et à la
merci d’initiatives visant à la compro-
mettre.
Des guerres
nécessaires
et impossibles ■
La possibilité d’actions terroristes
perpétrées par de petits groupes détermi-
nés remet en cause la prétention moderne
à limiter la violence et à en réserver l’ad-
ministration réglée à l’État. Celui-ci doit
aujourd’hui compter avec des entreprises
semant la terreur afin de déstabiliser des
populations. Il doit aussi se garder de ses
propres tendances à réagir, ne serait-ce
qu’incidemment et partiellement, avec les
procédés employés contre lui. Les métho-
des terroristes établissent leur ascendant
par leur capacité à gagner ceux contre
lesquels elles sont dirigées. Dans certai-
nes situations, elles constituent en effet
une alternative à la guerre dont elles
permettent de minorer les risques et
les coûts. Les codes réglant l’expression
des relations internationales s’en trouvent
modifiés. Un exemple illustre combien le
registre de l’agression déteint sur celui
de la riposte. Lorsqu’en 1983 une bombe
explose dans une discothèque fréquentée
par des soldats américains à Berlin, le
président Reagan y décèle l’œuvre de la
Lybie. Il envoie alors des avions bom-
barder les deux villes principales de ce
pays. Cet épisode montre que même une
« superpuissance » peut commettre des
actes d’agression contre un pays souve-
rain en jouant sur l’effet de surprise, en
s’en prenant à des populations civiles,
mais sans déclaration officielle des hos-
tilités. Ainsi s’affranchit-on des règles
de la guerre dans l’espoir d’en éviter les
inconvénients. Les États tirent occasion-
nellement parti de ressources stratégiques
qui sont d’ordinaire utilisées par de petits
groupes spécialisés dans leur mise en
œuvre.
Les risques d’usage incontrôlé de la
violence sont potentialisés par les pro-
cessus mimétiques entre États et groupes
terroristes. Ceux-ci ont tendance à se
prendre pour de quasi-États et à affirmer
les attributs de la souveraineté de manière
d’autant plus caricaturale qu’elle leur
est refusée. Ils imitent les institutions
régaliennes, en particulier l’armée et la
justice. Ils prétendent instruire des procès
et exécuter des sentences. Ils revendi-
quent un usage absolu de la raison d’État
et en particulier le droit de mettre à mort
ennemis, traîtres et coupables. Inverse-
ment les États confrontés à des entre-
prises terroristes ont tendance à adopter
des mesures d’exception dans l’espoir
de « terroriser les terroristes », selon une
formulation employée par un ancien
ministre de l’intérieur (Charles Pasqua).
Cet effet est attendu de restrictions des
libertés publiques qui sont supposées
entraver les initiatives hostiles mais qui
imposent à l’ensemble de la population
une situation où les acquis de la paix et
de la démocratie sont malmenés.
Le face à face entre l’État et les acti-
vistes terroristes s’effectue surtout au
détriment de la population concernée.
Un État peut tirer parti de l’existence
d’un ennemi discrédité et marginal, ce
qui conduit certains auteurs à considé-
rer que ses services secrets manipulent
les groupes terroristes et les réactivent
le cas échéant
7
. Toujours est-il que la
population civile fait les frais de cette
confrontation, tant du fait du renforce-
ment des contrôles et de la limitation des
libertés qu’en raison des pertes en son
sein et du climat général qui s’instaure.
La stratégie terroriste repose en effet sur
la distinction et l’imbrication de plusieurs
niveaux. Pour faire pression sur un État
ou le déstabiliser, une violence ou une
menace de violence est exercée ponctuel-
lement sur des individus afin de semer la
peur dans le groupe dont ils font parti
et d’atteindre l’autorité politique dont il
relève. La société civile est donc utilisée
comme levier dans une confrontation qui
la dépasse.
Le terrorisme a des chances de se
développer là où la guerre est à la fois
nécessaire et impossible. La guerre
apparaît comme nécessaire lorsque les
points de vue sont inconciliables et qu’un
compromis ne parvient pas à se dégager
entre les positions prêtes à s’affronter.
L’antagonisme est ainsi souvent irréduc-
tible lorsqu’il porte sur des questions de
souveraineté. Mais une guerre nécessaire
peut s’avérer impossible à mener, en rai-
son de ses conséquences prévisibles pour
l’un au moins des belligérants. Lorsque le
potentiel destructeur des armes accumu-
lées dissuade de s’en servir, la situation
peut être analysée comme une guerre
froide où les confrontations se font sur
un mode indirect. Lorsque la dispropor-
tion des forces en présence ne laisse à
la partie la plus faible aucune chance de
l’emporter, celle-ci se trouve empêchée
de conduire une guerre directe, elle peut
alors opter pour des actions ponctuelles.
Des opérations
ponctuelles
symboliques ■
Le terrorisme apparaît souvent de nos
jours comme un substitut de la guerre.
Il adopte des méthodes qui présentent
certains avantages tactiques et peuvent
compenser quelque peu un déséquilibre
à son détriment. D’abord il frappe à
l’improviste, en s’attaquant à des cibles
qui ne se tiennent pas sur leurs gardes.
L’action terroriste consiste à préparer
méticuleusement et secrètement des coups
qui seront ensuite portés au moment et à
l’endroit où l’ennemi ne s’y attend pas et
n’a donc pas pris de disposition efficace
pour les parer. L’impératif de discrétion
est adapté à de petits effectifs composant
une microcellule largement autonome et
difficile à infiltrer. Les opérations menées
n’atteignant qu’une petite partie des
forces ennemies, elles sont montées avec
soin. Le choix de l’objectif est important.
Comme il est limité, il doit avoir une
signification plus étendue, représenter
une métonymie de l’ennemi dans son
ensemble. Un procédé classique du
terrorisme consiste à frapper des cibles à
forte charge symbolique. C’est ainsi que
des dirigeants ont été assassinés un peu
partout en Europe à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle ainsi que dans les
années 1970 en Allemagne et en Italie.
De même, un préfet de la République a
été exécuté en Corse. Depuis quelques
années, les terroristes cherchent aussi à
s’en prendre à des lieux emblématiques
du pays visé. Déjà à la fin de l’année
1994, l’avion d’Air France détourné
sur l’aéroport d’Alger devait servir de
projectile contre la tour Eiffel.
La dimension symbolique du terroris-
me est essentielle. Les cibles visées doi-
vent pouvoir être présentées comme une
condensation de la puissance attaquée.
Cette association d’idées est souvent
appuyée par une rhétorique volontiers

49
Pascal Hintermeyer Entre guerre et paix : le terrorisme
redondante, insistant sur l’appartenance
de la victime à un ensemble ou à un
« système » honni. Les destructions infli-
gées en 2001 au World Trade Center et
au Pentagone suggèrent que les centres
financier et militaire de la principale
puissance mondiale seraient touchés. Le
terrorisme veut atteindre un ensemble
à travers la violence faite à une de ses
parties significatives. À défaut de pouvoir
s’en prendre frontalement à la collecti-
vité, il tente de la « frapper au cœur ».
Celui-ci ne se limite plus aujourd’hui
aux principaux dirigeants qui sont géné-
ralement bien gardés et très protégés,
si bien qu’ils sont difficiles à atteindre.
Mais même lorsqu’ils sont effectivement
éliminés, comme ce fut le cas des chefs
d’État victimes d’attentats anarchistes
à la fin du XIXe siècle, d’Aldo Moro,
le leader de la Démocratie chrétienne
exécuté en Italie par les Brigades Rouges
ou de Georges Besse, le PDG de Renault
assassiné par le groupe Action directe,
l’impact symbolique reste primordial. En
effet éliminer ces décideurs ne suffit pas
à vaincre l’institution visée à travers eux.
En l’occurrence, l’État ou le capitalisme
survivent aisément à la disparition de
quelques uns de leurs membres, y com-
pris ceux qui occupent les fonctions les
plus élevées, qui sont destinés à passer
la main et à être remplacés, à plus ou
moins long terme. L’opération terroriste
parvient seulement, en cas de succès,
à devancer cette échéance nécessaire.
Lorsqu’elle arrive à ses fins, elle hâte le
renouvellement du personnel dirigeant
des institutions touchées, qui se trouvent
de la sorte protégées d’un risque d’im-
mobilisme et de sclérose. Les effets du
terrorisme sont souvent paradoxaux. De
plus la prépondérance de la dimension
symbolique autorise une diversification
des cibles potentielles. En Égypte ou en
Indonésie, ce sont des touristes. À New
York et Washington, c’est la multitude
anonyme qui contribue dans l’ombre des
bureaux à la puissance de l’Amérique. À
Madrid et à Londres, ce sont les usagers
des transports en commun.
Avec le développement du terroris-
me, les rapports sociaux deviennent une
source potentielle de danger, lorsqu’ils
mettent en présence des inconnus dans
des lieux de transit ou de passage. La
méfiance s’instille dans l’espace public
et elle peut y favoriser la suspicion géné-
ralisée. Face à toute catastrophe, voire
à tout dysfonctionnement, on en vient à
se demander s’ils ne sont pas intention-
nels. Dans l’explosion de l’usine AZF
à Toulouse, dans la panne des réseaux
électriques de Los Angeles, se retrouve
la tendance à rechercher les indices d’un
plan ourdi par un mauvais génie contre
ses contemporains. Dans la société du
risque, il est devenu difficile de faire
la part de ceux qui sont imputables à
une volonté destructrice. Le terrorisme
s’ajoute et se mêle à toutes les menaces
qui pèsent sur l’existence humaine dans
le monde d’aujourd’hui
8
.
L’essentiel étant de provoquer la peur
dans une population, si celle qui est visée
est confondue avec tout un pays, il arrive
que les cibles soient frappées de manière
aléatoire. En outre, les civils anonymes
sont des proies particulièrement faciles
parce qu’ils vaquent à leurs occupations
ordinaires, sont amenés à se déplacer
pour cela et à côtoyer dans l’espace
public nombre de gens inconnus. Le ter-
roriste qui s’en prend à eux les précipite
Daniel Depoutot : Dragon, 2003.

50 Revue des Sciences Sociales, 2006, n° 35, “Nouvelles figures de la guerre”
soudain sans sommation sur le front qu’il
vient d’ouvrir pour faire voler en éclat la
quiétude de la vie quotidienne et suggé-
rer que personne n’est à l’abri. Il achève
d’abolir la distinction entre combattant
et civil en s’inspirant des préceptes de
la guerre totale qu’il voudrait déclen-
cher sans avoir les moyens de la mener.
À la différence des combats classiques,
localisés et datés, le terroriste cherche à
provoquer un affrontement impossible à
circonscrire dans l’espace et le temps et
donc susceptible de diffuser, à partir d’un
impact ponctuel, un ébranlement de large
amplitude.
Dans son entreprise de déstabilisation,
le terrorisme tire parti de certaines carac-
téristiques de la société contemporaine.
On sait qu’il utilise les médias comme
caisse de résonance pour propager l’onde
de choc de ses actions aussi loin que
portent les moyens de communication de
masse, c’est à dire aujourd’hui à toute la
planète. On peut aussi remarquer qu’il
utilise largement les technologies de
l’information et de la communication,
des vidéocassettes à Internet, pour trans-
mettre ses messages. D’un point de vue
opérationnel, il cherche à adopter les
innovations qui rendent les moyens de
destruction plus meurtriers et qui les
mettent à la portée d’un petit nombre
d’activistes. L’efficacité de ses actions est
d’ailleurs dûe à ce qu’elles s’inscrivent
dans les fragilités consécutives à l’ouver-
ture et la complexité des sociétés contem-
poraines. Ainsi le terrorisme tire parti des
caractéristiques et des instruments de la
modernité avancée. Il se loge dans ses
interstices pour se retourner contre elle et
compromettre ses acquis. En particulier il
contrarie l’aspiration à rendre l’existence
humaine davantage prévisible et assurée
en l’exposant à des périls inédits. En réac-
tivant le spectre de la mort donnée délibé-
rément dans la vie quotidienne pacifique,
il sape un des fondements du pacte social
contemporain et du consensus entre gou-
vernés et gouvernants. Ceux-ci tirent
une part importante de leur légitimité de
leur aptitude à protéger la vie de leurs
ressortissants et ils se trouvent mis en
difficulté là où ils échouent à s’acquitter
de cette tâche. Ils sont vulnérables à la
panique résultant d’attentats provoqués
dans l’espace public par des mercenaires
agissant à la solde d’une puissance ou au
nom d’une cause. Certes la probabilité
d’être victime d’un attentat terroriste est
de beaucoup inférieure à celle de subir
un accident chez soi, sur la route ou au
travail. Mais de tels risques sont répu-
tés inéluctables alors que le terrorisme
suppose une volonté
9
. En s’en prenant
à la vie humaine, il atteint une valeur
fondamentale que la modernité met en
relief à travers la promotion des droits de
l’homme et la constitution d’une société
des individus. Cette référence est d’autant
plus importante que d’autres sources de
consensus, notamment celles invoquant
une transcendance, ont été discréditées,
délaissées ou abandonnées à des particu-
larismes communautaires. L’incapacité
à protéger l’existence de chacun repré-
sente un scandale qui mine les accords
sur lesquels reposent les coopérations
collectives.
Résurgences
sacrificielles ■
Ceux qui bravent l’interdit de tuer
se placent au-dessus des lois ordinaires
et s’arrogent un pouvoir absolu, devenu
inaccessible de nos jours même aux titu-
laires des fonctions les plus éminentes.
Une telle exacerbation de la volonté de
puissance peut s’analyser comme une
revanche compensatoire à des frustra-
tions invétérées
10
. Mais comment s’auto-
riser une prérogative aussi exorbitante ?
Une conception supérieure de la morale
est avancée pour s’affranchir de ses pré-
ceptes habituels. Le terroriste n’est pas
censé tuer pour assouvir ses propres pul-
sions ou satisfaire ses intérêts person-
nels. C’est ce qui le distingue du grand
criminel ou du brigand. Il se prétend un
instrument au service d’une cause trans-
cendante. Il se revendique l’auteur d’un
meurtre altruiste. La contrepartie de ce
devoir de tuer est que celui qui l’assume
accepte de renoncer aux satisfactions et
aux affections accessibles au commun
des mortels. Netchaïev proclamait déjà
dans la Russie des années 1870 ce que la
vocation nihiliste avait d’exigeant : celui
qui s’y consacre est un homme perdu qui
doit être prêt à se soustraire à tous les
attachements de l’existence
11
. En ce sens,
le terrorisme représente une résurgence
du sacrifice dans un monde animé par la
rationalité, les droits individuels et les
relations contractuelles. Au mépris de ces
références, la victime et le bourreau sont
offerts de concert, voire confondus, pour
célébrer une cause et témoigner de son
éclat. Ce sacrifice est destiné à obtenir la
rédemption du mal actuel, à féconder un
ordre nouveau, voire à en préparer l’avè-
nement pour les générations futures
12
.
Ces significations sacrificielles sont
particulièrement mises en relief dans les
cas, devenus aujourd’hui fréquents, où
l’attaque terroriste est planifiée dans le
but de tuer à la fois celui qui fait office
de bombe humaine et les personnes se
trouvant sur le lieu de l’explosion. Les
attentats-suicides supposent la mort du
kamikaze qui les accomplit. Celui-ci est
incité à mourir en échange d’une place au
paradis, de la reconnaissance témoignée
au martyr, d’avantages matériels et sym-
boliques accordés à sa famille. Il arrive
que la dissociation entre l’acte terroriste
et celui qui l’exécute fasse de ce der-
nier la proie d’une manipulation qui lui
échappe. Ainsi des femmes tchétchènes
rendues vulnérables par la perte de leurs
proches sont recrutées pour transpor-
ter des explosifs destinés à être activés
par les concepteurs de l’attentat qui res-
tent en retrait et choisissent le moment
opportun
13
. Ces petites mains du terro-
risme savent seulement en l’occurrence
qu’elles doivent donner la mort et se la
donner, mais l’initiative de la décision,
ses tenants et ses aboutissants leur échap-
pent. Elles ne sont même pas considérées
comme de véritables combattants et n’ac-
cèdent donc pas aux récompenses pro-
mises post mortem à ces derniers. Dans
le terrorisme contemporain, l’exécution
du meurtre peut ainsi être séparée de la
décision de tuer.
En dehors de ces situations où la mort
est apportée par des agents dépourvus
de toute autonomie, le terrorisme pro-
cure quelques satisfactions à ceux qui s’y
adonnent. Il donne accès à l’héroïsme, au
moins sous une forme négative, ouverte à
quiconque se sent tenté par un destin de
sacrificateur. Une telle exaltation n’est
pas dénuée de séductions, elle permet de
se prendre pour un justicier qui inflige
des châtiments, rattrape les impudents et
fait trembler tout le monde. Elle ouvre
une perspective à des yeux inconsolables
de la vacuité ou de la déchéance de leur
existence. Lorenzaccio a si longtemps
vécu dans l’entourage du tyran de Flo-
rence qu’il en a été irrémédiablement
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%