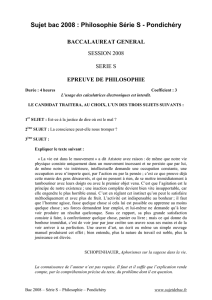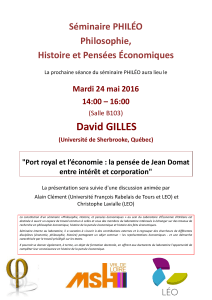De la pensée comme action à la philosophie comme ascèse

De la pensée comme action
à la philosophie comme ascèse
Par Monsieur Claude OBADIA,
Professeur de Philosophie en cpge commerciale
Lycée Sainte Croix de Neuilly/Seine
Pensée et action : du sens commun au problème philosophique
Tordre des petites cuillers par la seule puissance de son esprit, tel est bien le pouvoir que
prétendait détenir, dans les années soixante-dix, l’Israélien Uri Geller qui intéressa, faut-il le
rappeler, nombre de revues savantes tant son cas semblait exprimer, sauf trucage éhonté, la
possibilité de modifier la matière par des moyens non physiques mais mentaux, et donc par la
pensée. Pourquoi un tel pouvoir fit-il tant sensation ? En vertu de quelle idée de la pensée et de
quelle idée du rapport de la pensée et de l’action ces hypothèses purent-elles et peuvent-elles
encore nous sembler surprenantes, et selon d’aucuns peu sérieuses?
Pour le dire en un mot, il semble que nous soyons tributaires d’une représentation de la
pensée et de l’action selon laquelle ces deux réalités sont radicalement distinctes et renvoient à
des ordres de faits tout aussi différents. Penser, croyons-nous, n’est pas agir. Et l’action, pensons-
nous, en son empiricité, paraît d'abord constituer une réalité et circonscrire un type de faits
auquel, précisément le fait intellectuel, la pensée, semblent étrangers. Cette hétérogénéité n'est-
elle pas d'ailleurs ce que présuppose Malraux lorsque, soulignant la dignité de l’action politique
et en fixer l’exigence, il déclare : « il faut penser en homme d’action et agir en homme de
pensée » ? N'est-elle pas en outre un des leviers les plus puissants de la critique spinoziste du
dualisme cartésien? Pourquoi, en effet, s'escrimer à penser la matière et l'esprit comme deux
modes d'une même substance sinon pour dépasser l'aporie que constitue tout à la fois leur liaison
et l'action réciproque de l'une sur l’autre.
Le cas d’Uri Geller nous renvoie donc au même impensé que celui auquel nous ramène
Malraux. Nous suspectons de tricherie celui qui prétend agir sur la matière par la pensée parce
que nous ne croyons pas que celle-ci puisse être agissante. Nous admirons la pensée qui aurait,
pour ainsi dire, le sens de l’action et à laquelle nous opposons l’action aveugle d’être précisément
impensée. Pourquoi? Parce que le sens commun, apparemment bien peu spiritualiste, se
représente la pensée sous le mode de la stérilité, de l’abstraction, quand ce n’est pas celui de la
vacuité. Par où l'on peut voir que l'opposition entre pensée et action repose elle-même sur deux
présupposés dont n’avons pas toujours une conscience soutenue et qui, loin d’être indiscutables,
mérite analyse.
Le premier de ces présupposés est celui de l’objectivité empirique de l’action qui ne pourrait
être que physique et ob-jective. Nulle place ici pour ce que l’on serait en droit d’appeler l’action
spirituelle. Le second de ces présupposés serait celui d’une espèce de réductionnisme homologique, selon
lequel la matière n’agirait que sur la matière, et l’esprit, à supposer qu’il existe, uniquement sur
l’esprit. Cette difficulté d’imaginer une action de la pensée sur la matière, qui est au fond même
de la difficulté d’imaginer une action de l’âme sur le corps et d’imaginer conjointement une
pensée pouvant déboucher sur l’action, s’explique donc par une représentation peu questionnée
par le sens commun et qui n’est autre que celle de la distinction de la matière et de l’esprit, que
nous avons déjà évoquée.
L’auteur des Passions de l’âme affirme, chacun le sait, la distinction de l’esprit et de la
matière, distinction qui n’exclut nullement qu’en l’homme l’âme soit unie au corps. Car Descartes
n’est pas dupe. Il sait très bien que le dualisme auquel il est attaché est a priori peu conciliable avec

des phénomènes dont l’objectivité est flagrante. Nous avons le pouvoir relatif de commander
notre corps dont les troubles agissent sur l’esprit. Il nous arrive, par ailleurs, de rêver. Autant de
phénomènes qui ne peuvent être expliqués, si l’esprit est autre que le corps, qu’à la condition que
ceux-ci soient unis, comme l'explique bien l'auteur des Passions de l'âme. Car comment pourraient-
ils, sans cela, agir l’un sur l’autre? Nous voyons donc que la question d’une pensée pouvant agir
sur la matière, de la pensée comme force motrice de l’action, nous renvoie à une question
métaphysique à laquelle nous ramène sans doute aussi, mais hors du champ de la présente étude,
l’idée freudienne de la maladie psycho-somatique et de la possibilité d'agir sur elle. Cette question
peut se formuler en des termes assez simples. En admettant l’existence de deux substances
distinctes, comment expliquer que cette hétérogénéité ne fasse pas totalement obstacle à l’union
de réalités radicalement différentes?
D’un problème l’autre
Comme nous l’avons précisé, la question de la pensée comme action est d’abord celle de
savoir comment et à quelles conditions il est possible d’envisager l’influence de l’esprit sur la
matière. À y bien réfléchir, cette question débouche sur celle des conditions de la liberté.
Comment, en effet, penser l’action de la pensée sur l’action sinon, par exemple en termes kantiens, en
affirmant la possibilité, pour l’homme doué de volonté, de s’affranchir des déterminismes
naturels auxquels se ramènent pulsions et instincts, et cela pour commencer une action dont il
serait la cause productrice et qui échapperait aux déterminismes extérieurs. La question de la
possibilité de l’action est donc celle de la liberté. Affirmer, comme le fait Kant, que l’homme ne
peut accéder à la liberté qu’à la condition de se soumette à la loi morale consiste donc à envisager
la pensée comme le moteur d’une action qui s’élabore dans le monde supra-phénoménal de la
volonté mais se réalise dans le monde phénoménal qui est celui de l’action pratique. Agir serait
donc avant tout penser. Car l’action, en son sens le plus rigoureux, présupposant un véritable
pouvoir d’auto-détermination du sujet, se fonde dans l’activité qui permet à ce sujet de n’être plus
le simple objet d’une série de déterminismes.
De sorte que la question de savoir si l’on peut envisager la pensée comme action, c’est-à-
dire comme pouvoir de détermination de nos actes, est d’abord la question de savoir si l‘on peut
ou non être libre. Mais envisager la pensée comme action est aussi penser la posssibilité, pour
l’homme, d’agir sur lui-même par la pensée, par la réflexion. Aussi notre problème, qui consiste à
savoir ce que l’on veut dire quand on affirme qu’il est possible de se transformer par la pensée,
d’agir sur soi et ainsi de se maîtriser, est-il celui de savoir si oui ou non nous sommes condamnés
à subir les déterminismes qui pèsent sur nous, si oui ou non nous sommes prisonniers du destin,
de la fatalité ou si, au contraire, en prenant acte de la nécessité qui nous conditionne, il est
néanmoins possible d’accéder à la liberté et, par-là même, comme nous allons le voir, de se
réaliser en réalisatn en soi le le bonheur d’un « agir » maîtrisé.
La philosophie comme ascèse ou la pensée comme action
S’il est un ouvrage dont la lecture peut ici se révéler fort éclairante, c’est celui que Pierre
Hadot a consacré aux philosophies de l'Antiquité envisagées comme ascèses, et dont les
références sont indiquées en bibliographie. La philosophie, sauf exception et notamment celle
que constitue la période du Moyen-âge, a rarement été une activité pouvant se réduire à la simple
construction de systèmes théoriques. Les Grecs, en inventant la philosophie, n’ont pas inventé
une discipline étroitement spéculative, et encore moins la discipline scolaire à laquelle on la réduit
trop souvent aujourd’hui. La philosophie a été inventée comme on invente un genre de vie. Et les
philosophes se sont très souvent employés à proposer des exercices spirituels qui avaient pour
horizon le changement personnel, la modification de soi. On peut d’ailleurs, bien au-delà de la
seule époque antique et sans crainte de se tromper, reconnaître chez de nombreux auteurs cette

dimension pratique et ascétique de la philosophie. Que faut-il entendre, dès lors, par « exercices
spirituels » sinon, affirme Hadot, des « pratiques qui pouvaient être d'ordre physique, comme le
régime alimentaire, ou discursif, comme le dialogue et la méditation, ou intuitif, comme la
contemplation, mais qui étaient toutes destinées à opérer une modification et une transformation
dans le sujet qui les pratiquait » ? Comme nous le disions, cette dimension ascétique qui, nous le
verrons, est liée à l’idée de la philosophie comme sagesse, se retrouvera aussi chez des auteurs
considérés comme modernes, et chez celui qui passe pour être l’un des précurseurs de la
modernité, à savoir Descartes.
Lorsque celui-ci choisit de donner à son ouvrage de 1641 le titre de
Méditations, il sait très bien que le mot, dans la tradition de la spiritualité antique et chrétienne,
désigne un exercice de l'âme. Chaque Méditation se présente effectivement comme un exercice
spirituel à l’occasion duquel s’opère véritablement un travail de soi sur soi, qui doit être effectué
avant de passer à la méditation suivante. On pourrait ici décliner les noms d’Aristote, de Diogène
dont nous allons reparler, ou d’Érasme déclarant qu’il n’y a de philosophe que celui qui, capable
d’accorder ses actes à ses pensées et ses pensées à ses actes, vit de manière philosophique. Car ce
qui apparaît n’est rien moins que la dimension existentielle de l’activité philosophique, laquelle
dimension n’est concevable, comme nous allons tâcher de le montrer, qu’à la condition
d’admettre que la pensée peut s’exercer comme maîtrise de soi et comme action sur l’action elle-
même, entendue cette fois en son sens le plus trivial.
À l’école de la pensée et de l’action : retour aux origines
Les écoles philosophiques de l’Antiquité sont tout à fait singulières. Si l’étudiant moderne
ne fait de la philosophie que parce qu’elle est au programme de Terminale et si, dans le cas où ce
premier contact serait positif, il poursuit son travail à l’Université, il pourra rencontrer des
professeurs appartenant à des écoles différentes. S’il adhère à l’une d’entre elles, cette adhésion
sera, sauf exception, de type intellectuel. Et il clair que pour nous, la notion d’école renvoie à une
position doctrinale et théorique. Tel n’est pas, loin s’en faut, le cas des écoles grecques, et en
particulier à l’époque hellénistique. C’est ici le mode de vie qui y est pratiqué qui séduira ou
repoussera l’apprenti philosophe. Pour autant, la dimension proprement intellectuelle et
doctrinale n’est pas absente. Mais la grande originalité de ces écoles réside sans doute dans leur
effort convergent pour articuler la pensée et l’action dans la définition de ce que la postérité
nommera « sagesse ».
Cette singularité transparaît dans la distinction de deux catégories de personnes
fréquentant telle ou telle école. Il y a d’abord ceux qui viennent, pour ainsi dire, « suivre des
cours ». Et puis il y a ceux que l’on considère comme des « amis », des « familiers », des
« compagnons ». Ceux-ci sont moins des élèves, au sens moderne du mot, que des disciples qui
parfois partagent la vie du maître, vivant dans sa maison ou à proximité, et partageant
régulièrement avec lui leurs repas. La notoriété du maître tient d’ailleurs à des critères éthico-
pratiques. Sera considéré celui dont le mode de vie s’accorde aux principes qu’il enseigne, et qui
donc parvient à accorder sa vie et ses discours. Si bien que chaque école se définit moins par un
corpus de pensées que par un choix de vie initial, autrement dit une option existentielle. Ces
différences touchent moins les fins visées que les moyens d’y accéder. Dans tous les cas, ce qui
est visé est la tranquillité de l’âme, de sorte que la philosophie se présente alors comme une
thérapeutique des angoisses qui empêchent l’homme d’atteindre l'état de la tranquillité heureuse.
Qui plus est, la plupart des philosophes de cette époque considèrent que les hommes sont
plongés dans le malheur de par leur ignorance. Le mal n’est pas dans la réalité mais bien plus
fondamentalement dans les jugements que les hommes portent sur les choses. Il s’agit donc de
guérir, ou à tout le moins de soigner les hommes en changeant leurs jugements de valeur. Mais
pour opérer un tel changement, il faut travailler sur deux axes parallèles. Il faut commencer par
changer sa manière de penser, et à partir de là changer sa manière d’être. Si bien que la

philosophie se définit ici par un pari d’une ampleur considérable. Il ne s’agit de rien d’autre en
effet que d’affirmer plusieurs choses capitales. Premièrement, on peut changer ses pensées au
moyen de la pensée, ce qui revient à dire qu’on peut en être l’auteur au sens du sujet grammatical.
En un mot, on peut agir sur ses pensées et la pensée peut être pensée sur le mode de l’action et non
forcément sur celui de la passion à quoi se ramènent les conceptions fatalistes de la pensée
abandonnée à l’inspiration divine qui fait de l’homme un simple ventriloque.
Deuxièmement, on peut, d’une part agir sur sa manière d’être en agissant
sur ses pensées, et d’autre part agir sur ses pensées en transformant sa manière d’agir. Appliquons
nous, pour nous en convaincre, à la découverte des écoles hellénistiques!!
Le cynisme, ou l’action déviante comme paradigme de la pensée
Il est courant d’associer au cynisme la figure de Diogène et le tonneau qui lui faisait office
de maison. Fuyant les vanités de ce monde, Diogène reprend le flambeau défendu ardemment
par Socrate. Pourtant, si ce dernier se faisait d’abord remarquer par son atypie comportementale,
et d’abord vestimentaire, Diogène se montre plus radical. Les autres philosophes, en se
consacrant à l’activité scientifique ou en fuyant, comme Épicure, le tumulte de la Cité, se
distinguaient sans nul doute de leurs concitoyens. Mais les cyniques vont amorcer une rupture
beaucoup plus radicale en refusant les règles de politesse, d’hygiène, de décence, qui sont
indispensables en société. Se masturbant ou faisant l’amour en public, par des actes donc
éminemment condamnés, ils contestent les codes sociaux et rejettent les valeurs du civisme
héritées des réformes démocratiques. Méprisant l’argent et l’opinion du vulgaire, errant et
mendiant sans scrupule, les cyniques constituent sans doute comme une sorte de cas-limite qui a
entraîné certains à se demander si l’on a vraiment affaire à une philosophie tant la part du
discours était réduite au profit d’un comportement censé se suffire à lui-même. Dans la mesure
où l’on peut reconnaître entre eux des rapports de maître à disciple, l’on s’accorde à voir là une
« école » philosophique. Mais cela nous conduit alors à rompre avec l’idée qu’une école se définit
uniquement autour de thèses ou d’affirmations. Car ici, l’action tient lieu et place de pensée sur
laquelle, cependant <comment le nier ?>, elle s’appuie. Lorsque Diogène, en voyant des enfants
manger avec leurs doigts, jette son écuelle et son gobelet, il montre que philosopher n’est pas
spéculer mais consiste à réfléchir pour prendre des décisions qui engagent toute sa vie. La
philosophie devient ici pensée qui devient exercice, effort et travail, et donc action.
L’épicurisme, ou comment l’autarcie relève de l’action de la pensée.
Si chacun sait qu’Épicure a fondé son école à Athènes en 306 avant J.-C. et qu’il s’inscrit
dans la tradition du matérialisme atomiste, fondée par Démocrite, on ignore assez souvent qu’il
n’est en rien le théoricien d’un hédonisme débridé mais au contraire d’une philosophie en laquelle
ascèse, volonté, réflexion, action et liberté convergent de façon on ne peut plus singulière. Loin
de sacraliser le plaisir, y compris celui du corps, Épicure au contraire montre que le bonheur,
accessible par l’activité philosophique qui consiste en « des discours à même de procurer la vie
heureuse », est suspendu à la réflexion dont chaque homme peut se rendre maître et qui, dès lors,
constitue, au sens rigoureux du terme, une action s’opposant à la passion. Comme il l’explique
dans sa Lettre à Ménécée, il suffit en effet de faire acte de raison pour comprendre que l’on n’a pas à
craindre les dieux, que la mort n’est rien pour nous, qu’on peut supporter la douleur et que l’on
peut atteindre le bonheur dont l’idéal est celui du plaisir pris en un sens qui rompt radicalement
avec l'acception commune. Car ce plaisir est un équilibre, et mieux encore un équilibre
d’équilibres. Pour être heureux, il convient d’abord de ne manquer de rien physiquement (c’est ce
qu’on appelle l’aponie). Il convient tout autant d’être "équilibré" du point de vue mental, ou
moral (c’est ce qu’on appelle ici l’ataraxie). De sorte que le plaisir en quoi consiste le bonheur est
la conjugaison de l’aponie et de l’ataraxie en quoi réside l’autarcie, c’est-à-dire l’état du sage qui se

suffit à lui-même. Cela ne signifie nullement, et c’est tout l’intérêt de la morale du fondateur du
Jardin, qu’il faille se priver de tout et vivre dans la frustration pour être heureux, ce qui serait
contradictoire. Cela veut dire qu’il faut agir sur soi, travailler ses pensées et sur ses pensées afin de
se libérer des désirs qui, prenant pour objet le superflu, nous enchaînent et nous empêchent de
vivre tranquilles. Le maître mot de l’action que doit entreprendre celui qui veut accéder au
bonheur est celui d'une technique qui n'est autre qu'une métrétique sélective des désirs. Car moins on
désire plus on a de chances de ne pas souffrir du manque de ce que l’on n’a pas. Quand bien
même nous ne pourrions obtenir tout ce qui pourrait nous faire envie, il est en notre pouvoir de
diligenter nos affects afin d’être libres en étant libérés des biens et des vanités dont la plupart des
hommes sont prisonniers. L’ascèse épicurienne est donc une entreprise qui conjugue la
profondeur de la réflexion et la fermeté de la volonté, lesquelles rendent la liberté accessible à
condition qu’on se délivre de la passion et que l’on conduise ses pensées, de façon maîtrisée, bref
qu’on agisse, et qu’on agisse authentiquement.
Le stoïcisme, ou comment une simple distinction rend possible la construction
d’une citadelle intérieure.
Disons le tout de suite, point n’est question ici de nous livrer à un exposé exhaustif de la
pensée stoïcienne qui, de Zénon de Cittium à Marc-Aurèle, a largement influencé la culture
gréco-romaine. Nous voudrions uniquement ici revenir à la distinction-clé opérée par Épictète
qui, dans ses Entretiens, nous propose de distinguer les choses qui dépendent de nous et celles qui
n’en dépendent pas. Car si les hommes sont malheureux, c’est parce qu’ils passent leur temps à
s’occuper des choses qui ne dépendent pas d’eux et négligent celles qui en dépendent. Or, qu’est-
ce qui dépend de nous sinon nos pensées, toutes nos pensées et rien que nos pensées? De sorte
qu’au lieu de me désespérer lorsque je ne peux satisfaire un désir à la satisfaction duquel j'ai
employé tous les moyens possibles, la sagesse me commande plutôt d’agir sur ce désir en y
renonçant, et donc de me libérer du malheur en trouvant le bonheur qui n’est autre ici que celui
de se délivrer des affects dont nous pensons à tort que nous n’avons sur eux aucun empire. Ne
pas subir le maheur mais agir et s’en délivrer. Ne pas subir nos pensées comme si elles étaient par
nature ingouvernables mais au contraire transformer ce que nous vivons ordinairement sous le
mode de la passion en action de la pensée sur elle-même et sur les actions qu’elle peut, de fait,
piloter, tel est le point central autour duquel gravite le volontarisme stoïcien qui définit la liberté,
d'une part comme celle d'un sujet pensant, et d'autre part comme le pouvoir d'agir, c'est-à-dire,
premièrement de maîtriser ses pensées, et deuxièmement d'influer par elles sur ses agissements.
Le scepticisme, ou la sagesse de l'indifférence
Le scepticisme est une doctrine qui, loin d’être réductible au paradoxe selon lequel, si rien
n’est certain, alors il est incertain que rien ne soit certain, conjugue avec une salutaire radicalité les
exigences de la pensée et l’ambition du bonheur dont l’idéal consiste en un état d’indifférence à
l’égard de toute chose. Car il s’agit, du point de vue sceptique, de prendre la mesure du
phénomène de l’inquiétude qui empêche l’homme d’être heureux. D’où viennent, en effet, la
plupart de nos tourments, sinon de notre propension à juger des choses pour distinguer celles qui
sont bonnes et désirables et celles que, mauvaises, nous devons fuir ? Ainsi souffrons-nous de ne
pas posséder ce que nous jugeons enviable et (comme le souligne Sextus Empiricus) de la
crainte de perdre ces mêmes choses que nous jugeons bonnes. Or, comment ne pas voir que seul
celui qui « ne se prononce ni sur ce qui est naturellement bon ni sur ce qui est naturellement
mauvais ne fuit rien et ne se dépense pas en vaines poursuites »? Comment connaître la paix de
l’âme sinon en renonçant à la crainte et au désir? Ce que le sceptique préconise est l’époché, c’est-à-
dire la suspension du jugement et donc de l’adhésion aux discours philosophiques dogmatiques.
Ainsi le mode de vie sceptique exige-t-il, lui aussi, des exercices de pensée et de volonté par
 6
6
 7
7
1
/
7
100%