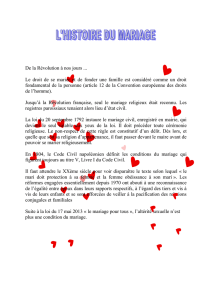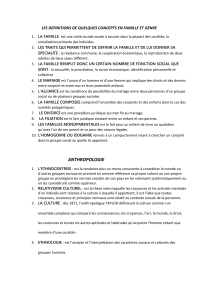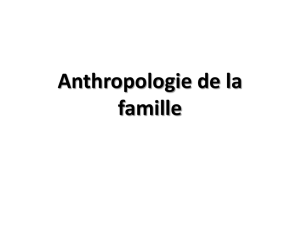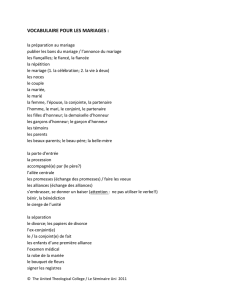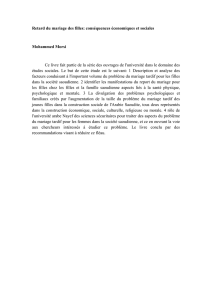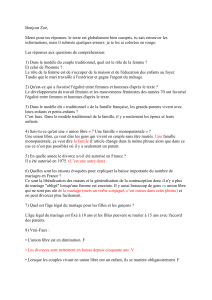L`étranger, la veuve et l`orphelin - Défense des Enfants DEI

1
L'étranger, la veuve et l'orphelin
A propos de l'exclusion sociale
et de diverses manières de ne pas y remédier
Introduction générale aux trois conférences
Hammourapi contre Thrasymaque
Nous sommes au bord de l’empire babylonien d’Hammourapi, au bord d’un désert brûlant, il
y a 3.700 ans. Ici se dresse une des stèles que le roi a fait déposer aux quatre coins des
immenses territoires qu’il a conquis, sur laquelle sont gravées 282 prescriptions. C’est le
« Code d’Hammourapi ». Comme tout pouvoir a besoin de se justifier, il écrit sur le haut de la
colonne : « Je suis Hammourapi, le roi protecteur. Je suis le berger qui sauve, dont la houlette
est droite, la bonne ombre qui s'étend sur la cité. C'est afin que le plus fort ne puisse porter
préjudice au plus faible, afin de protéger la veuve et l'orphelin, que j'ai conjugué ces précieux
mots qui sont les miens, écrits sur ma pierre funèbre, devant mon image, en tant que roi de
Justice. »
Nous sommes sur la montagne du Sinaï, il y a 3.300 ans. Dans une mise en scène formidable
de nuées, de tonnerre et d’éclairs, Yahvé donne à Moïse la loi qui achèvera de constituer le
peuple qu’il a élu. Parmi les 613 prescriptions, gravées dans la pierre pour qu’elles ne soient
jamais oubliées, figure celle-ci : « Tu n’exploiteras ni n’opprimeras l’émigré, car vous avez
été des émigrés au pays d’Egypte. Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. »
(Ex 22, 22).
Pourquoi cette insistance sur l’étranger, la veuve et l’orphelin ? Parce que, bien sûr, sont
concernées des catégories sociales précarisées, toujours menacées d’exclusion ou de privation
de leurs droits.
L’étranger ne bénéficie pas de la « nationalité », cette pure abstraction juridique qui, dans les
lois, différencie les humains bien plus gravement que la couleur de leur peau, leur âge, leur
sexe. Mon lieu de naissance, le temps de ma naissance, l’identité de ceux qui m’ont donné le
jour, constituent mon « état civil » et sont dépendants de données concrètes. Ma nationalité est
une pure fiction juridique inventée par les hommes. Or la nationalité penche depuis toujours
vers le nationalisme plutôt que vers le patriotisme, cet attachement légitime à la terre de ses
pères. Suivant la formule connue de Romain Gary, « Le patriotisme, c'est l'amour des siens.
Le nationalisme, c'est la haine des autres.1 » La veuve est celle qui n’a plus d’homme à ses
côtés, pour la protéger et pour l’aider à nourrir ses enfants. On dit aujourd’hui « famille
monoparentale ». L’orphelin est celui qui n’a pas de parents qui pourvoient à ses besoins et
l’élèvent vers l’âge adulte, celui qui est déguisé en faux adulte, en adulte en réduction, privé
1 R. GARY, Education européenne, Paris, Gallimard [collection Folio n° 203], 1956, p. 246.

2
d’enfance ou d’adolescence, parce qu’il doit survivre et parfois faire survivre ses frères et
sœurs. Souvent, la manière dont il tente de faire face aux difficultés de son existence dérange.
Bref, la loi protège l’étranger, la veuve et l’orphelin parce qu’ils sont faibles. En réalité, tous
sont des pauvres, mais en un sens plus profond que celui qui concerne une situation
économique, et beaucoup plus proche de ce qu’ils vivent, le sens que la Tora donne au mot
‘Anawim que nous avons traduit en français par « pauvres ». Dans une culture aussi
matérialiste que la nôtre, « pauvre » signifie d’habitude « désargenté », mais la pauvreté est
bien plus grave que cela. « Pauvre » renvoie d’abord non pas à la dépossession mais à
l’infériorité sociale, signifiant courbé, plié face aux autres, humilié, ou encore « qui est en
situation de devoir répondre »2.
Nous sommes à Athènes, vers 450 avant J.-C. Les sophistes ont inventé l’université. Ils
proposent aux jeunes gens, contre un minerval, des cours qui complèteront le parcours
scolaire classique des enfants, incluant la gymnastique, la musique, l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. Il s’agit, comme dans nos facultés de droit aujourd’hui d’apprendre en
plus ce qu’est la loi et surtout l’argumentation, le raisonnement, la manière de convaincre les
tribunaux ou ceux qui commandent la cité. Les rapports entre loi et justice sont l’objet de
discussions constantes et passionnées, d’autant que la démocratie athénienne permet la liberté
du discours et autorise toutes les critiques. Les sophistes sont ainsi parmi les premiers à étayer
notamment cette thèse qui aujourd'hui prétend plus que jamais rendre compte de toutes les
relations sociales : la loi n'est pas la copie d'une justice transcendante, inscrite dans un
ailleurs, mais le résultat d'une convention, d'un contrat conclu entre les citoyens.
Platon met en scène, au début de La République, la rencontre entre le sophiste Thrasymaque
de Chalcédoine et Socrate3 :
Écoute donc, dit [Thrasymaque]. Voici ce que, moi, je déclare être la justice :
rien d'autre que ce qui profite au plus fort. (...) Les lois établies par chaque
gouvernement le sont en vérité par rapport à son profit, lois démocratiques par
la démocratie (les Grecs entendaient « démocratie » comme pouvoir des classes
inférieures), tyranniques par la tyrannie, et de même par les autres régimes.
Puis, ayant établi ces lois, ils ont fait voir que la justice pour les gouvernés
consiste en ce qui est leur profit, pour eux-mêmes, les gouvernants. Et celui qui
la transgresse, ils le châtient pour avoir enfreint la loi, pour avoir commis une
injustice. Voilà donc, homme excellent, ce que, identiquement dans toutes les
Cités sans exception, j'entends qu'est la justice, à savoir ce qui est profitable au
gouvernement en place. Or, c'est lui qui a le pouvoir ; d'où il résulte, pour qui
raisonne correctement, que partout c'est la même chose qui est juste, celle qui
profite au plus fort.
Depuis des milliers d’années s’affrontent ainsi ces deux courants : le droit doit protéger le
faible ; le droit n’est que le langage des forts. Henri Lacordaire prononçait cette célèbre
phrase en 1848 : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le
serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.4 » Contre Lacordaire, après
2 Voy. A. GEORGE, « La pauvreté dans l’Ancien testament », dans (Coll.), La pauvreté évangélique, Paris, Cerf,
1971, p. 15.
3 338c-339a.
4 Conférences de Notre-Dame de Paris, tome III, 52e conférence, Du double travail de l’homme, 16 avril 1848.

3
Thrasymaque : Machiavel, qui explique avec un réalisme total comment prendre le pouvoir et
s’y maintenir, notamment par le droit ; Nietzsche, pour qui le droit est la manière dont les
forts, ceux qui sont capables de dire oui à la vie, dominent les faibles qui en sont incapables ;
Marx, pour qui le droit est, avec la religion, le moyen privilégié de justifier et de maintenir le
pouvoir des exploiteurs sur les exploités ; et tant d’autres qui nous diront que le droit est
menteur, même dans les démocraties modernes, peut-être surtout dans ces démocraties qui
sont théoriquement, à l’origine, ces Etats où le pouvoir se trouve entre les mains des pauvres.
Alors, dans la Belgique d’aujourd’hui ? Notre droit protège-t-il les faibles ou les forts ? Nos
lois permettent-elles l’inclusion sociale des étrangers, des femmes et des enfants ? Qui a
raison ? Hammourapi ou Thrasymaque ?
Pauvreté et exclusion sociale
Mais pour régler la balance Ŕ qui se veut d’ailleurs symbole de cette justice tant recherchée Ŕ
il faut mettre ses idées au clair sur ce qu’est l’exclusion sociale et la précarité, et dire un mot
des moyens habituellement utilisés par le pouvoir lorsqu’il veut y remédier, ou qu’il prétend y
remédier.
L'analyse de certaines relations sociales en termes d'exclusion est une insistance qui remonte
aux années quatre-vingts. Elle vise à sortir les questions de précarité et de pauvreté de la seule
dimension financière et économique. A cet égard, elle a largement échoué, puisque toutes les
instances s’obstinent à considérer que la pauvreté est essentiellement une question de porte-
monnaie, de quantification, de dénombrement. Il est pourtant évident que la position du
« courbé » par rapport à ceux qui le regardent de haut, n’est pas la situation économique d’une
espèce de monade plus pitoyable que les autres, considérée individuellement. S’il suffisait de
donner de l’argent aux pauvres pour supprimer la pauvreté, la question serait réglée depuis
longtemps. Elle renvoie d’abord et avant tout à une relation, une relation sociale négative. On
n’est jamais pauvre que par rapport à d’autres. Dans bien des pays, spécialement au Sud,
beaucoup de personnes ne possèdent presque rien. Elles n’en sont pas socialement exclues
pour autant, ou du moins ne sont-elles exclues ou pauvres que par rapport aux riches de chez
elles ou aux riches des pays riches.
Une des fécondités de l'approche des phénomènes sociaux en termes d'exclusion, et donc du
droit qu’ils appellent, est de substituer à une vision quantitative et statique une appréhension
qualitative et dynamique, focalisée précisément sur la relation sociale. Le terme « exclusion »
veut littéralement signifier « enfermé au-dehors » (de ex- « en dehors » et claudĕre,
« fermer »). Il résiste à l'idée de pur constat, à la représentation d'une situation figée. Il appelle
nécessairement celle de mouvement : sortie de la clôture, de l'enceinte commune et
protectrice ; à l'inverse, l’inclusion correspond à un effort pour entrer, pour ouvrir une porte,
voire pour la forcer.
L’exclusion « sociale » est, quant à elle, exclusion de la société. C'est à la fois trop dire parce
que dans une société comme la nôtre, qui n’est heureusement pas celle du nazisme, on ne peut
être totalement exclu de la société, notamment en raison de la reconnaissance de droits
fondamentaux attachés à la seule qualité d’être humain. Mais ce n’est pas assez dire puisque
l'imprécision demeure quant à savoir de quoi certains sont exclus. En dehors de quoi l'exclu
est-il enfermé ? « Social » et « société », dérivés de socius, et societas, renvoient à « allié »,
« ami », « amitié ». L'exclusion sociale est l'assignation en dehors d'une relation d'alliance et
d'amitié.

4
Le droit a-t-il quelque chose à voir avec ces élucubrations étymologiques ? Platon, qui
s’oppose à Thrasymaque à travers ce qu’il fait dire à Socrate, l’affirme sans hésiter : « Le but
auquel visent fondamentalement nos lois, c'est, nous le savons, de rendre les citoyens le plus
heureux possible et, au plus haut point, amis les uns des autres5 ». Voilà donc une nouvelle
manière de poser la question : nos lois belges font-elles des étrangers, des femmes et des
enfants, nos amies ou nos amis ? La démocratie belge fait-elle mieux que la démocratie
athénienne, qui excluait précisément de la citoyenneté, de la communauté d’amis, les femmes,
les enfants, les étrangers et, bien sûr, les esclaves ?
Contrat social versus respect et dignité
Ceux qui admettent que le droit peut contribuer à redresser le courbé, à lutter contre la
précarité et la pauvreté, à valoriser le rapport social, ont classiquement essayé deux méthodes.
La première a pour postulat que la relation sociale est un contrat, mécanisme d’ailleurs
typiquement juridique s’il en est. Article 1134, au centre de notre Code civil : « Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » C’est le point
de vue des sophistes, on l’a dit, ce sera aussi celui des contractualistes des XVIIe et XVIIIe
siècles : Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau, chacun à leur manière. La deuxième méthode
consiste, à l’inverse, à soutenir que l’inclusion sociale ne peut jamais faire l’objet d’un
échange contractuel, et à tenter de travailler sur la qualité de la relation sociale en exigeant
que celle-ci soit empreinte de respect. C’est la position que défendra Kant. Le respect est
aussi une notion dont le droit s’est emparée. Article 22bis de la Constitution, par exemple :
« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. ».
D’ailleurs la base de la démocratie est le respect du droit lui-même.
Première approche : la société, la relation sociale, se forment et s’expliquent par le contrat,
par le contrat « social ». La question présupposée est : « Comment se fait-il que le lien social
se crée ? », et pas « Comment se fait-il que le lien social se perd ? ». L’hypothèse est que
chacun est d’abord seul et non que le lien est toujours déjà là. Ou, plus trivialement, on
demande « Comment entrera-t-il ? » plutôt que « Pourquoi est-il sorti ? ». Si la réponse est :
une société se forme par contrat social, la solution qui découle nécessairement de cette
conception consiste à multiplier les contrats et à veiller à ne pas oublier d’en proposer aux
pauvres et aux exclus. Or, au XXIe siècle, nous demeurons plus que jamais dans cette logique,
qui relève d’ailleurs d’une espèce de « management » de la société. On dit aujourd’hui
« contrat d’intégration » : en échange de vos engagements et de vos efforts, vous aurez droit à
l’aide censée garantir la dignité humaine. Mais toute la vie sociale, juridique, politique
devient contrat : « contrat d’avenir pour la Wallonie », « contrat de gestion entre le
gouvernement et l’AWIPH », « contrat de rivière », « contrat de quartier », « contrat
pédagogique » entre professeurs et étudiants, parfois « contrat » entre parents et enfants.
2 Les lois, tr. fr. par L. ROBIN, Paris, Gallimard (La Pléiade), 1950, V, 743c; v. aussi III, 693b, V, 739c ; La
République, IV, 424a et V, 449c; Gorgias, 507e. On trouve la même insistance chez Aristote : « Dans toute
association, quelle qu'elle soit, on trouve à la fois la justice et l'amitié (philia) dans un certain degré. Ainsi, l'on traite
comme des amis ceux qui naviguent avec vous, ceux qui combattent près de vous à la guerre, en un mot, tous ceux
qui sont avec vous dans des associations d'un genre quelconque. Aussi loin que s'étend l'association, aussi loin s'étend
la mesure de l'amitié, parce que ce sont là aussi les limites de la justice elle-même. Le proverbe 'Tout est commun
entre amis' est bien vrai, puisque l'amitié consiste surtout dans l'association et la communauté. » (Éthique à
Nicomaque, tr. fr. par B. SAINT-HILAIRE, 1837, VIII, 11.)

5
Les étrangers, les veuves et les orphelins rencontrent cependant, avec la contractualisation de
l’inclusion sociale, un grave problème. Les conditions de validité des conventions, Hobbes,
Locke ou Rousseau en ont conscience, sont la liberté et l'égalité en droit. Or, elles n'existent
pas pour les courbés. Voltaire soulignait que « Tous les hommes seraient donc nécessairement
égaux s'ils étaient sans besoins. La misère attachée à notre espèce subordonne un homme à un
autre homme. 6 » La Révolution française qui a fondé nos Etats actuels, les penseurs
modernes, puis le législateur jusqu'à ce jour, pour justifier la contractualisation, seront dès lors
contraints de supposer cette liberté et cette égalité souvent inexistantes. Ecoutons par exemple
Hobbes : « La nature a fait les hommes si égaux quant aux facultés du corps et de l'esprit, que,
bien qu'on puisse parfois trouver un homme manifestement plus fort, corporellement, ou d'un
esprit plus prompt qu'un autre, néanmoins, tout bien considéré, la différence d'un homme à un
autre n'est pas si considérable qu'un homme puisse de ce chef réclamer pour lui-même un
avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui.7 » Le « contrat » suppose une
égalité et une liberté, qui, pour les plus faibles socialement, risquent toujours d'être fictives. Il
a pour conséquence que le prétendu pacte se retourne contre eux la plupart du temps.
Dans notre droit, l’autre voie, celle du respect, a aussi été essayée. Mais respect de quoi ? Et
que veut dire « respect » ? Le maître, à cet égard, est Immanuel Kant 8. De manière
significative, il déploie sa méditation contre l’idée de contrat, si chère à ses prédécesseurs et à
ses contemporains, parmi lesquels Rousseau qu’il admire pourtant. Kant fait observer que
n’importe quoi ne peut faire l’objet d’un échange. Ce qui ne peut se contractualiser, ce qu’il
faut respecter de manière inconditionnelle, c’est, écrit-il, la dignité, qui n’appartient qu’à
l’humanité : « Dans le règne des fins, tout a un PRIX ou une DIGNITÉ. Ce qui a un prix peut être
aussi bien remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent (donc faire l’objet d’un
contrat) ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent,
c’est ce qui a une dignité (...) L'humanité est par elle-même une dignité : l'homme ne peut être
traité par l'homme (soit par un autre, soit par lui-même), comme un simple moyen, mais il doit
toujours être traité comme étant aussi une fin. C'est précisément en cela que consiste sa dignité
(la personnalité), et c'est par là qu'il s'élève au-dessus de tous les autres êtres du monde qui ne
sont pas des hommes et peuvent lui servir d'instruments, c'est-à-dire au-dessus de toutes les
choses.9 » Quant au respect, c’est encore Kant, le plus juriste des philosophes, qui va le plus
loin : « Le respect ne s’adresse jamais qu’à des personnes10 », même si nous sommes toujours
tentés de le refuser et qu’il est fondamentalement « effrayant » parce qu’il nous montre notre
propre indignité11.
6 Dictionnaire philosophique, article Egalité, 1764.
7 Th. HOBBES, Léviathan, tr. fr. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1983, p. 121. Voy. aussi J. LOCKE, Traité du
gouvernement civil, tr. fr. de D. Mazel, Paris, Flammarion, 2e éd. Corrigée, 1992, § 4. Voy. aussi, entre autres,
§ 95 et 123 ; J.-J. ROUSSEAU, Du contract social ou principes du droit politique, dans Œuvres complètes, Paris,
NRF Gallimard [Bibliothèque de La Pléiade], 1964, ch. VI. Du même, Emile ou de l'éducation, livre III, éd.
établie par M. LAUNAY, Paris, Garnier Flammarion, 1966, p. 245.
8 Dès 1764, dans ses Observations sur le sentiment du beau et du sublime, Kant fonde la vertu sur un sentiment
universel, « le sentiment de la beauté et de la dignité de la nature humaine », le sentiment de beauté constituant
un principe de bienveillance universelle et celui de dignité un principe de respect universel (E. KANT, Œuvres
philosophiques, Paris, N.R.F.-Gallimard [bib. de La Pléiade], t. Ier, tr. fr. B. LORTHOLARY, 1980, p. 463.)
9 Métaphysique des mœurs, première partie, Doctrine du droit, tr. fr. A. PHILONENKO, Paris, Vrin, pp. 160-162.
C’est Kant qui souligne.
10 Critique de la raison pratique, p. 80.
11 Ibidem.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
1
/
49
100%