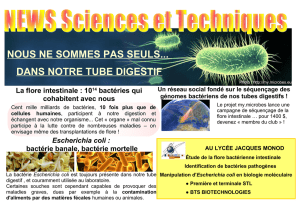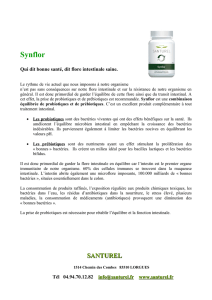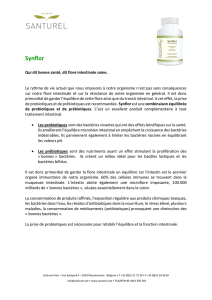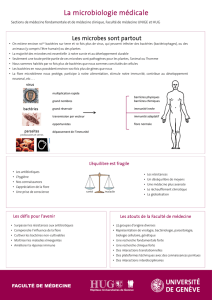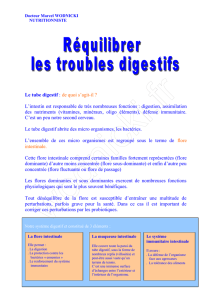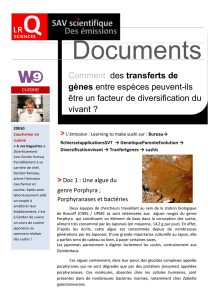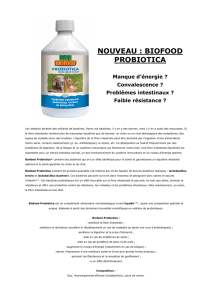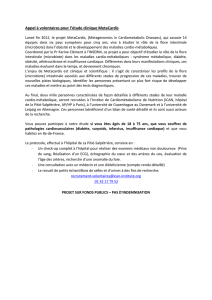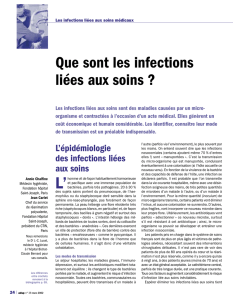Flore intestinale et pathologie infectieuse humaine

Rev.
sci.
tech.
Off.
int.
Epiz., 1989, 8 (2), 405-415.
Flore intestinale
et pathologie infectieuse humaine
C.
TANCRÈDE *
Résumé: L'intestin de l'homme et sa flore microbienne constituent un
écosystème complexe
dont
l'équilibre
est
un
exemple remarquable
d'adaptation
réciproque. Les bactéries intestinales jouent un rôle important dans le
développement
du système
immunitaire.
La flore
intestinale normale exerce
des
fonctions de
résistance
à la colonisation par des
micro-organismes
exogènes
pathogènes.
Elle constitue
néanmoins un
réservoir
de bactéries potentiellement
pathogènes au contact immédiat de l'hôte. Ces
bactéries
sont responsables
d'infections opportunistes en
cas
de déficit
immunitaire.
Les perturbations de
l'équilibre de la flore par les antibiotiques sont à l'origine d'infections dues à
la
prolifération de
bactéries
pathogènes
résistantes.
La flore
intestinale
et ses
interactions avec les
aliments jouent
également
un
rôle
dans d'autres domaines
tels que la nutrition et la survenue de
cancers
du côlon.
MOTS-CLÉS : Flore intestinale - Homme - Pathologie infectieuse -
Translocation bactérienne.
INTRODUCTION
Un simple
épithélium
sépare l'intérieur de l'organisme, stérile, d'un des écosystèmes
bactériens les plus peuplés de la planète : la lumière intestinale. L'épithélium de
l'intestin «mis à plat» représenterait une superficie de plus de 200 m2. Cette interface
isole les 1013 cellules eucaryotes de l'organisme hôte des 1014 cellules bactériennes
vivantes - appartenant à environ 450 espèces différentes - qui composent la flore
microbienne du tractus
digestif.
Il existe des différences majeures dans la composition
de la flore intestinale de chaque espèce animale et de l'homme, mais chez tous les
sujets d'une même espèce cette composition est très stable et étroitement adaptée à
l'hôte. On qualifie de «flore normale», ou encore autochtone, ou endogène, l'ensemble
des espèces présentes de façon constante dans l'écosystème intestinal et capables de
s'y multiplier sans entraîner de manifestations pathologiques chez l'hôte. Il est
pratiquement impossible d'en donner une définition exhaustive.
Les études qualitatives et quantitatives de la flore intestinale permettent de définir
le profil général de ces populations. On observe d'importantes variations en fonction
de l'étage du tube digestif avec un gradient croissant dans le sens oro-anal. Après
une importante réduction du nombre des bactéries ingérées par l'acidité gastrique,
on trouve peu de bactéries dans le duodénum (environ 104 ufc/ml). Il
s'agit
surtout
de bactéries anaérobies facultatives, telles que Escherichia coli et streptocoques.
* Institut Gustave-Roussy, Service de Microbiologie médicale, 39, rue Camille Desmoulins, 94805
Villejuif Cedex, France.

406
L'adhésion à la muqueuse permet à une population de se maintenir dans cette zone
à transit rapide. Au long de l'intestin grêle, la densité de population augmente
progressivement pour atteindre 107 ufc/ml dans l'iléon terminal où l'on trouve une
majorité de bactéries anaérobies strictes. C'est après la valvule de Bauhin, dans le
caecum et le côlon, qu'on dénombre 1011 cellules bactériennes vivantes. Le concept
d'écosystème, «ensemble de toutes les populations vivantes et de tous les composants
inertes interférant dans une région de l'espace et du temps», s'applique au tube digestif
et aux populations microbiennes qu'il abrite. Il
s'agit
d'un écosystème hautement
intégré aux interactions multiples. Toute modification de l'un ou l'autre de ses
constituants est susceptible de perturber l'équilibre et le fonctionnement de l'ensemble
de l'écosystème, avec les conséquences pathologiques qui peuvent en découler. La
masse vivante des bactéries intestinales représente une activité métabolique d'une
importance quantitativement comparable à celle du foie. On a longtemps pensé que
les bactéries de l'intestin étaient indispensables à la vie de l'hôte, qu'elles intervenaient
dans les processus de la digestion des aliments et que, sans elles, la plupart de ceux-ci
ne pourraient pas être assimilés. Cette conception était compatible avec les découvertes
de Pasteur sur le rôle des micro-organismes dans les fermentations. Metchnikoff ne
voyait au contraire dans la flore intestinale qu'une source de morbidité, d'infection
chronique, de «toxémie» susceptible d'abréger la longévité de l'hôte. L'idée que
l'implantation de certains lactobacilles dans le tube digestif de l'homme pourrait
contrebalancer les effets néfastes de la flore dite de «putréfaction» fut même très
en vogue au début de ce siècle.
La compréhension des interactions entre l'hôte et sa flore a beaucoup progressé
au cours des dernières décennies grâce à la reconnaissance des caractères de
pathogénicité des bactéries et des mécanismes de réponse de l'hôte à la présence de
ces bactéries dans son tube
digestif.
Le modèle expérimental privilégié que constituent
les animaux axéniques («germ-free») et gnotoxéniques (n'hébergeant qu'une ou
plusieurs espèces microbiennes connues) a été un apport considérable dans ce domaine.
On sait aujourd'hui que la vie est possible sans germes : les souris axéniques présentent
quelques caractéristiques physiologiques qui les différencient de leurs congénères
pourvues d'une flore normale. Leur longévité est plus grande, mais on sait aussi que
la flore joue un rôle protecteur en s'opposant à la colonisation de l'hôte par des micro-
organismes exogènes pathogènes et que les perturbations de cette flore exposent à
des accidents. L'impact écologique des antibiotiques sur la flore, les déficits
immunitaires de l'hôte, spontanés ou consécutifs à une thérapeutique, sont autant
de facteurs qui perturbent l'équilibre harmonieux entre l'homme et ses bactéries
intestinales. Les circonstances ainsi créées peuvent amener une bactérie réputée non
pathogène à être responsable d'une authentique infection. La notion d'opportunisme
en pathologie infectieuse
s'est
considérablement développée. L'infection n'est pas le
seul exemple dans lequel les interactions entre l'hôte et sa flore revêtent une grande
importance. Nutrition, cancer, sont des domaines dans lesquels ces interactions ont
un intérêt de plus en plus reconnu.
FLORE INTESTINALE ET INFECTIONS
Réaction de l'hôte aux bactéries pathogènes intestinales
Un raisonnement anthropocentrique considère traditionnellement la bactérie
comme l'agresseur de l'hôte dans le conflit infectieux. Il est tout aussi objectif de

407
constater que c'est la nature de la réaction de l'hôte qui permet d'observer le pouvoir
pathogène d'un micro-organisme qui pénètre dans son tube
digestif.
Sans cette
réaction, on ne pourrait d'ailleurs pas définir ce pouvoir pathogène. Les principales
modalités de réponse de l'hôte à une bactérie présente dans la lumière intestinale
comportent :
- La présence sur les entérocytes de récepteurs permettant la fixation de structures
de surface de la bactérie (pili, fimbriae...). L'adhésion de la bactérie à la muqueuse
autorise sa multiplication in situ, sans être entraînée par le transit intestinal. Si cette
bactérie élabore une exotoxine, celle-ci est libérée au contact immédiat de l'entérocyte.
Si de surcroît celui-ci offre un récepteur à cette toxine, celle-ci peut exercer son effet
néfaste sur le fonctionnement de l'entérocyte et provoquer une diarrhée.
- La phagocytose de la bactérie par une cellule intestinale constitue la première
étape d'un processus
invasif.
Le devenir ultérieur de la bactérie dans l'espace intra-
épithélial
dépend de son aptitude à survivre et éventuellement à se multiplier dans
les cellules phagocytaires (macrophages). La bactérie parvenue vivante dans le ganglion
lymphatique mésentérique a la possibilité de gagner d'autres organes, foie, rate, et
la circulation générale.
- Les réponses immunologiques de l'hôte à un antigène bactérien qui a franchi
l'épithélium intestinal comportent la production d'immunoglobulines spécifiques et
le développement d'une immunité cellulaire. La réaction ultérieure de l'hôte à la
présence de la même bactérie dans son tube digestif sera ainsi modifiée et s'exprimera
par des réponses immunitaires spécifiques.
Si la bactérie ne suscite aucune de ces réponses de la part de l'hôte, son avenir
est strictement intraluminal et ne comporte pas d'événements pathologiques.
Les principales maladies bactériennes du tube digestif
Pratiquement, c'est la reconnaissance d'un dysfonctionnement intestinal, ou d'une
atteinte d'autres organes, ou de l'organisme dans son ensemble qui exprime la réaction
de l'hôte à la présence d'une bactérie qui sera considérée comme pathogène. On peut
classer schématiquement les principales bactéries pathogènes pour l'intestin de
l'homme en fonction du mécanisme de leur pathogénicité, c'est-à-dire du mode de
réponse de l'hôte à leur présence (7).
- Les atteintes non inflammatoires de l'intestin touchent essentiellement le grêle
proximal. Elles sont dues à des entérotoxines produites par les bactéries. Le principal
symptôme est une diarrhée aqueuse qui peut entraîner une déshydratation. L'exemple
type est le choléra. Vibrio cholerae adhère aux entérocytes et peut ainsi se multiplier
abondamment à la surface du grêle. Un glycolipide de surface des entérocytes, le
ganglioside GMI, sert de récepteur à la toxine cholérique qui provoque une
hypersécrétion de suc entérique dont l'expression finale est la diarrhée. D'autres
bactéries provoquent des symptômes analogues par des mécanismes comparables :
Vibrio parahaemolyticus, E. coli producteurs d'entérotoxine thermolabile (LT) très
voisine de celle de V. cholerae, ou thermostable (ST), certaines Salmonella spp.
- Les atteintes inflammatoires de l'intestin, avec processus invasif de la muqueuse,
touchent principalement le côlon et se manifestent par une dysenterie. La présence
de leucocytes polynucléaires, de cellules intestinales, d'hématies dans les selles reflète
la nature invasive du processus. L'exemple type est représenté par les shigelles. La
caractéristique d'une souche virulente de Shigella sp. est sa capacité d'envahir les

408
entérocytes du côlon. D'un autre point de vue, cette souche pathogène présente une
structure de surface qui suscite la phagocytose par l'entérocyte. Il a été démontré
que cette structure était codée par un plasmide (5).
D'autres bactéries provoquent des atteintes semblables de la muqueuse colique :
E. coli entéro-invasifs, Campylobacter jejuni-coli, Salmonella enteritidis... et aussi
Clostridium difficile qui sera évoqué à propos des conséquences de l'antibiothérapie.
- Les «fièvres entériques» concernent essentiellement l'iléon terminal, la région
des plaques de Peyer. Elles sont dues à des bactéries qui ont la capacité de pénétrer
jusqu'au ganglion lymphatique mésentérique et de là dans le foie, la rate et la
circulation générale. Le passage de bactéries viables de la lumière du tube digestif
dans les lymphatiques mésentériques et dans d'autres organes a été dénommé
«translocation». Le rôle qu'il peut jouer dans le développement de l'immunité contre
les bactéries intestinales, mais aussi dans la survenue d'infections opportunistes chez
les immunodéficients, sera envisagé plus loin. La bactérie par excellence capable de
translocation chez l'homme est Salmonella typhi. Plus que la multiplication du germe
dans des foyers septiques secondaires, c'est le relargage de lipopolysaccharide de S.
typhi dans l'organisme qui conditionne les manifestations d'intoxication par
l'endotoxine caractéristiques de la fièvre typhoïde.
Rôle de la flore intestinale dans la survenue des infections
Ces infections bactériennes intestinales, dues à des bactéries spécifiquement
pathogènes pour l'homme, sont observées avec une grande fréquence dans les pays
de la zone intertropicale où le climat et les mauvaises conditions d'hygiène favorisent
leur transmission. Les diarrhées restent une des premières causes de mortalité par
déshydratation et par malnutrition secondaire, en particulier chez les enfants de moins
de cinq ans, dans de nombreux pays. La célèbre «diarrhée des voyageurs» est
l'expression de ces infections chez les sujets de pays à hygiène développée qui se rendent
en zone intertropicale.
Ces bactéries spécifiquement pathogènes pour l'homme ne font pas partie de la
flore intestinale normale qui manifeste à leur encontre des «effets de barrière»
écologiques. Le rôle protecteur de la flore intestinale n'est cependant pas évident contre
ces infections. En effet, les fortes densités de bactéries anaérobies qui exercent la
fonction de résistance à la colonisation par des micro-organismes exogènes siègent
dans le côlon et le point d'action - ou la porte d'entrée - de ces germes pathogènes
est généralement situé en amont, dans le grêle, où les populations de bactéries
résidentes sont beaucoup moins denses.
L'acidité gastrique joue un rôle protecteur important en réduisant par un facteur
de l'ordre de 10-3 le nombre des bactéries potentiellement infectantes ingérées. Ce
rôle est bien démontré dans le cas de Vibrio cholerae vis-à-vis duquel les sujets qui
ont une achlorhydrie gastrique sont particulièrement réceptifs. D'autres facteurs
pourraient expliquer les très grandes variabilités dans la sensibilité individuelle à V.
cholerae observées au cours d'études chez des volontaires. Il pourrait
s'agir
de
différences génotypiques comme cela a été mis en évidence chez l'animal (14).
L'identification de caractères génétiques conditionnant des facteurs de risque est une
perspective intéressante qui permettra dans le futur de reconnaître dans une population
les sujets dont le génotype serait associé à un haut risque d'infection.

409
FLORE INTESTINALE ET TRANSLOCATION BACTÉRIENNE
Le rôle de la flore intestinale est cependant loin d'être négligeable : son rôle
modulateur dans la translocation des bactéries intestinales a clairement été mis en
évidence chez les animaux gnotoxéniques (2).
Arguments expérimentaux
Le contrôle du ganglion lymphatique mésentérique (GLM) de souris hébergeant
une flore normale exempte d'organismes pathogènes spécifiques (EOPS) ne permet
qu'exceptionnellement d'isoler des bactéries viables. Les principaux facteurs qui
favorisent la survenue d'une translocation ont été étudiés :
- pouvoir pathogène de la bactérie pour l'hôte,
- taille de sa population dans le caecum,
- perméabilité de la muqueuse intestinale,
- état immunitaire de l'hôte.
Le pouvoir pathogène de la bactérie pour l'hôte joue un rôle déterminant : une
heure après l'administration orale d'un inoculum modéré de Salmonella typhimurium
chez des souris EOPS en bonne santé, des bactéries viables sont déjà présentes dans
le GLM, malgré la réduction importante par l'acidité gastrique du nombre de bactéries
vivantes ingérées. Dans les mêmes conditions, malgré un inoculum plus important,
on n'observe pas de translocation avec d'autres entérobactéries, comme E. coli. Pour
obtenir la translocation de E. coli et d'autres bactéries de la flore normale de l'hôte,
il faut avoir recours à des souris axéniques qui ont un système immunitaire moins
développé que les animaux conventionnels, du fait de l'absence de contact antérieur
avec des bactéries. Dans ce modèle expérimental, on peut établir un classement
hiérarchique des espèces bactériennes en tenant compte de la fréquence de la
translocation (3). Pour diverses entérobactéries et Pseudomonas la fréquence dépasse
80 % avec une moyenne de plus de 50 bactéries par GLM. Les chiffres sont de 45 %
avec 10 bactéries par GLM pour Streptococcus faecalis, Lactobacillus brevis,
Staphylococcus epidermidis ; ils tombent à 30 % avec une bactérie par GLM pour
des anaérobies stricts tels que Bacteroides spp., Fusobacterium, Bifidobacterium
bifidum. Ce classement correspond dans l'ensemble au pouvoir pathogène potentiel
exprimé par ces différents germes vis-à-vis de l'hôte lorsqu'on provoque un déficit
immunitaire.
La taille de la population d'une bactérie dans la lumière du caecum influe sur
la translocation de celle-ci vers le GLM (17). Dans l'exemple précédent des souris
monoxéniques à E. coli :
a) l'implantation préalable d'une flore intestinale complexe de souris normale
limite le nombre de E. coli dans le contenu caecal (105/g au lieu de 109) et empêche
la translocation de cette bactérie vers le GLM ;
b) l'adjonction d'antibiotiques actifs sur les anaérobies dominants (l 10s
cellules/g de contenu caecal) de la flore et inactifs sur E. coli fait réapparaître une
population élevée de E. coli et on observe à nouveau une translocation de cette bactérie
vers le GLM. Ces démonstrations expérimentales soulignent deux faits dont
l'importance est largement reconnue en pathologie infectieuse humaine :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%