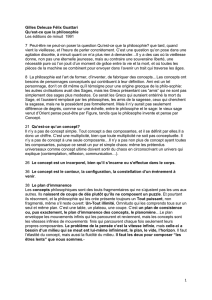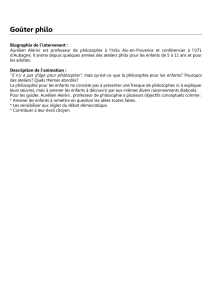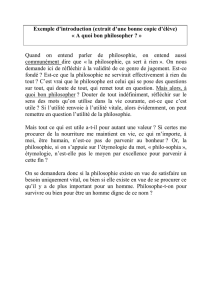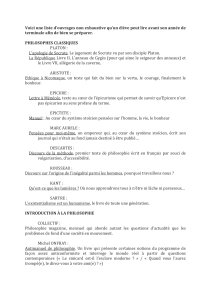LA PHILOSOPHIE EN QUESTION

1
LA PHILOSOPHIE EN QUESTION

2
QU’EST-CE QUE PENSER ?
1/ Penser, ce n’est pas croire que l’on sait
L’Apologie de Socrate est la relation faite par Platon (son « disciple ») du procès de Socrate et de la
défense du philosophe devant ses juges athéniens. Au terme du procès, Socrate sera condamné à
mort : il boira la ciguë, poison mortel, s’il en est. Que lui reproche-t-on ? D’avoir corrompu la jeunesse
athénienne en se réclamant d’une fausse sagesse. Dans ce passage, Socrate cherche à montrer que
cette accusation est calomnieuse et qu’il est victime d’une fausse réputation. Par-delà la défense de
Socrate et la volonté de souligner son exemplarité, l’enjeu de ce passage est de définir une certaine
exigence de pensée dont la philosophie se veut l’expression.
« Pour témoigner de ma sagesse, je produirai le dieu de Delphes, qui vous dira si j’en ai
une et ce qu’elle est. Vous connaissez sans doute Kairéphon. C’était mon camarade
d’enfance et un ami du peuple, qui partagea votre récent exil et revint avec vous. Vous
savez aussi quel homme c’était que Kairéphon et combien il était ardent dans tout ce
qu’il entreprenait. Or, un jour qu’il était allé à Delphes, il osa poser à l’oracle la question
que voici - je vous en prie encore une fois, juges, n’allez pas vous récrier -, il demanda,
dis-je, s’il y avait au monde un homme plus sage que moi. Or, la pythie lui répondit qu’il
n’y en avait aucun. Et cette réponse, son frère, qui est ici, l’attestera devant vous,
puisque Kairéphon est mort.
Considérez maintenant pourquoi je vous en parle. C’est que j’ai à vous expliquer
l’origine de la calomnie dont je suis victime. Lorsque j’eus appris cette réponse de
l’oracle, je me mis à réfléchir en moi-même : « Que veut dire le dieu et quel sens recèlent
ses paroles ? Car moi, j’ai conscience de n’être sage ni peu ni prou. Que veut-il donc
dire, quand il affirme que je suis le plus sage ? car il ne ment certainement pas ; cela ne
lui est pas permis ». Pendant longtemps je me demandai quelle était son idée ; enfin je
me décidai, quoique à grand-peine, à m’en éclaircir de la façon suivante : je me rendis
chez un de ceux qui passent pour être des sages, pensant que je ne pouvais, mieux que
là, contrôler l’oracle et lui déclarer : « Cet homme-ci est plus sage que moi, et toi, tu m’as
proclamé le plus sage ». J’examinai donc cet homme à fond ; je n’ai pas besoin de dire
son nom, mais c’était un de nos hommes d’Etat, qui, à l’épreuve, me fit l’impression dont
je vais vous parler. Il me parut, en effet, en causant avec lui, que cet homme semblait
sage à beaucoup d’autres et surtout à lui-même, mais qu’il ne l’était point. J’essayai alors
de lui montrer qu’il n’avait pas la sagesse qu’il croyait avoir. Par là, je me fis des ennemis
de lui et de plusieurs des assistants. Tout en m’en allant, je me disais en moi-même :
« Je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu’aucun de nous deux ne sache rien
de beau et de bon ; mais lui croit savoir quelque chose, alors qu’il ne sait rien, tandis que
moi, si je ne sais pas, je ne crois pas savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus
sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le
savoir. » Après celui-là, j’en allai trouver un autre, un de ceux qui passaient pour être
plus sage encore que le premier, et mon impression fut la même, et ici encore je me fis
des ennemis de lui et de beaucoup d’autres. »
PLATON, Apologie de Socrate (21c-22b, éditions GF, pp.31-32).
[Questions :
1. Qu’est- ce que Platon entreprend de définir et de distinguer dans ce passage ?
2. Comment Socrate réagit-il à la parole de l’oracle ? Et pourquoi ?
3. Que lui découvre la visite qu’il rend à un homme qui passe pour être très sage ?
4. Pourquoi cet homme qui passe pour être sage ne l’est pas selon Socrate ?
5. Qu’est-ce qui distingue donc la sagesse socratique de cette fausse sagesse ?
6. Si la philosophie est un savoir, en quel sens est-elle un savoir paradoxal ?
7. Dès lors, demandez-vous ce qu’implique l’acte de philosopher. En quelle mesure la
philosophie a-t-elle quelque chose à nous apprendre ?]

3
2/ La pensée : cet effort pour mettre en question tout ce que nous tenons pour
évident sans l’avoir interrogé, tout ce qui nous semble « bien connu ».
« Ce qui est bien-connu en général, justement parce qu’il est bien connu, n’est pas
connu. C’est la façon la plus commune de se faire illusion et de faire illusion aux
autres que de présupposer dans la connaissance quelque chose comme étant
bien-connu, et de le tolérer comme tel ; un tel savoir, sans se rendre compte
comment cela lui arrive, ne bouge pas de place avec tous ses discours. Sans
examen, le sujet et l’objet, Dieu, la nature, l’entendement, la sensibilité, etc., sont
posés au fondement comme bien-connus et comme valables ; ils constituent des
points fixes pour le départ et pour le retour. Le mouvement s’effectue alors ici et là
entre ces points qui restent immobiles, et effleure seulement leur surface. Dans ce
cas, apprendre et examiner constituent à vérifier si chacun trouve bien aussi ce qui
est dit dans sa représentation, si cela lui paraît bien ainsi, et est ou non bien
connu. L’analyse d’une représentation, comme elle était conduite ordinairement,
n’était autre chose que le processus de supprimer la forme de son être-bien-
connu. »
HEGEL, Phénoménologie de l’Esprit, (Préface, éditions Aubier, pp. 28-29)
[Questions :
1. La première phrase de Hegel a bien lieu de nous étonner parce qu’elle heurte un principe
fondamental de la logique. Quel est-il ? Quel nom donne-t-on à une telle forme ? Enfin, en
faisant fi ainsi de la logique, que veut signifier Hegel ? (pour vous aider à répondre à cette
question, référez-vous à l’article « contradiction » de la Philo de A à Z –Nathan)
2. Dès lors, contre quoi la pensée doit-elle se dresser ?
3. Comment pourrait-on définir le mouvement de la pensée en quête d’un savoir véritable ?]
3/ « Penser, c’est dire non » : c’est refuser le confort de la croyance.
Selon Alain, dans ces extraits de Propos sur les pouvoirs, celui qui cherche la vérité doit commencer
par s’affranchir de toute croyance. Croire, en effet, c’est tenir pour vrai une idée sans l’avoir mise à
l’épreuve, confondre la vérité avec l’évidence ou le prestige qui imposent une idée à notre esprit. Tout
pensée véritable, au contraire, commence par être sceptique : chercher la vérité, c’est commencer par
douter de toute idée que, par crédulité, nous ne soupçonnons pas. Ainsi, l’idée vraie n’est pas l’idée
qui soumet notre jugement (en nous séduisant ou bien en nous terrassant par l’autorité que lui confère
la tradition) ; c’est l’idée fondée en raison, c’est-à-dire l’idée dont notre jugement peut rendre raison
parce qui l’a soumise au doute. Le penseur ne reçoit pas passivement la vérité : il se la donne, non
pas arbitrairement (selon les caprices de son opinion) mais de telle façon que les raisons qui fondent
cette idée puissent être reconnues et partagées. Toute science du réel commence ainsi par soumettre
au doute les évidences que nous imposent nos sens.
Une pensée véritable est donc une pensée autonome : elle est libre parce qu’elle a éprouvé par elle-
même les raisons qui fondent la vérité qu’elle attribue à ses idées. Dès lors, si « penser, c’est dire
non », ce n’est pas dire non aux autres, mais à soi-même : combattre notre propre crédulité, qui nous
fait accorder une certitude à des idées sans examen, par le seul fait de leur évidence. Et c’est bien
d’un combat qu’il s’agit, car rien n’est plus enivrant ou confortable que la croyance. Aussi, se libérer de
la croyance, c’est s’affranchir de tout ce qui fait la loi en nous, de tout ce qui nous fait acquiescer et
juger sans que nous ne l’ayons jamais pensé. C’est pourquoi, selon Alain, il en va de notre liberté
dans toute recherche de la vérité, car, avant tout gouvernement tyrannique, c’est la crédulité des
hommes qui les asservit. Qui pense, en effet, affirme sa liberté car il ne reconnaît aucune loi, hormis
celles dont sa raison a éprouvé la légitimité. A rebours, tout tyran sait qu’il est aisé de régner sur un
peuple de croyants : qui est prompt à croire, en effet, est aussi prompt à obéir.
« Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui s’endort ; au
contraire, le réveil secoue la tête et dit non. Non à quoi ? Au monde, au tyran, au
prêcheur ? Ce n’est que l’apparence. En tous ces cas-là, c’est à elle-même que la

4
pensée dit non. Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle
combat contre elle-même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde
me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés, c’est que je
consens, c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est maître,
c’est que je respecte au lieu d’examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par
cette somnolence. C’est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir, c’est nier ce
que l’on croit.
Qui croit seulement ne sait même plus ce qu’il croit. Qui se contente de sa pensée ne
pense plus rien. Je le dis aussi bien pour les choses qui nous entourent. Qu’est-ce je vois
en ouvrant les yeux ? Qu’est-ce que je verrais si je devais tout croire ? En vérité une
sorte de bariolage, et comme une tapisserie incompréhensible. Mais c’est en
m’interrogeant sur chaque chose que je la vois. Ce guetteur qui tient sa main en abat-
jour, c’est un homme qui dit non. Ceux qui étaient aux observatoires de guerre pendant
de longs jours ont appris à voir, toujours par dire non. Et les astronomes ont de siècle en
siècle toujours reculé de nous la lune, le soleil et les étoiles, par dire non. Remarquez
que dans la première présentation de toute l’existence, tout était vrai ; cette présence du
monde ne trompe jamais. Le soleil ne paraît pas plus grand que la lune ; aussi ne doit-il
pas paraître autre, d’après sa distance et d’après sa grandeur. Et le soleil se lève à l’est
pour l’astronome aussi ; c’est qu’il doit paraître ainsi par le mouvement de la terre dont
nous sommes les passagers. Mais aussi c’est notre affaire de remettre chaque chose à
sa place et à sa distance. C’est donc bien à moi-même que je dis non. »
ALAIN, Propos sur les pouvoirs (§ 139)
« Le doute est le sel de l’esprit ; sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont
bientôt pourries. J’entends aussi bien les connaissances les mieux fondées et les plus
raisonnables. Douter quand on s’aperçoit qu’on s’est trompé ou que l’on a été trompé, ce
n’est pas difficile ; je voudrais même dire que cela n’avance guère ; ce doute forcé est
comme une violence qui nous est faite ; aussi c’est un doute triste ; c’est un doute de
faiblesse ; c’est un regret d’avoir cru, et une confiance trompée. Le vrai c’est qu’il ne faut
jamais croire, et qu’il faut examiner toujours. L’incrédulité n’a pas encore donné sa
mesure.
Croire est agréable. C’est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à liberté,
à justice, à paix. Il est naturel et il est délicieux de croire que la République nous donnera
tous ces biens ; ou, si la République ne peut, on veut croire que coopération, socialisme,
communisme, ou quelque autre constitution nous permettra quelque jour de nous fier au
jugement d’autrui, enfin de dormir les yeux ouverts comme font les bêtes. Mais non. La
fonction de penser ne se délègue point. Dès que la tête humaine reprend son antique
mouvement de haut en bas, pour dire oui, aussitôt les tyrans reviennent. »
ALAIN, Propos sur les pouvoirs (§ 140)
3/ L’énigme du nom de la philosophie : qu’est-ce que la pensée et l’amour
peuvent avoir en partage ?
Entreprenant de définir l’amour, Platon met en évidence, dans ce passage du Banquet, une curieuse
analogie entre l’amour et la pensée. Qu’est-ce la pensée et l’amour peuvent bien avoir en commun ?
De prime abord, ces deux relations semblent bien étrangères l’une à l’autre, voire même opposées.
Or, comme le souligne ici Diotime, le désir qui anime la pensée est semblable au désir qui unit l’amour
à son objet. De même, en effet, que celui qui aime n’en a jamais fini de poursuivre l’objet de son
amour, est toujours pauvre vis-à-vis de cet objet, de même la pensée véritable est une pensée qui n’a
jamais fini d’interroger son objet, qui le poursuit sans cesse, sans croire jamais le posséder
pleinement. C’est donc tout autant à l’amour qu’à la pensée que Platon veut nous initier : je n’aime et
ne pense que tant que je ne crois pas posséder, maîtriser ce que j’aime ou ce que je cherche à
penser. Au contraire des propriétaires, des pseudo-savants et des maquereaux de toute espèce, celui
qui pense comme celui qui aime sait que la pauvreté n’est ni un échec ni une privation : car pour

5
aimer comme pour penser, il faut savoir se rendre pauvre pour ce que l’on aime et pour ce que l’on
pense…
« SOCRATE- De quel père, demandai-je, est-il né, et de quelle mère ?
DIOTIME- C’est bien long à raconter, répondit-elle ; je te le dirai pourtant. Sache
donc que le jour où naquit Aphrodite, les dieux banquetaient, et parmi eux était le
fils de Sagesse, Poros [mot grec qui signifie la ruse, le moyen efficace]. Or, quand
ils eurent fini de dîner, arriva Pénia [mot grec qui signifie : pauvreté], dans
l’intention de mendier, car on avait fait grande chère, et elle se tenait contre la
porte. Sur ces entrefaites, Poros, qui s’était enivré de nectar, pénétra dans le jardin
de Zeus, et, appesanti par l’ivresse, il s’y endormit. Et voilà que Pénia, songeant
que rien jamais n’est favorable pour elle, médite de se faire faire un enfant par
Poros lui-même. Elle s’étend donc auprès de lui, et c’est ainsi qu’elle devint grosse
d’Eros [d’Amour] Voilà aussi la raison pour laquelle Eros est le suivant d’Aphrodite
et son servant : parce qu’il a été engendré pendant la fête de naissance de celle-ci,
et qu’en même temps l’objet dont il est par nature épris, c’est la beauté, et
qu’Aphrodite est belle.
Donc, en tant qu’il est fils de Ruse [Poros] et de Pauvreté [Pénia], voici la
condition où se trouve l’Amour [Eros]. Premièrement, il est toujours pauvre ; et il
s’en manque de beaucoup qu’il soit délicat aussi bien que beau, tel que se le figure
le vulgaire ; tout au contraire il est rude, malpropre, va-nu-pieds, sans gîte,
couchant toujours par terre et sur la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des
portes ou dans les chemins : c’est qu’il a la nature de sa mère, et qu’il partage
avec elle la vie de l’indigence. Mais, comme en revanche il tient de son père, il est
à l’affût de tout ce qui est beau et bon : car il est viril, il va de l’avant, tendu de
toutes ses forces, chasseur hors pair, sans cesse en train de tramer quelque ruse,
passionné d’inventions et fertile en expédients ; employant toute sa vie à
philosopher ; incomparable sorcier, magicien, sophiste. J’ajoute que sa nature
n’est ni d’un immortel ni d’un mortel. Mais tantôt, dans la même journée, il est en
pleine fleur et bien vivant, tantôt il se meurt : puis il revit de nouveau, quand
réussissent ses ruses grâce au naturel de son père. Sans cesse pourtant s’écoule
entre ses doigts le profit de ces expédients ; si bien que jamais Amour n’est ni
dans le dénuement, ni dans l’opulence.
D’un autre côté, il est à mi-chemin et du savoir et de l’ignorance. Voici en effet ce
qu’il en est. Il n’y a pas de dieu qui s’occupe à philosopher, ni qui ait envie
d’acquérir le savoir (car il le possède), et pas davantage quiconque d’autre
possédera le savoir ne s’occupera à philosopher. Mais, de leur côté, les ignorants
ne s’occupent pas non plus à philosopher et ils n’ont pas envie d’acquérir le
savoir ; car c’est essentiellement le malheur de l’ignorance, que tel qui n’est ni
beau, ni bon, ni intelligent non plus, s’imagine l’être autant qu’il faut. Celui qui ne
pense pas être dépourvu n’a donc pas le désir de ce dont il ne croit pas avoir
besoin d’être pourvu.
SOCRATE- Dans ces conditions, quels sont, Diotime, ceux qui s’occupent à
philosopher, puisque ce ne sont ni les savants, ni les ignorants ?
DIOTIME- Voilà qui est clair, répondit-elle, un enfant même à présent le verrait :
ce sont les intermédiaires entre l’une et l’autre espèce, et l’Amour est l’un deux.
Car la science, sans nul doute, est parmi les choses les plus belles ; or, l’Amour a
le beau pour objet de son amour ; par suite, il est nécessaire que l’Amour soit
philosophe et, en tant que philosophe, intermédiaire entre le savant et l’ignorant.
Mais ce qui a fait aussi qu’il possède ces qualités, c’est sa naissance : son père est
savant et riche en ruses, tandis que sa mère, qui n’est point savante, en est
dénuée. Voilà quelle est en sorte, cher Socrate, la nature de ce démon. »
PLATON, Le Banquet (203 B)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%