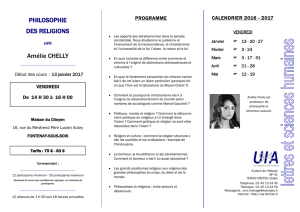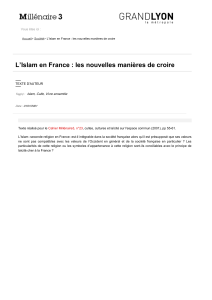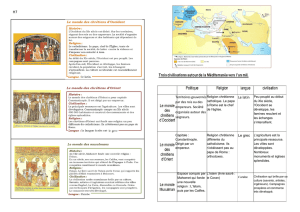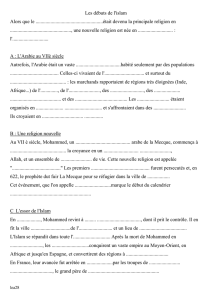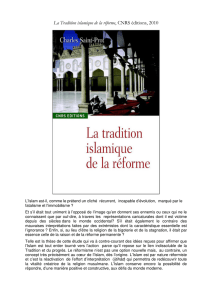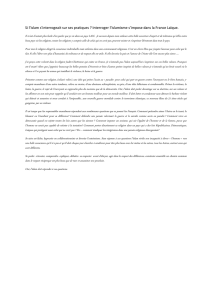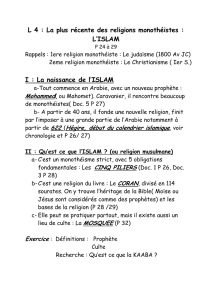Discours contemporains autour de la conversion

Discours contemporains autour de la conversion
Article de Laure Guirguis
Doctorante en études politiques, à l’EHESS (Paris) et au CEDEJ (le Caire), sous la direction d’Alain Roussillon, puis de Hamit Bozarslan
Le « dossier copte » et, en particulier, les conversions religieuses qui retiendront mon attention dans le présent article, ont resurgi dans les débats politiques
et médiatiques égyptiens depuis quatre ans environ. Deux affaires notamment ont mobilisé l’attention, qui peuvent être considérées comme l’envers l’une
de l’autre en même temps que les jalons chronologiques de la période étudiée. Le cas Wafâ Constantin a en effet stimulé cette libération de la parole de et
sur les coptes, ainsi que l’a justement remarqué Alain Roussillon (Roussillon 2006).
Wafâ Constantin, femme d’un prêtre copte[1]
[1]La femme d’un prêtre est considérée quasiment comme originaire de la région du delta du Nil, se
convertit à l’islam en décembre 2004. Les coptes organisent des manifestations dans plusieurs villes
égyptiennes et quelques milliers d’entre eux se rassemblent à la cathédrale de ‘Abbâsiyya au Caire pour
réclamer le retour de Wafâ Constantin, enlevée et convertie de force d’après les rumeurs chrétiennes.
Le Patriarche Chenouda III intervient et obtient de la Sûreté de l’Etat qu’elle remette Wafâ Constantin
entre les mains de l’Eglise, alors qu’aucune loi n’autorise l’institution ecclésiale à exiger qu’un individu
lui soit livré. Depuis la date de son retour, sous haute surveillance, à l’Eglise et au christianisme, nul ne
saurait affirmer avec certitude où se trouve Wafâ Constantin, vraisemblablement dans l’un des
monastères du Wadi Natroun (Bishri 2005).
2 Au mois d’août 2007, un jeune homme musulman annonce sa conversion au christianisme. Fait
sans précédent en Egypte de la part d’une personne née musulmane de famille musulmane,
Muhammad Higâzî introduit une requête auprès d’un tribunal administratif afin de contraindre le
ministère de l’Intérieur et le Département des affaires civiles à modifier l’identité religieuse inscrite sur
ses papiers officiels. Le jeune homme serait psychologiquement perturbé ou aurait été séduit par des
promesses d’émigration en Europe ou aux Etats-Unis formulées par quelque association chrétienne,
assène-t-on dans la presse, à la quasi-unanimité. Il mérite la mort, clament certains, partisans de
l’application de la sanction islamique de l’apostasie. L’affaire est médiatisée à outrance et fournit
l’occasion d’une riposte gouvernementale contre les associations dites de prosélytisme et par là même
contre l’Eglise copte orthodoxe, directement quoique médiatement visée. Le 29 janvier 2008, un
tribunal administratif du Caire présidé par le Conseiller Muhammad al-Husaynî rejette la requête du
demandeur (Guirguis 2008a).
3 Le cas des « reconvertis » a également suscité maints procès et débats. Les reconvertis sont des
individus qui, initialement chrétiens, ont été enregistrés sous une identité religieuse musulmane par le

Département des affaires civiles et souhaitent recouvrer leur nom et identité coptes sur leurs papiers
officiels. L’inscription de la religion sur les documents officiels détermine les règles de droit appliquées
dans les affaires de statut personnel (mariage, divorce, enterrement)[2] [2] Globalement, on a assisté,
depuis la seconde moitié du...
suite, la religion des enfants (celle du père) et, par conséquent, la religion que ces derniers devront
étudier à l’école. Certains ont été répertoriés de la sorte par erreur, d’autres en raison de la conversion
à l’islam de l’un de leurs parents alors qu’ils étaient encore mineurs, d’autres après s’être convertis à
l’islam, par exemple pour divorcer[3] [3] L’inflexibilité du Patriarche Chenouda III sur la question...
suite.
4 La très brève évocation de ces cas de figures permet déjà d’entrevoir quels sont les acteurs, les
discours et les pratiques qui entrent en confrontation dans les affaires de conversion. Je procèderai dans
cet article à l’exposé de quelques uns de ces discours et pratiques, à savoir les discours théologiques sur
l’apostasie, le discours juridique, les pratiques administratives et les pratiques judiciaires. Dans un
second temps, je me concentrerai sur les discours radicaux musulmans et chrétiens et sur leur modes et
supports d’énonciation d’une part, sur les discours laïcs d’autre part. Je conclurai en formulant quelques
questions sur les implications et enjeux politiques de ces discours antagonistes et de la médiatisation,
nouvelle, du dossier confessionnel et des affaires de conversion en particulier.
La conversion et la justice égyptienne : théories et pratiques
Le droit positif et les tribunaux
5 Les crises de la conversion révèlent à nouveau les antagonismes sur lesquels repose la Constitution
égyptienne qui, dans sa dernière version, celle de 1971 (amendée en 1980, 2005, 2007), stipule, d’un
côté que « les principes de la charî’a [4] [4] Une telle formulation est terriblement multivoque et les...
suite [sont] la source principale de la législation[5] [5] Article 2 : « L’islam est la religion de l’Etat,...
suite » (article 2), de l’autre côté que l’Etat garantit « la liberté de croyance et la liberté d’exercice du
culte. » (article 46). Or, suivant les interprétations de la charî’a majoritaires à présent, j’y reviens, ces
deux articles sont contradictoires.
6 Certes, la Haute Cour Constitutionnelle a, lors d’un verdict prononcé en 1985, posé que l’article 2,
tel qu’amendé en 1980, d’une part n’a pas d’effet rétroactif ; les textes de loi adoptés avant la date de la
réforme constitutionnelle échappent par conséquent au contrôle de la Haute Cour constitutionnelle et
restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient amendés ou abrogés par le législateur. D’autre part cet article
s’adresse au législateur chargé de veiller à l’accord des lois avec les principes de la charî’a, lesquels n’ont
pas d’effet direct immédiat dans l’ordre juridique égyptien et ne constituent pas des règles de droit
positif immédiatement applicables par les tribunaux (Bernard-Maugiron et Dupret 1999).

7 Certes, aucune loi du droit positif n’interdit la conversion. En outre, d’après la Loi 143/1994 qui
gouverne l’état civil (qânûn al-ahwâl al-madaniyya), il incombe à toute personne de se présenter au
Registre civil en cas de changement de quelque donnée que ce soit sur la carte d’identité (article 53) et
au Département des affaires civiles, muni d’une « attestation des autorités compétentes » (article 47)[6]
[6] Cf. Rapport de l’EIPR « Prohibited Identities » p. 57 donne...
suite, pour procéder à la modification du nom de la religion inscrite sur la carte d’identité, sur le
formulaire d’immatriculation nationale et sur le certificat de naissance. La conversion à l’islam ne pose
généralement pas de problème et l’enregistrement de la nouvelle religion est obtenue rapidement dans
la plupart des cas. La conversion au christianisme n’a fait qu’une seule fois l’objet d’une requête
officielle (le cas Hegâzî). Par contre, quelque 300 demandes de reconversion au christianisme ont été
recensées depuis 2004. Suivant les règles énoncées ci-dessus, la conversion est une affaire qui se règle
avec les instances religieuses d’une part, d’autre part avec les institutions étatiques concernées, à savoir
les administrations du service civil, l’Office notarial (lequel ne délivre pas de certificat de conversion au
christianisme, en cas de reconversion au christianisme celle-ci est mentionné sur le formulaire de
conversion à l’islam utilisé au moment de cette dernière) et le Bureau de la Sûreté (auprès duquel
signaler une conversion à l’islam).
8 De tels cas ne devraient donc théoriquement pas être examinés par les tribunaux. Or le refus de
certains fonctionnaires du service civil de procéder à la modification de la religion oblige le reconverti au
christianisme à introduire une action en justice contre le ministère de l’Intérieur, dont dépend le
Département des affaires civiles, et à prouver que ce dernier a refusé de procéder au changement
demandé. Comme aucune loi ne prévoit la conversion au christianisme et malgré l’existence d’une loi
exigeant d’enregistrer toute modification des données sur les papiers d’identité, beaucoup de juges
considèrent que l’absence de loi les autorise à recourir aux prescriptions de la charî’a, suivant la
loi 1/2001[7] [7] L’article 3 alinéa 1 de la Loi 462/ 1955 telle...
suite. Le recours à la notion d’« ordre public » (nizâm al-’âmm) constitue également un moyen de
refuser de telles demandes en réintroduisant la charî’a, élément essentiel de l’ordre public, « through
the backdoor » [8] [8] La notion de nizâm al-‘âmm est originaire du droit...
suite.
9 Une grande marge de manœuvre est par conséquent laissée au Juge pour trancher, ainsi qu’en
témoignent les verdicts contradictoires prononcés dans les cas de reconversion au christianisme. En
effet, de nombreux verdicts ont été émis en faveur des plaignants tant que l’une des chambres chargée
d’examiner ces requêtes était présidée par le Conseiller Fârûq ‘Abd al-Qâdir. Le Conseiller mentionne le
fait qu’aucun verset du Coran n’évoque de sanction mondaine de l’apostasie ; que le christianisme étant
une religion céleste, celui qui y revient ne saurait être considéré comme un impie (kâfir) ; qu’il existe
d’anciennes fatwas autorisant celui qui s’est converti à l’islam à redevenir chrétien ; que l’islam ne

saurait contraindre qui que ce soit à rester musulman. (Rûz al-Yûsif 7 avril 2007). Suite à la série de
verdicts rendus en faveur des demandeurs chrétiens, l’avocat qui est intervenu en soutien du ministère
de l’Intérieur, ‘Abd al-Majîd al-‘Inânî, a interjeté appel et, le 2 avril 2007, la Haute Cour administrative
(mahkama al-idâriyya al-‘ulyâ) a examiné le pourvoi et l’a rejeté. La Cour ne s’est pas prononcée sur la
question du droit des chrétiens de revenir à leur religion initiale, mais a considéré que, à titre
d’intervenant aux côtés du ministère de l’Intérieur, l’avocat n’avait pas d’intérêt à agir ; seul, le
ministère de l’Intérieur avait qualité à agir et aurait dû déposer un pourvoi[9] [9] Al-
Dustûr 2 et 3 avril 2007 ; Al-Masri al-Yawm 3 avril 2007. ...
suite. Le 24 avril 2007, le tribunal administratif (mahkama al-idâriyya) – qui, dans l’attente du verdict de
la Haute Cour administrative, avait reporté jusqu’à cette date l’examen de soixante dix autres cas-
rejette les demandes des chrétiens reconvertis. D’après les attendus du jugement tels que rapportés
dans la presse et dans le rapport de l’EIPR[10] [10] Egyptian Initiative for Personal Rights, dirigée par
Husâm...
suite (EIPR 2007), le tribunal a considéré que la liberté de croyance était garantie par la Constitution, par
la charî’a et par les droits de l’homme, dans la mesure où cela ne contrevenait pas aux règles de la
religion à laquelle l’individu avait adhéré et où cela ne troublait pas l’ordre public (nizâm al-‘âmm). Le
tribunal a estimé qu’accepter le retour d’un individu à sa religion initiale après une conversion à l’islam
constituait une attaque contre l’islam. Il a en outre distingué entre liberté de croyance et « manipulation
des religions » (talâ’ub bi al-adyân ou talâ’ub bi al-i’tiqâd)[11] [11] Par exemple Al-Masri al-
Yawm 26 et 28 avril 2007. ...
suite et a qualifié de « manipulation des religions » ces reconversions dans lesquelles une autre chambre
avait vu, l’année précédente, l’expression de la liberté de croyance et de la liberté de choisir sa
croyance. Les plaignants, dont la requête a été rejetée le 24 avril 2007, ont fait appel. L’Eglise est
intervenue à titre de partie[12] [12] L’Eglise se porte partie prenante dans la mesure où...
suite. Après plusieurs reports, la Haute Cour administrative a examiné l’affaire et accepté la requête des
demandeurs le 9 février 2008.
L’apostasie et la charî’a
10 Les affaires de conversion, en relançant les débats sur l’apostasie et sur la question de savoir si la
charî’a [13] [13] Charî’a, signifie la Loi, au sens des principes moraux,...
suite prescrit des sanctions mondaines ou pas à l’apostat[14] [14] Johansen 2003. Berger, 2001, 2002,
2003. Peters, R. , et...
suite, touchent au point le plus sensible au niveau théorique et politique : le point sur lequel, souvent, la
pensée achoppe, dans le cas des partisans d’une conciliation entre les textes islamiques fondateurs et

l’exigence d’égalité ; le point sur lequel il n’est pas envisageable de céder, pour les avocats de la
restauration d’un islam pur de toute intrusion considérée comme étrangère.
11 L’apostasie (ridda) signifie la sortie de l’islam, soit qu’un individu la déclare publiquement, soit
que ses actes signalent une telle sortie. Les sanctions de l’apostasie sont les peines appliquées, au terme
d’un procès, à l’apostat s’il ne se repent pas et ne revient pas à l’islam. Ceux qui défendent la thèse
d’une sanction mondaine de l’apostasie préconisent presque toujours la peine de mort. Les
conséquences de l’apostasie sont les effets juridiques et sociaux de cette sortie de l’islam, à savoir
l’invalidation de tous les contrats passés par l’apostat, ce qui inclut les contrats de mariage et la
possibilité d’hériter (il arrive qu’un individu intente un procès en apostasie contre l’un de ses proches
pour le déshériter et toucher sa part d’héritage, par exemple).
12 Suivant la position des institutions religieuses islamiques officielles en Egypte actuellement, la
sortie de l’islam doit être sanctionnée ici bas dans le cas où elle s’accompagne d’actes de provocation
susceptibles de troubler l’ordre et la morale publics. C’est par conséquent la portée sociale et politique
de la conversion et non sa dimension proprement religieuse qui est réprouvée. Elle n’est donc tolérée
que si elle n’est pas rendue publique et par conséquent pas officialisée (Soliman 2008).
13 Cependant, plusieurs voix, minoritaires, se sont élevées pour démontrer qu’en islam il n’y a rien
de tel que la sanction de l’apostasie et que celle-ci a souvent été un instrument utilisé par le souverain
pour se débarrasser d’individus indésirables. Depuis Muhammad ‘Abduh (1848-1905), qui est considéré
comme l’un des pères du courant dit « réformisme » musulman , telle est la position, par exemple, de
Gamâl al-Bannâ. Pour sa part, le Dr al-‘Alwânî, dans un ouvrage récent[15] [15] « Pas de coercition en
religion » (la ikrâh fi al-dîn),...
suite, montre que le hadîth sur lequel se basent les partisans des sanctions mondaines de l’apostasie ne
devrait pas être considéré comme valable en tout temps et en tout lieu puisqu’il venait en réponse à un
événement particulier, spatialement et temporellement circonscrit. En effet, écrit al-‘Alwânî, reprenant
l’argumentation de Muhammad ‘Abduh, le hadîth « man badala dînahu fa uqtulûh » (« celui qui
abandonne sa religion – l’islam- tuez-le »), rapporté par Bukhârî[16] [16] Le premier des six recueils
(quatre dans le chiisme) qui...
suite, doit être interprété comme une riposte aux tentatives de sédition évoquées dans la sourate « al-
‘Amrân » : « Parmi les gens du Livre, certains ont dit : le matin, accordez foi au livre révélé (des
mahométans) ; le soir, abandonnez cette foi ; ainsi délaisseront-ils leur religion » (Le Coran, « al-
‘Amrân », 71). Plus encore, al-‘Alwânî met en exergue les versets du Coran qui indiquent que l’on ne
saurait attribuer au Prophète quelque fonction politique. Enfin et surtout, le Coran ne permet pas de
décider en faveur d’une sanction mondaine de l’apostasie et laisse à Dieu le pouvoir de trancher et de
décider de la sanction.
Les autres débats actuels autour des cas de conversion : communautaristes et laïcs
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%