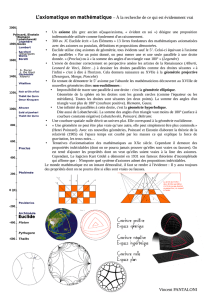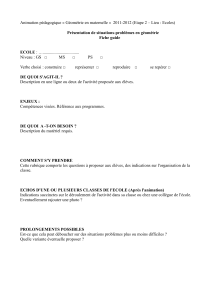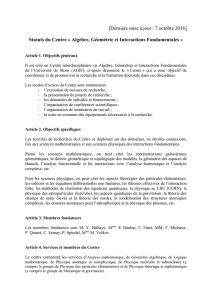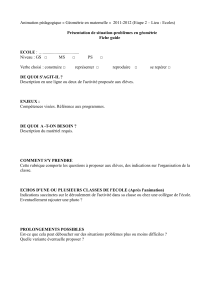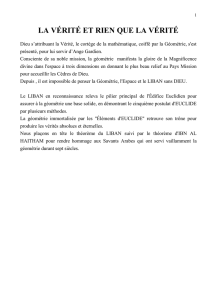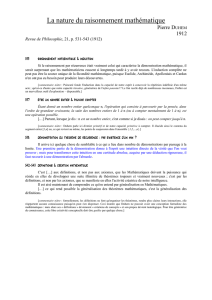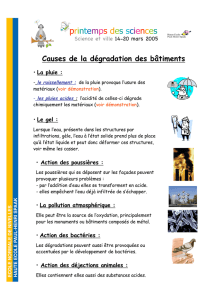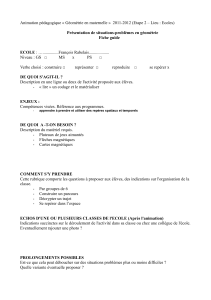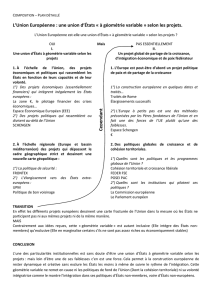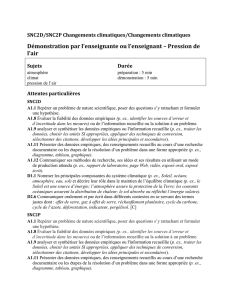La démonstration

Philopsis La démonstration Alain Chauve.doc
© Alain Chauve, Philopsis 2006 1
La d émonstration
La philosophie de la démonstration mathématique
Alain Chauve
Philopsis : Revue numérique
http://www.philopsis.fr
Les articles publiés sur Philopsis sont protégés par le droit d'auteur. Toute
reproduction intégrale ou partielle doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès des éditeurs et des auteurs. Vous pouvez citer librement
cet article en en mentionnant l’auteur et la provenance.
Dans l’Introduction à la philosophie mathématique (1919), au
chapitre I, Bertrand Russell fait la distinction entre, d’un côté, la
mathématique ordinaire, celle qui part d’objets mathématiques simples et
élémentaires pour construire des objets de plus en plus complexes et s’élever
aux mathématiques supérieures et, d’un autre côté, ce qu’il appelle la
philosophie mathématique, qui se tourne vers les principes et notions
fondamentales pour les élucider et les élaborer mathématiquement. Russell
prend l’exemple du début même des mathématiques : « Quand les anciens
géomètres grecs passèrent des règles empiriques de l’arpentage égyptien aux
propositions générales dont ils découvrirent qu’elles permettaient de justifier
les premières, puis de là aux axiomes et postulats d’Euclide, ils faisaient de
la philosophie mathématique […] ; mais une fois découverts les axiomes et
les postulats, leur utilisation dans des déductions, comme on le voit chez
Euclide, appartient aux mathématiques au sens ordinaire »1. Ce propos
caractérise assez bien le processus de mise en œuvre et d’élaboration de la
notion de démonstration dans les mathématiques en attirant l’attention sur
l’exigence philosophique qui gouverne ce processus. Nous nous proposons
de le montrer sur l’exemple de la géométrie.
On a dit que la géométrie trouvait son origine dans l’arpentage que
l’on pratiquait dans l’Egypte des Pharaons pour redistribuer les lots de terre
1Introduction à la philosophie mathématique, trad. François Rivenc, éd.Payot,
1991, pp. 36-37.

Philopsis La démonstration Alain Chauve.doc
© Alain Chauve, Philopsis 2006 2
après les crues du Nil. Mais il faut dire aussi, en reprenant une célèbre
distinction que faisait G. Canguilhem, que, si c’est peut-être son origine, ce
n’est pas encore son commencement. Ce commencement est grec. C’est en
effet avec la démonstration que commence la géométrie. Les prêtres
égyptiens ne connaissaient que des règles empiriques, des procédés
d’arpenteurs. Ils savaient par exemple que l’on obtenait un angle droit
lorsqu’on construisait un triangle dont les côtés sont comme 3, 4, et 5. Les
Grecs, eux, en savaient plus, et le savaient autrement. La tradition, en
l’occurrence Diogène Laërce, nous dit que le premier géomètre fut Thalès
(vers 580 ?). Il aurait formulé une proposition générale sur la construction
des triangles rectangles, une proposition qui exprime une loi géométrique de
construction d’une figure : « Il inscrivit dans un cercle le triangle rectangle
et pour cette découverte immola un bœuf ». Plus exactement, il s’agit de
l’inscription du triangle rectangle dans le demi-cercle dont le diamètre est le
côté opposé à l’angle droit. Le doxographe ne nous dit pas ce qui justifie
cette proposition et d’où elle vient, mais il n’est pas difficile de restituer la
démonstration.
Admettons que l’on a déjà démontré que la somme des angles d’un
triangle vaut deux angles droits – on attribue cette démonstration à
Pythagore – et considérons le triangle ABC, inscrit dans le demi-cercle de
centre O.

Philopsis La démonstration Alain Chauve.doc
© Alain Chauve, Philopsis 2006 3
Un autre exemple célèbre est celui de la duplication du carré dont la
démonstration fut donnée, dit-on, par Pythagore et que Platon met en scène
dans le Ménon. Pour démontrer que le carré qui a pour côté la diagonale AC
d’un carré donné ABCD aura la surface double de ce dernier, on construit la
figure et l’on compte les triangles égaux pour constater qu’il y en a deux
dans le carré donné (ABC et ACD) et quatre dans le carré construit (A B C,
A B A’, A’ B C’ et C’ B C)
Sous cette forme rudimentaire, la démonstration consiste à montrer
quelque chose sur une figure. Toutefois, il ne s’agit pas d’une figure que l’on
trouverait parmi les choses que l’on peut observer. La figure que l’on montre
est une figure que l’on a construite et qui n’apparaît qu’avec cette
construction. Et pour montrer quelque chose sur cette figure, il ne s’agit pas
de la regarder, même avec attention, pour tenter de l’y apercevoir, mais il
s’agit de raisonner sur elle, en particulier d’établir des égalités entre ses
éléments. Nous dirons que, au début de la géométrie, la démonstration
consiste à montrer non en observant et en regardant, mais en construisant
une figure pour pouvoir raisonner sur la construction. L’objet géométrique
n’est pas ce qu’on fait apparaître visuellement mais une figure qu’on se
représente dans l’esprit et qui est comme à l’arrière-plan de la figure qu’on
trace. Platon disait que cet objet est « supposé » (République VI, 510 b-e) et
que, par exemple, sous le carré qu’on trace, il y a le « carré en soi ». En
faisant son apparition dans le champ de la géométrie, la notion de
démonstration exige que l’on distingue et sépare les choses mathématiques,
que l’on conçoit et que l’on forme par la pensée, des choses concrètes et
« visibles » que l’on peut observer autour de nous. D’emblée la notion de
démonstration est solidaire d’une conception philosophique de la nature des
choses mathématiques, de sorte que toucher à cette notion, c’est modifier
cette conception. Et c’est justement ce qui va arriver.
Cette démarche démonstrative, à laquelle nous devons les premières
lois géométriques, reste pourtant insatisfaisante, car si l’on comprend bien
qu’il fait avoir recours à des constructions et non à des observations, en

Philopsis La démonstration Alain Chauve.doc
© Alain Chauve, Philopsis 2006 4
revanche, la nécessité de la construction qu’il faut faire pour démontrer
n’apparaît pas. On a le sentiment que le géomètre doit inventer cette
construction, qu’il doit la trouver par lui-même, en tâtonnant ou en
réfléchissant ou par une sorte d’inspiration, comme Thalès le taciturne au
pied de la pyramide. Peut-on admettre que la nécessité objective de la
démonstration soit ainsi livrée à la contingence subjective de celui qui en a
l’idée ? La démonstration ne serait alors qu’une « opération extérieure »,
pour parler comme Hegel, dans le Préface de la Phénoménologie de l’esprit,
un moyen de mettre en évidence un résultat, mais un moyen qui reste un
appareil démonstratif extérieur, un « mode de présentation » d’arguments
mathématiques propres à convaincre et à se convaincre soi-même qu’une
figure a bien telle ou telle propriété. Qu’on ait l’idée de la construction ou
qu’on nous la souffle – comme fait Socrate avec le petit esclave dans le
Ménon – « on a à obéir aveuglément à cette prescription de tirer précisément
ces lignes […] sans rien savoir d’autre et en ayant confiance que cela servira
bien à la conduite de la démonstration »2. On voudrait pourtant comprendre
à quelle nécessité, à quelles règles obéissent les constructions qu’on peut et
qu’on doit faire pour démontrer. On voudrait passer des lois géométriques –
tel ou tel théorème qu’on démontre – aux lois de la géométrie – les principes
et les notions qui norment les démonstrations. On voudrait passer des lois
qu’on démontre à celles qui permettent de les démontrer.
Euclide a été probablement le premier à répondre à cette exigence. Sa
géométrie se présente comme un système déductif où l’on distingue d’abord
les raisonnements qu’on tient et les choses sur lesquelles on raisonne. Les
raisonnements obéissent au principe de contradiction auquel toute
démonstration se ramène « comme à son ultime vérité », avait dit Aristote, à
savoir : « il est impossible que l’affirmation et la négation soient vraies et
fausses en même temps » (Métaphysique, 3). Enoncé sous cette forme, ce
principe a une valeur générale ; il vaut pour « tout être en tant qu’être » et
s’impose à chaque « science » sous une forme particulière dans son domaine
propre. En géométrie, où il s’agit de « grandeurs », Euclide formule donc 9
« axiomes »3 (« notions communes ») qui expriment l’exigence de non
contradiction dans le domaine des grandeurs (par exemple, « les grandeurs
égales à une même grandeur sont égales entre elles », ou encore : « le tout
est plus grand que la partie »). Les choses sur lesquelles on raisonne font
l’objet de définitions, par exemple celle du point : « le point est ce qui n’a
pas de parties », ou celle de la droite : « la ligne droite est celle qui est
interposée également entre ses points ». Euclide cherche à évoquer les
choses mathématiques en voulant éviter qu’on les confonde avec des choses
concrètes. Il en parle comme de choses abstraites dont il ne peut pas même y
2 Préface et Introduction de la Phénoménologie de l’esprit, trad. Bernard
Bourgeois (légèrement modifiée), éd. Vrin,1997.
3 Liste des définitions, axiomes et postulats dans Introduction à l’histoire des
sciences, 1. Eléments et instruments. Textes choisis, éd. Classiques Hachette,
1970, pp. 43-46.

Philopsis La démonstration Alain Chauve.doc
© Alain Chauve, Philopsis 2006 5
avoir d’image sensible : un point n’est pas la trace que laisse une pointe sur
un support ; ce serait plutôt une sorte de « monade ». La ligne droite n’est
pas l’alignement rectiligne de l’arête d’un mur ou d’une corniche.
On a ainsi clarifié le discours du géomètre, sa syntaxe et ses notions.
On sait en quels termes exacts il faut parler des choses géométriques ; on sait
qu’il faut s’en tenir strictement aux termes dans lesquels elles sont définies
et l’on sait qu’il faut les considérer sans introduire des représentations
étrangères aux termes que l’on utilise. Reste qu’il faut maintenant expliciter
non seulement la manière de parler des choses géométriques mais aussi la
manière de les former intellectuellement dans l’esprit. C’est ce que va faire
Euclide. Il va ramener les constructions géométriques à quelques règles
fondamentales qui norment tous les procédés de construction de figures.
Tous en effet se ramènent à trois actes intellectuels fondamentaux qui
constituent la pensée géométrique. Euclide demande qu’on les admette eux
et eux seuls, aussi les appelle-t-il des postulats. Il demande qu’on puisse 1/
« conduire une droite [et une seule !] d’un point quelconque à un point
quelconque », 2/ « prolonger indéfiniment, selon sa direction, une droite
finie », 3/ « d’un point quelconque et avec un intervalle quelconque, décrire
une circonférence de cercle ». On aura reconnu l’utilisation de la règle et du
compas exprimée de façon abstraite (il ne s’agit pas d’expliquer la manière
d’utiliser une règle pour tirer un trait ou un compas pour tracer une
circonférence). Les démonstrations devront ainsi faire appel à ces postulats
qui imposent d’effectuer des constructions à la règle et au compas.
Il y a trois autres postulats, mais le quatrième et le sixième peuvent
être rattachés aux autres. Par contre le cinquième, comme on sait, va poser
un problème. Il ne semble pas être de même nature que les trois premiers. Ce
postulat concerne le parallélisme : « Si une droite, tombant sur deux droites,
fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces droites
prolongées à l’infini se rencontrent du côté où les angles sont plus petits que
deux droits ».
Soit la droite AB perpendiculaire à la droite BC. L’angle ABC est droit. Si
l’angle BAD est plus petit qu’un angle droit, la somme des angles ABC et
BAD est plus petite que deux droits, et les droites AD et BC seront sécantes
du côté de D et C. Ce postulat sous-entend que, dans le cas où l’angle BAD
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%