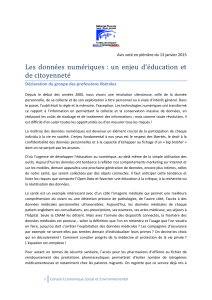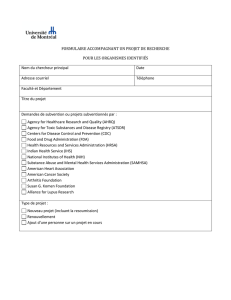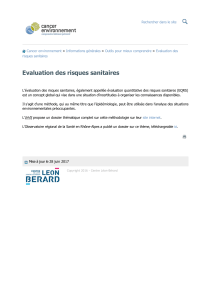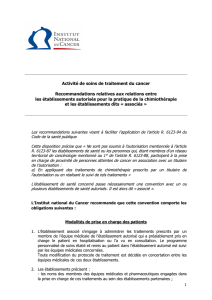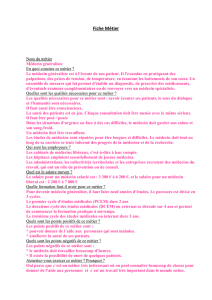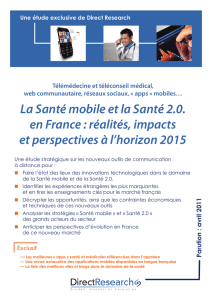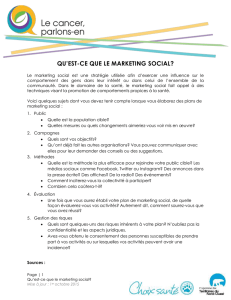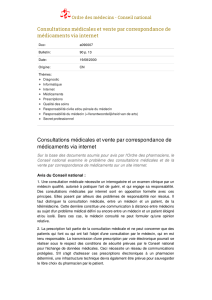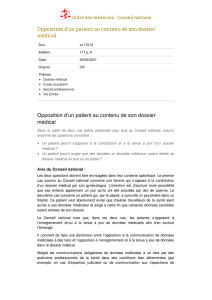Situation des sciences sociales de la médecine et de la santé

Dossier | Gesundheitsforschung
42 Notre société connaît depuis peu une médicalisation du
social, et, à l’inverse, une socialisation de la médecine. Les
apports des sciences sociales de la médecine et de la santé
constituent plus que jamais une piste de recherche impor-
tante. Des dynamiques collaboratives entre deux mondes, le
social d’une part, et la médecine d’autre part, permettent la
convergence du médical, du sanitaire et du social et consti-
tuent ainsi une zone d’échange qui respecte les spécialités et
points de vue de chaque acteur.
Entre médicalisation et socialisation
Dès les années 1950, les thèmes et terrains médicaux
ont foisonné dans le champ de l’analyse sociale. Cette
situation découle en partie d’un constat anthropolo-
gique: «Medicine has helped make us the kinds of liv-
ing creatures that we have become at the start of the
21st century. […] Medicine […] makes us what we are by
reshaping the relations of meaning through which we
experience our worlds.»1. Ce constat se situe à la croi-
sée de deux phénomènes majeurs. D’une part, la médi-
calisation et la sanitarisation2 du social: un nombre sans
cesse croissant de conditions ou de situations de la vie
quotidienne sont devenues des questions médicales,
déléguées aux médecins et autres professionnels de la
santé reconnus comme tels par les systèmes de sécurité
sociale3. D’autre part, la socialisation de la médecine et de
la santé: la pratique médicale et les dispositifs de santé
sont devenus de plus en plus socialement hétéronomes,
sur le plan organisationnel et institutionnel, comme
1 Nikolas Rose, «Beyond medicalisation», The Lancet 369 (2007)
700–702, 701.
2 Fassin F. (2000): «Entre politiques du vivant et politiques de la vie.
Pour une anthropologie de la santé», Anthropologie et sociétés, 24,
95 -116 .
3 Panese F., Barras V. (2008): «Médicalisation de la ‹vie› et re-
configurations médicales», Revue de sciences sociales, no spécial
«Ethique et santé», 39.
aux niveaux de la production des connaissances médi-
cales4 et des pratiques cliniques; ces dernières étant no-
tamment marquées par l’intégration dans la clinique de
facteurs sociaux et culturels participant des désordres
organiques et psychiques (disparités, vulnérabilités,
traditions, etc.) et, symétriquement, par la reconnais-
sance de la dimension expérientielle des patients façon-
nés par leur parcours thérapeutique et leur environne-
ment social.
Des postures différentiées
Cette brève mise en perspective permet d’esquisser les
apports des sciences sociales de la médecine et de la
santé. Ils sont intimement liés à l’articulation différen-
tiée des sciences sociales aux mondes médicaux et sani-
taires. Grossièrement dit, les productions du domaine
se distribuent entre deux pôles: d’un côté, les approches
«externalistes» qui privilégient les facteurs externes
des évolutions médicales et sanitaires, et qui déploient
leurs effets plutôt sur la gouvernance des systèmes de
santé; de l’autre, la «sociologie embarquée»5 qui, par-
ce qu’elle participe de l’«intervention», est susceptible
d’avoir des effets plus marqués sur les situations et les
pratiques concrètes de prise en charge. Notons que cette
distribution est aussi corrélée, sur le plan socio-insti-
tutionnel, à des modes d’insertion eux-aussi différen-
tiés des chercheurs et, sur les plans épistémologiques
et méthodologiques, à des protocoles de recherche assez
différents, caractérisés par une intégration variable du
«terrain». L’une des modalités les plus intégratives se-
rait la «Participatory research» en santé qui implique
«the co-construction of research between researchers
and people affected by the issues under study (e.g., pa-
tients, community members, community health pro-
fessionals, representatives of community-based orga-
nizations) and/or decision makers who apply research
findings (e.g., health managers, policymakers, com-
munity leaders).»6
4 Cf. par ex. les apports de l’épistémologie sociale de la médecine:
Berg M., Mol A. (ed.) (1998): Differences in Medicine: Unraveling
Practices, Techniques, and Bodies. Durham, N.C.: Duke University
Press, 1998.
5 Bourrier M. (2010): «Pour une sociologie ‹embarquée› des univers
à risque?», Tsantsa, Revue de la société suisse d’Ethnologie, No 15,
«Anthropologie et journalisme», pp. 28–37.
6 Jagosh J, Macaulay AC, Pluye P, Salsberg J, Bush PL, Henderson J,
Sirett E, Wong G, Cargo M, Herbert CP, Seifer SD, Green LW, Green-
halgh T. (2012): «Uncovering the benefits of participatory research:
implications of a realist review for health research and practice»,
Milbank Quarterly, 90(2): 311–46.
Situation des sciences
sociales de la médecine et
de la santé
Francesco Panese, professeur d’études sociales des sciences et
de la médecine à l’Université de Lausanne

Bulletin SAGW 3 | 2013
43
Francesco Panese
Francesco Panese est pro-
fesseur d’études sociales des
sciences et de la médecine à
l’Université de Lausanne. Depuis
1999 il est directeur du Musée
de la main, une institution consacrée à la culture scientifique et
médicale. Il a dirigé le Collège des Humanités de l’EPFL de 2008 à
2013. Ses recherches portent sur l’épistémologie sociale et histo-
rique des sciences et de la médecine – en particulier sur les cultures
visuelles dans ces domaines – et plus largement sur les relations
entre science, médecine et société. Ses recherches en cours sont
consacrées aux neurosciences, au transfert de connaissances en
médecine entre la recherche et la clinique et à la question de la
précarité des patients dans les relations de soin.
Des régimes d’action contrastés
Ces différentes approches sont bien sûr traversées par
des enjeux épistémologiques et institutionnels, mais
leur coexistence témoigne de la variété des régimes
d’action, potentielle ou avérée, des sciences sociales
de la médecine et de la santé. Cette variété se distribue
aujourd’hui sur le large spectre des «mondes sociaux»
de la médecine et de la santé, où des groupes d’acteurs
souvent hétérogènes développent des activités spéci-
fiques dans le cadre de situations ayant une proximité
variable avec les pratiques thérapeutiques ou de soins:
de la clinique singularisée au management organisa-
tionnel, institutionnel et politique de la santé, en
passant par l’épidémiologie sociale ou encore la san-
té publique. A chacun de ces niveaux, les apports des
sciences sociales de la médecine et de la santé se font
en fonction des postures adoptées et des protocoles de
recherche mis en œuvre. Ces apport peuvent être dis-
tingués en trois dimensions: la dimension opératoire
au niveau de l’évolution des pratiques médicales ou de
soin, la dimension réflexive au niveau des praticiens et
des patients quant à leur rôle dans la production et les
usages des dispositifs médicaux et sanitaires et, en-
fin, la dimension de critique sociale de la manière dont
la médecine produit, maintient et utilise son autorité à
travers les champs sociaux.
Pertinence et collaboration
La pertinence des sciences sociales pour l’évolution
des mondes médicaux et sanitaires nécessite
l’aménagement de conditions pour que des dynamiques
collaboratives se développent, permettant ainsi de faire
converger les versions médicales, sanitaires et sociales
vers des objets partagés au niveau de la recherche et/
ou de l’intervention. Ceci ne conduit pas à renoncer à
la critique, ni au refus de la controverse ou au gom-
mage des spécificités heuristiques et disciplinaires. Il
s’agit plutôt d’élaborer des règles d’échange qui, si elles
sont partagées par les acteurs impliqués, permettent la
collaboration, même si chacun attribue une significa-
tion différente aux objets échangés: qu’il s’agisse des
évolutions de la clinique, des transformations des pra-
tiques médicales, des reconfigurations des politiques
de santé, etc. L’établissement de ces règles nécessite des
«zones d’échanges»7 permettant une certaine proximité
des acteurs, qui pourrait être mieux institutionnalisée
dans des dispositifs de recherche «co-élaborative» qui
7 La notion de «trading zone» est développée par Galison P. (1997):
Image and logic: a material culture of microphysics, Chicago: Universi-
ty of Chicago Press.
intégrerait la démarche participative au cœur même de
la communauté des chercheurs et des praticiens entre
médecine et sciences sociales. Ce serait là un moyen de
poursuivre une voie ancienne, entr’ouverte à l’orée du
développement du modèle bio-psycho-social, lorsque
médecins et sociologues s’accordaient pour dire que
«modern comprehensive medical care cannot disregard
the problems of equilibrium in personal and social rela-
tionships affecting the person in sickness and health».8
C’était en 1954.
8 Simmons L. W., Harold G. W. (1954): Social Science in Medicine.
New York: Russell Sage Foundation. Cf. la recension de Rice E. P.
(1955) «Social Science in Medicine», American Journal of Public
Health and the Nation’s Health, Vol. 45, No. 2, pp. 246–247.
L’auteur
1
/
2
100%