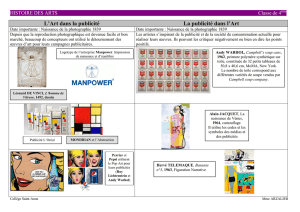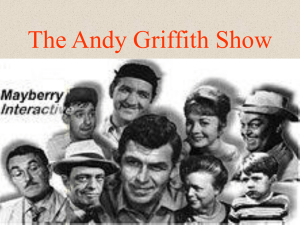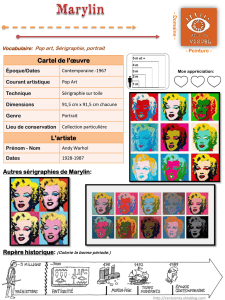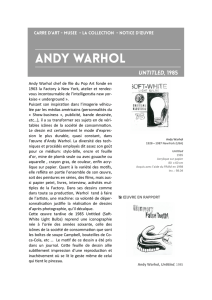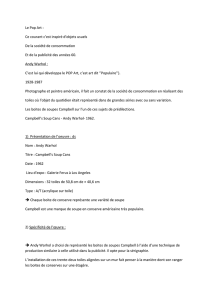Ray Tomlinson, Andy Grove et Hilary Putnam

Observatoire Foi et Culture - Conférence des évêques de France
58 av de Breteuil 75007 Paris Tel. : 01 72 36 69 64 mail : ofc@cef.fr
Aux évêques de France
OFC 2016, n° 13
Ray Tomlinson, Andy Grove et Hilary Putnam :
Requiescant …
La rubrique « Nécrologie » de nos médias a été envahie récemment par les hommages rendus
au footballeur néerlandais Johan Cruyff ou à l’académicien Alain Decaux. Quels que soient
leurs mérites, leur disparition a occulté celle de trois autres personnalités qui ont probablement
davantage « fait l’histoire ». Il s’agit d’un ingénieur, d’un grand patron et d’un philosophe, tous
trois américains et les deux derniers juifs.
L’ingénieur, c’est Ray Tomlinson, né en 1941, formé au MIT (Massachussetts Institute of
Technology). C’est lui qui, en 1971, alors qu’il avait participé à la création du réseau (militaire)
Arpanet (ancêtre de notre Internet, permettant de relier entre eux des réseaux locaux
d’ordinateurs) et qu’il était censé s’occuper d’autre chose, découvrit comment envoyer un
message d’un ordinateur à un autre et conçut les adresses où le nom de l’utilisateur est associé
par l’arobase @ à celle d’un serveur qui reçoit et envoie des données sur la « toile ».
L’inventeur des emails (c’est lui aussi qui lança cette appellation) resta modeste et discret,
poursuivant sa carrière dans la même entreprise de high tech qui travaille essentiellement pour
le Pentagone.
Le grand patron, c’est Andrew (ou plus familièrement Andy) Grove. Son nom est lié à Intel – le
microprocesseur de la plupart des ordinateurs. Né Andras Grof en 1936 en Hongrie sous la
dictature de l’amiral Horty, une maladie infantile le laissa partiellement sourd. Il échappa à la
Shoah quand les nazis prirent le pouvoir. À vingt ans, après l’entrée des chars soviétiques à
Budapest, il réussit à passer en Autriche et de là aux États-Unis. Il apprit l’anglais, se maria à
une compatriote réfugiée comme lui, à laquelle il resta fidèle toute sa vie, et s’inscrivit en génie
chimique à l’université, d’abord à New York, puis, pour son doctorat, à Berkeley en Californie.
Devenu spécialiste des semi-conducteurs (il publia en 1967 un manuel qui est devenu un
classique), il fut un des pionniers de ce qui allait devenir la Silicon Valley à quelques encablures
de Berkeley.
Ce n’est pas lui qui créa Intel, mais Robert Noyce (1927-1990) et Gordon Moore (né en
1929). Le premier avait vu que l’avenir était aux microprocesseurs. Le second a donné son nom
à une loi qui dit que la capacité des puces électroniques double tous les deux ans. Andy Grove,
immédiatement embauché pour faire tourner l’entreprise, apporta un « plus » décisif : en plus
de ses compétences technologiques et de son goût pour l’innovation perpétuelle, des qualités
de manager hors pair, non seulement dans la commercialisation et la rentabilité, mais encore
dans la gestion des « ressources humaines ». Devenu richissime, il n’avait pas d’emplacement
de parking réservé (pas de chauffeur non plus, et encore moins un jet privé ou une villa pour
des réceptions du genre de Gatsby le Magnifique) et travaillait dans un box qu’il trouvait libre au

2
sein de l’espace collaboratif du siège de l’entreprise. La seule hiérarchie qui l’intéressait était
mesurée par la performance et concrétisée non par des grades ou des rangs, mais par de
l’argent (de juteuses parts de capital et pas uniquement des salaires), ou inversement des
licenciements, chacun étant invité à s’exprimer, avoir des idées, les partager et les tester.
Ce style de management est devenu un modèle. Son livre de 1996, Only the Paranoid Survive
(« Seuls les paranoïdes survivent »), demeure un best-seller. La paranoïa en question est celle
qui interdit de se reposer sur ses lauriers. Il ne faudrait cependant pas prendre Andy Grove
pour un de ces milliardaires que leur succès rend omniscients et infaillibles. Il se trompa et sut
reconnaître et corriger ses erreurs. Vers la fin de sa vie, il se fit l’apôtre d’une économie centrée
sur l’emploi (job-centric), montrant que les délocalisations ont des effets néfastes à terme et que
les start-ups, si nécessaires qu’elles soient, ne remédient au chômage que lorsqu’elles se
développent au point de devoir embaucher en masse et ainsi de soutenir et augmenter la
demande. Il n’oublia jamais non plus d’où il venait et plaida pour que l’Amérique demeure une
terre d’accueil.
Ce sont des perspectives que n’aurait pas désavouées Hilary Putnam, né en 1926 et mort
quelques jours plus tôt. Il avait enseigné la philosophie à Harvard à partir de 1965. Fils de
communiste, lui-même un temps maoïste, il s’inscrit dans la tradition de l’école anglo-saxonne
dite analytique, attachée à l’examen critique du phénomène de la connaissance et à la logique
de formulation des pensées et raisonnements. Il s’intéressa aux mathématiques, au langage, à
l’informatique, aux neurosciences, à l’esthétique, à l’éthique, changeant plusieurs de fois de
position dans ces divers domaines et se révélant un redoutable polémiste.
Ce qui émerge de ce foisonnement parfois contradictoire, c’est un dépassement résolu et peut-
être irréversible du positivisme qui veut que la philosophie ne soit rien de plus qu’une
ramification de la science et que la seule connaissance fiable est celle qui se forme dans l’esprit
humain, et plus précisément dans le cerveau. Putnam montra que ce qui devient conscient
n’est pas indépendant de ce que d’autres expérimentent et nomment, donnant ainsi les mots
pour l’identifier. Il s’ensuit qu’il est impossible d’exclure qu’il existe autre chose que ce qui est
perçu par les sens et conçu dans l’autonomie du cerveau. Sans aller jusqu’à un « réalisme
métaphysique », le penseur non-conformiste finit par renoncer à l’athéisme qui lui avait été
enseigné et qu’il avait professé, et il découvrit même son judaïsme, faisant sa bar mitzvah à 68
ans. Il se laissa inviter en Israël et écrivit un livre sur la philosophie juive. Son argument : la
religion n’a pas besoin de preuves ; ce qui compte, c’est ce qu’elle change en l’homme.
C’est ainsi qu’en moins de quinze jours ont disparu trois hommes qui ont marqué la transition
du XXe au XXIe siècle, avec l’avènement de l’ordinateur et du courrier électronique, les défis de
l’immigration et du chômage, et le retour du religieux.
Jean Duchesne, o.f.c.
P.S. On pourrait ajouter à cette chronique nécrologique Marvin Minsky (1928-2016), un autre
juif américain, mais résolument athée, « inventeur » de l’« intelligence artificielle » au MIT,
spécialiste des sciences cognitives et persuadé qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre
l’être humain et les machines. Chaud partisan de la cryogénisation (préservation d’un cadavre à
– 196° C, permettant une réanimation théorique lorsque des techniques appropriées le
permettront), il a été un des pionniers du « transhumanisme ».
1
/
2
100%