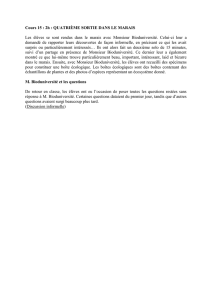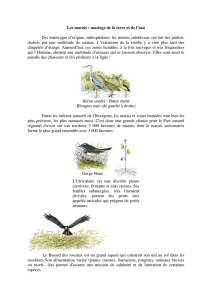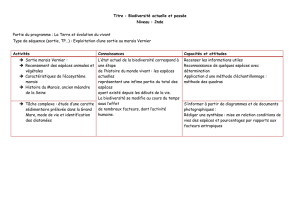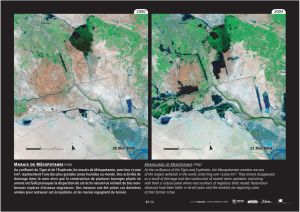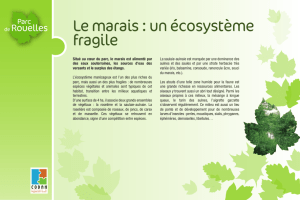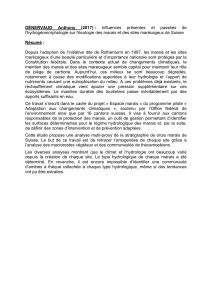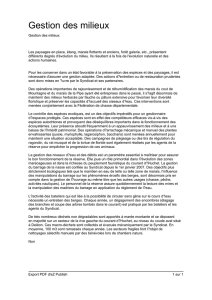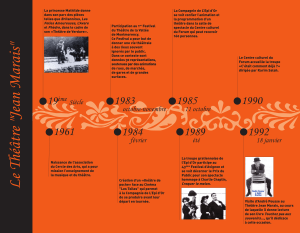les matins du monde Quignard

Tou s L e s Matins Du Monde De Pasca l Qu i g n a rd
Biographie
•Pascal Quignard est né le 23 avril 1948.
•À l’âge de 18 mois, il passe par des périodes d’«autisme»,
lesquelles se renouvellent lorsqu’il a 16 ans. Son enfance
est difficile la plupart du temps. Il connaît notamment
l’anorexie.
•Ses parents sont tous les deux professeurs de lettres
classiques. C'est pour cela que Quignard maîtrise très
rapidement les moindres détails de la langue française. Il développe un intérêt prononcé pour le grec et le
latin. Sa passion principale était la lecture.
•Ses intérêts le portent vers les littératures anciennes ainsi que vers la musique. Il s'essayera à une multitude
d'instruments comme l'orgue ou le violoncelle.
•Il fait des études de philosophie.
•Il entre au comité de lecture des éditions Gallimard puis secrétaire général pour le développement éditorial.
•Il s'intéressera à l'écriture fragmentée ainsi qu'à la méditation érudite.
•En 1991, Tous les matins du monde est publié par Gallimard. Peu après, il est adapté par Alain Corneau en
film.
•Il crée le Festival international d'opéra et de théâtre baroque au château de Versailles. Il préside aussi le
concert des Nations aux côtés de Jordi Savall.
•En 2000, il obtient le grand prix du roman de l'Académie Française ainsi qu'en 2002, le prix Goncourt.
Résumé
Le livre comment par une présentation brève et froide de la situation. Mme de St-Colombe est
morte. Son mari reste seul pour s'occuper de leurs deux enfants : Madeleine et Toinette (la
cadette). On découvre un Monsieur de St-Colombe très solitaire, mélancolique, et secret. Il a
l'habitude de jouer toute la journée de la viole.
Ses deux filles bénéficièrent de l'enseignement de leur père même si leurs relations avec lui étaient
mouvementées ; Madeleine pleurait aux débordements de colère de son père, Toinette se rebellait
et finissait enfermée dans la petite pièce sous l'escalier (comme Harry Potter!). Un jour, M. De St-
Colombe lui fit amener une petite viole confectionnée exprès pour sa petite taille. Le trio des St-
Colombe était très renommé.
Le Roi de France lui même en entendit parler et voulut faire venir St-Colombe à Versailles parmi
ses maîtres musiciens. St-Colombe en ermite convaincu déclina avec ferveur l'offre du Roi et se
confina dans ses appartements, à savoir sa cabane, pour continuer à jouer de la viole en paix.
Parfois, lors de ces improvisations, il voyait son épouse défunte réapparaître telle une lueur
d'espoir, de joie et d'amour dans sa triste existence.
Un jour, un jeune homme nommé Marin Marais vint frapper à la porte de St-Colombe pour lui
demander de lui enseigner l'art de la viole. Il avait été chassé du chœur de la Maîtrise après sa
mue et il voulait obtenir reconnaissance en musique grâce à la viole. Ce dernier attendit du petit
qu'il se montre extrêmement convainquant. Il le fit même poiroter pendant 1 mois après l'audition
pour lui transmettre sa décision quand à la requête du jeune homme de devenir son élève.
Madeleine tomba tout de suite sous le charme du nouveau arrivant.
Quelques années plus tard, St-Colombe surpris Marin Marais à jouer pour les autorités du pays,
qu'il tenait en grippe. Extrêmement déçu et contrarié, il explosa la viole de Marin Marais contre la

cheminée avant de le congédier à jamais. Madeleine complètement éprise du jeune garçon n'en
pouvait plus de tristesse. Sur le départ du jeune garçon, elle le rattrapa à la hâte avant de lui
promettre des leçons particulières de musique avec elle ainsi que son corps. Marin Marais alléché
par l'idée de percer les secrets de St-Colombe ainsi que l'hymen de sa fille, se fit une joie
d'accepter. Ainsi les deux tourtereaux se virent en secret et couchèrent honteusement ensemble
de le lit de la demoiselle.
Souvent, ils se cachaient sous la cabane de St-Colombe pour entendre ses nouvelles
improvisations. Un jour, ils furent surpris par St-Colombe. Ce dernier commença à éclater la tête
du jeune homme contre sa cabane jusqu'au moment où Madeleine lui avoua son amour pour
Marin Marais. Le père se calma illico. Il lui proposa la main de sa fille et Marais n'arriva pas à
accepter (il travaillait déjà à Versailles avec de belles demoiselles pleines de couleur, de formes et
d'amour à revendre, rien à voir avec la pâlichonne Madeleine...). Il continua pourtant à venir chez
les St-Colombe, à recevoir des leçons.
Un jour, il coucha avec la sœur cadette de Madeleine, Toinette (à croire qu'il aimait bien toute la
famille et arrivait à pomper toutes les richesses de ses membres...). Après-ça, il quitta Madeleine
et ne revint plus. Madeleine accoucha de l'enfant mort-né de Marin Marais. Elle tomba gravement
malade et dépressive jusqu'au bout de la corde (nous y reviendrons). St-Colombe était toujours
entêté avec ses rencontres avec son épouse défunte et Toinette se maria à un luthier.
Marin Marais fit parvenir, par le biais de Toinette (car oui, il la voyait toujours contrairement à sa
sœur [l'histoire ressemble étrangement à 2 sœurs pour un roi]), une paire de beaux souliers que
son cordonnier de père avait fabriqué sur mesure pour elle. À préciser qu'entre-temps, il s'était
marié avec une Versaillaise. Madeleine jeta les chaussures au feu, et Toinette les sauva de justesse
avant leur combustion.
Quelques temps plus tard, Madeleine attrapa un mauvais virus. Elle restait toujours alitée, et elle
était maigre. On craint qu'elle soit au bord de la mort. Elle demanda à St-Colombe de lui jouer « La
rêveuse » que Marin Marais avait composé pour elle à l'époque où il avait encore un cœur. Papa
Colombe demanda à Toinette d'aller chercher à Versailles Marin Marais pour qu'il interprète lui
même la chanson à Madeleine. Ce dernier se montra assez réticent, mais finalement, empli de
remords, il vint à son chevet. Ils discutèrent bizarrement ensemble.
Il repartit et Madeleine se pendit avec le lacet des chaussures que Marin Marais lui avait offert. On
entendit plus parler de Toinette. On vit seulement la tristesse de St-Colombe qui pour une fois,
lâcha sa viole pendant près de 6 mois.
Marin Marais toujours attiré par ce qui était rare et bénéfique pour sa personne, se rappela que
Madeleine lui avait parlé de morceaux qui faisaient revivre les morts comme « le Tombeau des
regrets ». Il revint alors à la hâte et se cacha pendant au moins 2 ans toutes les nuits (autant dire
que ça fait une sacrée trotte) sous la cabane de St-Colombe dans l'espoir que ce dernier joue ces
pièces magiques.
Un soir, il entendit St-Colombe soupirer et parler à un être invisible (sa femme). Il entreprit alors de
gratter à la porte du musicien. Ce dernier l'accepta (sûrement parce qu'il était au comble du
désespoir et de la solitude). Ils partagèrent un dernier moment de musique ensemble. Et Marin
Marais a pu garder trace de la musique de St-Colombe.

Opposition St-Colombe et Marin Marais
St-Colombe Marin Marais
Froid, gauche dans l'expression (- - - communication) Timide puis prend de l'assurance
Moyen d'expression = musique Musique = moyen de changer de classe sociale
Pas tactile, brusque, violent
Taciturne, ermite, seul dans sa cabane Arriviste
Démodé, dégoût du grand monde Ambitieux, veut vivre à la Cour, notoriété
Haut, épineux, très maigre, jaune, vieux 17 ans au début
Tendre, sentimental, fidèle à l'amour de sa femme Couche avec les deux sœurs, pas amour, respect
Pas d'évolution En pleine évolution
Toinette et Madeleine s'opposent également. Elles s'entendent tout de même bien, malgré le fait
que Toinette soit très jalouse de sa sœur qui est l'aînée ; que ce soit pour la viole, ou pour l'amour
de Marin Marais. Toinette instaure une sorte de compétition entre elles.
Le thème principal
L'amour de la musique est le soutien même du récit. En effet, tous les personnages ont un rapport
avec elle: le professeur et compositeur Sainte-Colombe qui a amélioré la viole, Marin Marais, futur
ordinaire de la Chambre du Roi, les deux filles qui donnent des concerts avec leur père, le luthier et
les représentants du Roi. Le but principal de Sainte-Colombe est de se perfectionner; il joue pour
lui seul et en aucun cas pour se produire sur scène ou devant un public, son amour pour la
musique est désintéressé et total. M.Marais voit plutôt dans la viole un moyen de réussite sociale.
Choix narratif
L'auteur a choisi de mettre en évidence la musique sans entrer dans les détails techniques. Il a
aussi utilisé des ellipses narratives pour certains moments du récit et a choisi de se baser sur la
vision de Sainte-Colombe, sans pour autant utiliser une focalisation interne avec narrateur-
personnage.
Écriture
L'auteur écrit dans un style sophistiqué et simple à la fois. Il emploie des tournures de phrases très
belles mais avec un vocabulaire simple, ce qui rend le livre très agréable et facile à lire. Quignard
emploie des phrases courtes et insère des descriptions courtes, elles aussi.
Quignard utilise l'esthétique du fragment. Il met en place des moments de réflexion et ensuite, il
laisse le lecteur y aller de sa propre imagination. C'est dans le non-dit (saut de page, *...) que l'on
peut ressentir l'essentiel. Il veut donner + à ressentir qu'à dire avec ses textes fragmentaires ->
musique...
Apparition de Madame de St-Colombe
•Toujours en lien avec la musique et la finesse qu'elle est capable d'exprimer.
•2x les pleurs : moment d'intimité, permet d'exprimer ses sentiments les plus profonds.
•Distance de l'épouse :
◦elle ne parle pas (silence).

◦Elle vient seulement pour manger et boire (pas d'émotions) « boire du vin » = « goûter
à la vie ».
◦Elle parle d'amour, de la discrétion de son mari avant, pour l'expression de l'amour qu'il
lui témoignait.
◦Évocation de la mort. M. De St-Colombe ne pleure pas. Il éprouve de la joie. On
retrouve le motif baroque, le lien entre la vie et la mort.
◦Il y a une progression. + d'intimité et + de gravité.
Quignard se distingue par le fait qu'il dit très peu les choses. Il laisse la place au lecteur.
•St-Colombe : forme de rituel (gaufrettes, vin[communion], cabane...).
◦Attitude de St-Colombe
▪Il se précipite vers elle (rare, « je souffre madame de ne pas vous toucher »...).
▪Il a de la retenue « les yeux baissés », « détournant les yeux », « il tenait les
paupières baissées ». La pudeur participe à l'intensité de l'émotion.
▪Les réactions de St-Colombe à son apparition sont fortes.
Les principaux moments où on le voit seul, où on décrit où il est dans sa cabane. La possibilité de
formuler ce qui est important pour lui, finesse dans le langage grâce à l'interlocuteur spéciale
qu'est la femme. Tranquillité dans ces passages.
Est-ce un récit fantastique ?
Non, car rien ne distingue ces passages de l'apparition de l'épouse des autres. Le fil de la langue
est pareil. Il n'y a pas d'autres mondes, pas de fantastique. « Le biscuit à moitié entamé » prouve
que l'existence de l'épouse est réelle.
Structure du récit avec ces 4 passages
1. Instants qui durent quelques secondes donnent une stabilité sereine. Le récit et St-
Colombe sont stabilisés. On imagine que les apparitions surviennent plus que le nombre
d'apparitions décrites. On voit que St-Colombe vit en contact avec une dimension
supérieure, accessible à lui seulement.
2. Rythme, comme des refrains, cadences, idée de musique discrète. Un seul ton, motif
récurrent.
3. Ces passages nous font réfléchir au lien entre la vie et la mort. Dimension philosophique.
Ce roman nous pose des questions existentielles.
La musique renvoie à soi-même et à ce qu'on a de + profond en soi.
Pages 41-43
Tous les matins du monde est une œuvre très axée sur la musique. D'ailleurs, dans cet extrait, on
retrouve beaucoup d'éléments faisant référence à la musique, comme « les ornements », « la
descente chromatique », ... Tous ces mots contribuent à créer une atmosphère singulière, où le
son et le silence prennent une place importante. Du point de vue sonore, le texte est découpé en 2
parties. Une première jusqu'à « une langue humaine » et la deuxième depuis « ils sortirent du Jeu
de Paume » jusqu'à la fin. Ces deux passages sont caractérisés par deux atmosphères bien
différentes.
1. Tourne autour du bruit, du peuple qui parle et remplit la salle. Par exemple avec « jouaient,
applaudissaient aux meilleurs coups, deux femmes récitaient, les actrices déclamaient ».
2. L'atmosphère se fait plus froide, plus personnelle. Le neige contribue à cette impression de
retrait par rapport aux mondanités de la partie 1. À ce moment, les bruits se font plus rares
et distincts. Ce n'est plus le brouhaha de la première partie. Le lecteur peut entendre les
pas dans la neige, le jet d'eau chaude d'urine couler dans la neige.

Ce qui est aussi étonnant dans ce passage, c'est adversité. La pisse est ramenée à la musique. Ainsi
l'atmosphère musicale domine encore cet extrait, et semble pouvoir embellir chaque parole et
geste de chacun.
St-Colombe ne parle presque pas comme à son habitude. Il se tait quasiment après avoir dit « la
musique est la voix humaine ». Cela laisse songeur le lecteur ainsi que Marin Marais. On peut ainsi
capter la profondeur de St-Colombe. Ça complète ainsi l'art de la concision de Quignard. Il n'y a
pas de fioriture, on dit peu. Cela permet au lecteur de réfléchir par lui-même. C'est le but !
Les sons du monde sont musique
La voix, la pisse, les cristaux de neige, la peinture sur la toile, le bruit du marteau... Sons sollicités
pour approcher la musique. Musique prosaïque, elle peut parler à chacun d'entre nous, car elle fait
partie du monde. Une attitude de l'âme qui ouvre à la musique.
Tous les matins du monde sont sans retour.
La leçon de musique
La leçon de musique est une œuvre de Quignard qui est écrite sur le mode de variations comme en
musique. Il reprend un élément de la vie de Marin Marais qu'il décline, ou varie plusieurs dizaines
de fois selon des critères bien précis.
Le thème principal : à la fin de sa vie, il contemple la nature, et se rapproche de + en + de la
personnalité de St-Colombe. C'est neutre, impersonnel, factuel, sombre et direct. Quignard utilise
la même langue que pour Tous les matins du monde. Il utilise la focalisation externe. Les
répétitions mettent en évidence la voix humaine. On voit le côté du musicien, sérieux... l'énergie
sexuelle et l'appétit des femmes n'apparaissent pas ici. On voit un Marin Marais silencieux et
vieux. Il est en communion avec St-Colombe.
•Accumulation
◦variations musicales
◦volonté du narrateur de varier la mise en mot
◦propose différents angles d'approche
•Étourdissement, foisonnement
•Marin Marais au second plan
◦lui-même : digression (d'importance quantitative variable), alors que le fond de la
réflexion porte sur la musique.
▪Impression de lenteur, de redites
▪dimension philosophique et poétique
•étonnement devant le précédé : réflexion
•valeur métaphysique
•par juxtaposition de fragments (~ruines)
•différents mouvements musicaux
•dimension méditative ( ça nous oblige à la lenteur, à
l'arrêt)
•le mystère ne se laisse pas percer. On ne peut que
l'approcher en lui tournant autour en quelque sorte.
Il insiste sans insister. Il porte l'attention sans imposer. Il essaye de faire saisir l'insaisissable.
 6
6
1
/
6
100%