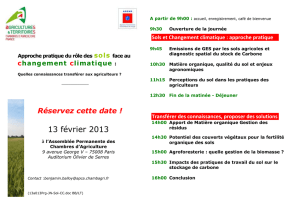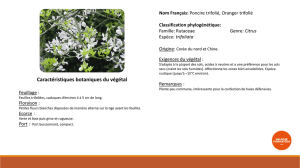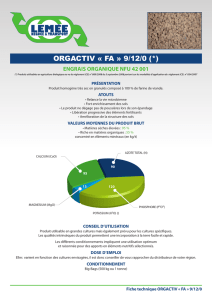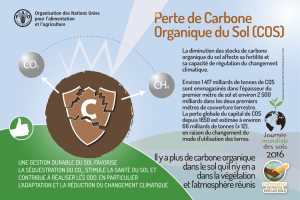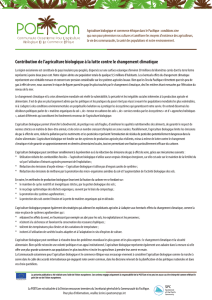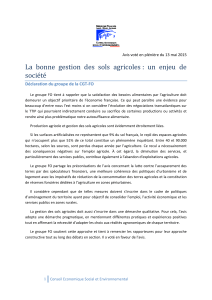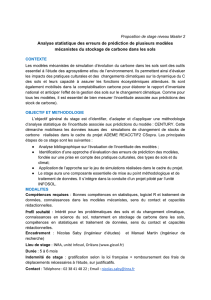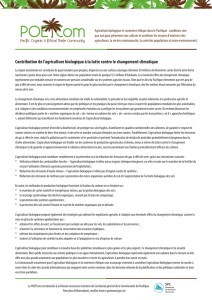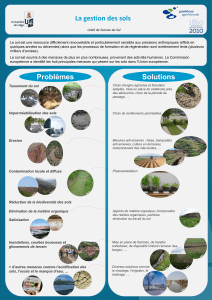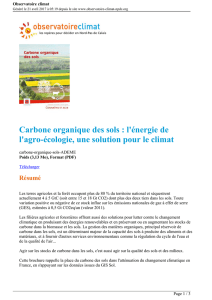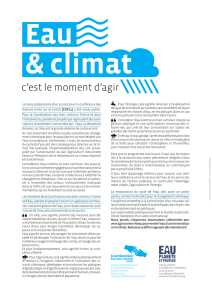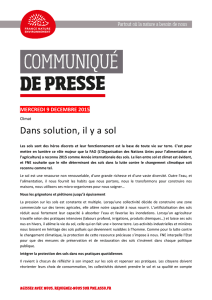Les sols : l`allié méconnu de l`Europe dans la lutte contre le

Les sols : l’allié méconnu de l’Europe
dans la lutte contre le changement
climatique
Dossier de presse
Lundi 16 novembre 2009

2
SOMMAIRE
INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 3
LES SOLS, PARTENAIRES OBLIGES DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ..... 5
Une ressource indispensable face au défi climatique ............................................................................ 5
Une ressource menacée par l’homme et le réchauffement climatique ................................................... 7
Une ressource à préserver et restaurer durablement ............................................................................. 9
LA DIRECTIVE SOLS, OUTIL INDISPENSABLE DE PROTECTION GLOBALE DES SOLS ............... 11
Le constat de la dégradation des sols en Europe ................................................................................ 11
Limites et échec du projet de directive-cadre de 2007 ......................................................................... 11
Le retour d’une Directive Sols pour 2010 ? .......................................................................................... 12
Chronologie ......................................................................................................................................... 13
LIENS ..................................................................................................................................................... 15
CONTACTS PRESSE
Arnaud Gossement, porte-parole de FNE : 06 28 23 79 10
Gaëlle Cognet, chargée de mission climat à l’international : 06 79 21 31 14
Service communication de FNE : 01 44 08 02 52 / [email protected]r

3
INTRODUCTION
Les sols entretiennent avec le climat un jeu d’interrelations complexe. D’un côté, ils participent de
la réduction des émissions de gaz à effet de serre en captant naturellement du dioxyde de
carbone (CO₂). Les sols constituent en effet un des principaux puits naturels de carbone sur Terre.
Ce carbone résulte directement de la capture du CO₂ par la photosynthèse des végétaux
contenus dans le sol et, plus indirectement, de la fixation en son sein de substances organiques
sous la forme d’humus stable. De l’autre, les sols émettent sous certaines conditions des gaz à
effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote) et contribuent ainsi au
réchauffement climatique.
Ces émissions sont accentuées par l’action de l’Homme et risquent de l’être encore par l’effet du
réchauffement climatique. L’agriculture intensive, l’urbanisation, le changement d’affectation des
sols (transformation d’une prairie en champs cultivé, drainage d’une tourbière par exemple)
conduisent à un appauvrissement des sols, à leur imperméabilisation ou à la transformation
accélérée du carbone qu’ils renferment en CO₂. Sensibilisés, ces sols perdent en matière
organique : ils captent moins de carbone qu’ils n’en émettent et peuvent être conduits à émettre
d’autres gaz. Ils perdent aussi en capacité de stockage de l’eau : ils s’érodent, deviennent plus
vulnérables aux phénomènes climatiques intenses et tendent à s’appauvrir encore d’avantage.
De nouvelles méthodes de gestion, durables, des sols doivent ainsi être mises en place dans une
double perspective de lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses effets. Il s’agit
notamment du recours à des techniques agricoles moins offensives utilisant la richesse des sols
sans les appauvrir. Il s’agit aussi d’encadrer l’urbanisation et de restaurer certains espaces
particulièrement sensibles.
Au niveau européen, ces préoccupations anciennes, renouvelées par la lutte contre le
changement climatique, cherchent encore une expression juridique. Alors que des textes existent
sur l’air, l’eau ou les habitats, le sol est le dernier des milieux biologiques à ne pas être protégé
par un texte juridique, ni en droit français ni en droit européen.
En 2006, une communication de la Commission européenne avait mis en avant la dégradation de
près de la moitié des sols couvrant la surface de l’Europe. Ce triste constat a donné lieu à un
projet de directive-cadre sur la protection des sols, qui devait constituer, selon les termes de son
rapporteur, « un premier pas en droit communautaire reconnaissant le rôle majeur de l’agriculture
dans le domaine de la protection des sols et prenant à bras le corps la question du changement

4
climatique »
1
. Votée par le Parlement européen en novembre 2007, son adoption a cependant
échoué au mois de décembre suivant, bloquée par une minorité d’Etats
2
, dont l’abstention de la
France. Le texte est depuis enterré… alors que l’urgence écologique qu’est la protection des sols
presse toujours.
Le 21 octobre dernier
3
, Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie, a annoncé que la France
ne s’opposerait plus à l’adoption de la directive. Les travaux vont donc pouvoir reprendre dès
2010, « Année de la Biodiversité », sous la présidence espagnole. Le projet initial visait
principalement à la lutte contre la pollution des sols ; organisant un mécanisme de recensement,
des stratégies d’assainissement et la définition de zones prioritaires exigeant une protection
renforcée. Les discussions à venir devront encore l’enrichir, et consacrer la protection de la
biodiversité des sols comme instrument essentiel de la lutte contre le changement climatique.
1
Parlement européen, Communiqué de presse du 14 novembre 2007 :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20071113IPR12975+0+DOC+XML+V0//FR
2
Minorité de blocage composée de l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France.
3
Annonce du 21 octobre dernier, faite à l’occasion des 2
èmes
rencontres nationales de la Recherche sur les sites et sols pollués
organisées par l’ADEME. Réaction de FNE : http://www.fne.asso.fr/fr/actualites/communiques-de-presse-
full.html?cmp_id=33&id=1272&news_id=1272

5
LES SOLS, PARTENAIRES OBLIGES DE LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les sols entretiennent avec le climat un jeu d’interactions complexes. D’un côté, les sols et la
biodiversité qu’ils abritent sont affectés par les conditions climatiques ; cet impact variant selon
l’intensité du changement et la vulnérabilité particulière du milieu considéré. De l’autre, les sols
influencent aussi indirectement le climat, pouvant aussi bien agir comme des capteurs et
réservoirs naturels de carbone que comme des sources d’émission de gaz à effet de serre.
Une ressource indispensable face au défi climatique
Une interface entre l’eau, l’air et la terre - Les sols, en lien étroit avec l’atmosphère, sont aussi
un élément clé des écosystèmes terrestres ; ils filtrent l’eau, stockent des nutriments, et abritent et
alimentent une grande diversité d’espèces vivantes. Une plus grande biodiversité dans les sols
permet d’augmenter la biodiversité sur les sols tout en garantissant leur productivité, ce qui au
passage permet de capter du CO₂ atmosphérique. Au contraire, leur dégradation et l’érosion
conduisent à une réduction de la biodiversité du sol (en particulier des populations de vers de
terre qui jouent un rôle crucial d’aération), et ont donc un impact sur l’ensemble de l’écosystème.
Un maillon du cycle du carbone - Les sols constituent un des plus gros stocks et réservoirs de
carbone sur Terre : les 2/3 des réserves mondiales de carbone terrestre (dans le sol et la
végétation) sont fixées dans le sol. Il en contient deux à trois fois plus que l’atmosphère ou la
biomasse, et est donc un élément clé du cycle du carbone. Rien qu’en Europe, on estime que le
sol contient environ 75 milliards de tonnes de carbone. Ce stock naturel résulte, directement, de la
capture du CO₂ par la photosynthèse des végétaux qu’il contient et, plus indirectement, de la
fixation en son sein de substances organiques, qui forment un humus stable. Les sols constituent
ainsi un réservoir à long terme de carbone.
Mais les sols sont aussi une source d’émission de gaz à effet de serre : de dioxyde de carbone et
de méthane ou de protoxyde d’azote :
• Du carbone est émis lors de la décomposition des substances organiques ;
• Du méthane peut être produit par certaines bactéries dans des sols riches en matière
organique mais pauvres en oxygène, comme les marécages ou les rizières ;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%