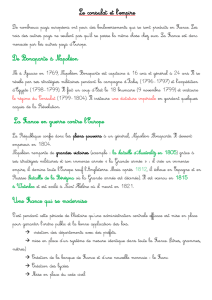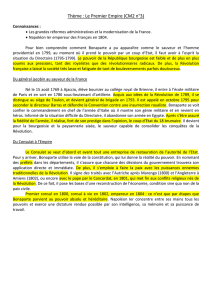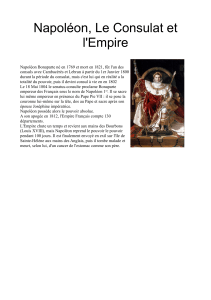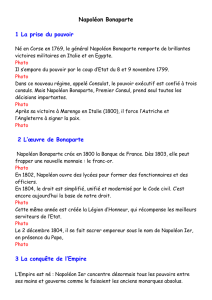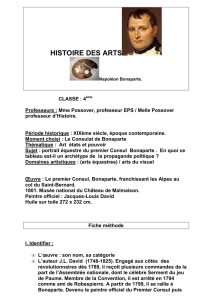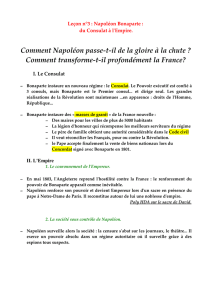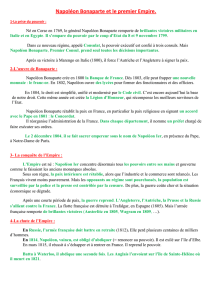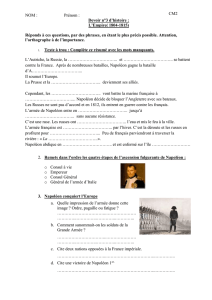Les Annales du Premier Empire n°3 - International Napoleonic Society

1
A
NNALES DU
P
REMIER
E
MPIRE

2
A
NNALES DU
P
REMIER
E
MPIRE
N° III
Rédacteur en chef : Dr Xavier Riaud
Souvenirs Editions

3
E
DITO
par
Xavier Riaud
Le monde napoléonien français est placé entièrement sous le contrôle d’une certaine intelligentsia
parisienne pour l’essentiel, qui ne tolère aucune contradiction et ne permet à aucune autre idée, thèse
hypothèse de se développer en France qui ne soit pas la leur.
Nous, les membres de la Société napoléonienne internationale (SNI), n’avons notamment pas voix au
chapitre. Son ancien président, M. Ben Weider, a émis l’hypothèse un jour, qu’il a prouvée
scientifiquement depuis avec brio, que Napoléon avait été empoisonné. Plutôt que de débattre, plutôt
que d’étudier le dossier en ayant recours aux différents moyens scientifiques envisageables, cette
intelligentsia napoléonienne française a balayé d’un grand revers de la main la seule idée que cela
puisse être possible et a décrété que nous, les membres de la SNI, serions des parias, en notre patrie,
parce que nous avions essayé d’apporter notre contribution à l’histoire du Premier Empire et que cela
les dérangeait.
Depuis, nous sommes isolés dans notre propre pays et nous ne sommes jamais publiés, jamais
sollicités pour la moindre manifestation, etc., à de trop rares exceptions. Pourtant, nombre d’entre nous
ont publié tant et tant d’articles, sans parler des livres, faisant de nous des connaisseurs plus qu’avertis
sur la question.
La Société napoléonienne internationale, basée au Canada, nous a accueillis avec chaleur et amitié, et
publie régulièrement nos travaux. Elle a récompensé nombre d’entre nous pour la valeur et la richesse
de nos travaux.
Pascal Cazottes est parvenu récemment à créer une revue avec un éditeur, qui s’appelait Vive
l’Empereur. Mais, cet éditeur peu opiniâtre, coutumier de ce type de démarrage arrêté aussitôt
commencé et près de son argent n’a pas eu la persévérance requise aux débuts prometteurs de toute
nouvelle revue qui cherche son public légitimement. Au bout du quatrième numéro, il a abandonné.
Ces Annales du Premier Empire sont un recueil d’articles de différents auteurs, tous membres de la
SNI. Cette mouture est la troisième du genre et a été passionnante à mettre en œuvre. Ces annales
seront reconduites pour une quatrième fois avec des sujets et des auteurs tout aussi divers que les trois
premiers numéros.
Napoléon a été au service de son peuple tout au long de son existence et a fait preuve d’une
abnégation, et d’une ténacité à nulle autre pareil. Nous aussi, finalement, essayons de mettre notre
savoir au service de son histoire, donc au service également du patrimoine de notre pays.
Peut-être, nous, les membres de la Société napoléonienne internationale, devons envisager d’en faire
encore plus ? Peut-être, faudrait-il envisager de nous regrouper en une société française, de publier
notre revue et d’organiser nos propres manifestations annuelles ? Je suis partant pour cela, mais je ne
suis pas seul à décider là encore.
En attendant, je vous laisse à des sujets aussi divers que trois études biographiques sur Dominique
Larrey, sur l’aide de camp général Premier Empire, sur l’armée des côtes de l’océan à la Grande
Armée, sur la supercherie Marmont
Bonne lecture et V
IVE L
’E
MPEREUR
!

4

5
A
IDE DE CAMP DE GENERAL
P
REMIER
E
MPIRE
par
Pierre Migliorini ()
Les 10 et 11 avril 2014, Thierry de Maigret, commissaire priseur, a proposé à la vente une
collection qualifiée de « Collection d’un grand amateur » ! Une visite à cette vente s’imposait, elle
valait visite d’un grand musée sur le thème du 1
er
Empire : gravures, tableaux, bustes et miniatures
côtoient armes de récompense, armes d’honneur, coiffures, uniformes ou cuivrerie… Nombre de
décorations étaient également mises en vente… La Garde impériale et la Garde consulaire étaient
représentées, le tout dans un état de conservation remarquable !
Je profite de la lecture du catalogue de cette vente pour aborder un thème peu connu : les
brassards d’aide de camp de général 1
er
Empire ; en effet, on peut en voir sur deux lots, un sur un
portrait d’époque, deux autres représentés sur une aquarelle de Lucien Rousselot.
Le descriptif du lot 46, illustré plus loin, nous dit : « Huile sur toile rectangulaire : Portrait
d'un capitaine aide de camp d'un général de brigade; il est représenté en buste, tête nue, en habit bleu,
passepoil bleu clair, boutons et épaulettes dorées, gilet blanc à brandebourgs dorés et porte, au bras
gauche, le brassard en passementerie d'or et soie bleue d'aide de camp des généraux de brigade; il est
décoré de la croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur du 3e type ; cadre doré d'époque; 65
x 55 cm. Époque Premier Empire. »
Le deuxième lot qui nous intéresse aujourd’hui est le lot 433 : « Aquarelle gouachée, signée en
bas à droite: "L. Rousselot": Le général de division d'Hautpoul commandant la grosse cavalerie;
cadre à baguettes doré et blanc; 53 x 72 cm. Époque première moitié du XXe. Très bon état ». Sur
cette aquarelle, fixons notre attention sur la partie droite où deux aides de camp du général d’Hautpoul
portent le brassard de leur fonction.
Lot 46 de la vente Thierry de Maigret du 10 avril 2014,
« Portrait d’un capitaine aide de camp d’un général de brigade… »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
1
/
70
100%