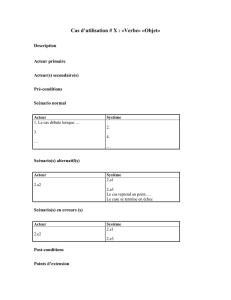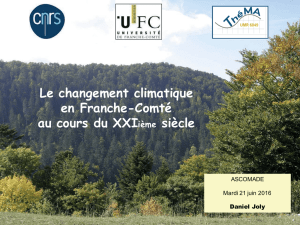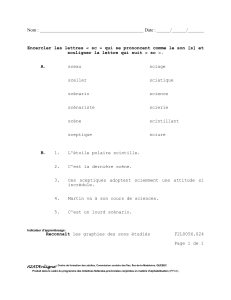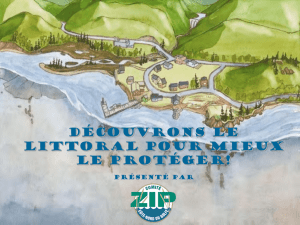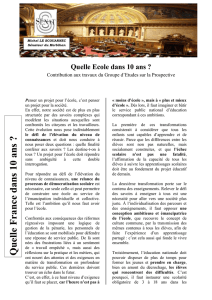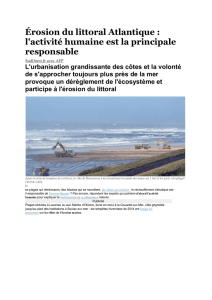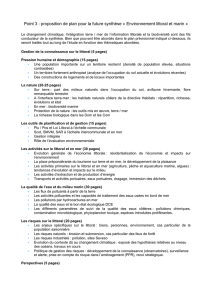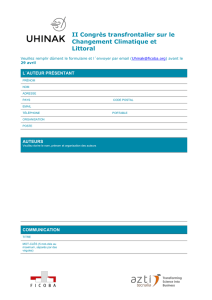Scénarisation Etude Climat - Stratégie adaptation HN (pdf

Scénarisation DREAL Haute-Normandie
Impacts possibles du changement climatique Impacts possibles du développement du territoire
Projections climatiques pertinentes (Note Météo France) Impacts liés Scénario de territoire tendanciel Impacts liés Scénario de territoire "positif"
Littoral et estuaires
Erosion du trait de côte
Submersion marine
- L'élévation des températures minimales en hiver explique une
réduction du nombre de jours de gel : le nombre de jours de gel
diminuerait de moitié d'ici la fin du 21ème siècle (de 40 jours
aujourd'hui à 15 à 25 jours en 2080) ; cette évolution conduirait à
une très faible occurence de gelée sur la zone littorale ;
- Les précipitations annuelles sont à la baisse pour
toutes les échéances et pour tous les scénarios : la
diminution est maximale à la fin du siècle avec -70mm à -150mm,
soit -10% à -20% du cumul actuel ;
- Le recul du cumul pluviométrique est légèrement plus
important près des côtes (c'est sur cette zone que les cumuls
sont les plus forts actuellement (1000mm contre 700mm au sud de
l'Eure))
La variabilité climatique qui s’exprime sur le littoral haut-normand
(notamment d’octobre à mars) est à l'origine d'une amplitude thermique et
de contrastes pluviométriques importants. Ils participent activement à la
dynamique littorale en offrant des conditions favorables au processus
d’érosion, renforcées en période de gel. Le recul pluviométrique et
la réduction projetée du nombre de jours de gel pourraient
avoir un effet positif sur la réduction de l'érosion du littoral à
falaises. Toutefois l'élévation du niveau de la mer et le
maintien des vents dominants et vents forts qui génèrent la
houle, agent d'érosion pourraient avoir un impact renforcant
sur le phénomène.
L'élévation du niveau marin devrait avoir un impact sur une
accentuation du phénomène d'érosion des plages de Haute-
Normandie.
- L'INSEE note que le littoral de la Côte d'Albâtre demeure un peu
plus densément peuplé que la moyenne de la région. Cependant,
l'attractivité des côtes de la Manche - contrairement à
la majeure partie des littoraux métropolitains - est en
recul.
- La croissance urbaine de la région Haute-Normandie se concentre
le long de la Seine ; l'agglomération du Havre fait
exception à la tendance de recul démographique du
littoral (la population de la ville et des villes périphériques connaît
une légère croissance) du fait d'une augmentation de l'activité
industrialo-portuaire
- L'activité portuaire de transports de marchandises
connaît une croissance soutenue au cours du 21ème siècle
du fait d'un soutien important de la part des autorités publiques.
L’érosion du littoral peut avoir des impacts écologiques (destruction de
milieux naturels à forte valeur biologique) et économiques (rupture de
routes, écroulement de maisons, fragilisation de paysages touristiques,
etc.).
La perte de dynamique du littoral devrait entraîner une stabilisation
des enjeux exposés à l'érosion. L'érosion étant un phénomène lent,
les principaux enjeux sont le maintien des espaces naturels et agricoles
"rongés" par l'érosion du trait de côte (la perte d'habitats pour la faune et
flore marine).
Les côtes reculent ou s’engraissent de façon naturelle, sous l’influence des
vagues, du vent, des courants, du gel et de la pluie suivant les saisons et
selon leur typologie. Toutefois, la croissance des activités
portuaires accompagnée d'une augmentation de
l'artificialisation des estuaires peut conduire à des
perturbations des flux de sédiments le long des côtes, qui
auraient pour conséquence une réduction du volume de certaines plages
(blocage de l'apport de sédiments continentaux, barrières aux courants et
flux solides). La réduction du volume des plages (phénomène de
subsidience) entraînerait une plus grande fragilité des côtes face
Un scénario positif d'aménagement du littoral pour la réduction
des impacts du climat sur le risque érosion veillerait à ce que,
dans l'artificialisation du littoral, les installations portuaires et
digues n'aboutissent pas à fixer le littoral ; il convient
d'assurer le maintien des flux de sédiments
essentiels à l'"auto-défense" des plages face à
l'érosion.
La dynamique d'aménagement devra suivre une vigilence sur
la localisation des bâtiments et équipements nouveaux ; il
s'agira d'intégrer les scénarios d'évolution du
climat dans les projets urbains littoraux.
- Les incertitudes sont encore très nombreuses sur l’évaluation de
l’élévation du niveau marin : l’ONERC retient une hypothèse «
optimiste » de +0,40 m, « pessimiste » de +0,60 m et «
extrême » de +1 m en 2100 par rapport à l’année 2000 ;
- Pas de changement notable, ni à la hausse, ni à la
baisse sur le phénomène « vent » ; le projet IMFREX parle
d'une hausse modérée du risque de tempêtes en
Manche et Mer du Nord
Les côtes normandes étant des zones à fort marnage, le risque de
submersion marine est réduit par de bas niveaux d’eau.
Même si les incertitudes concernant les tempêtes restent nombreuses, à
régime des tempêtes constant, l’élévation du niveau marin
devrait amplifier leur impact sur les littoraux. Du fait de cette
élévation, les vagues vont aller de plus en plus haut sur le rivage et
pourront ainsi modifier les profils des plages et des côtes rocheuses.
L’élévation du niveau de la mer va augmenter les risques de
submersion des zones littorales basses et pourrait fragiliser
de nombreuses digues et ainsi submerger les polders
arrière-littoraux.
- La croissance (modérée) de la population haut-normande
s'effectue principalement dans le département de l'Eure. Le littoral
de Seine-Maritime, et en particulier les villes
portuaires, sont peu attractives d'après l'INSEE (leur
population a reculé entre les recensements de 1999 et 2006). Le
scénario tendanciel pose toutefois l'hypothèse d'une légère
croissance urbaine dans l'agglomération du Havre.
- Le recul démographique du littoral n'empêche pas la dynamique de
construction sur le littoral de se maintenir (principalement des
résidences secondaires), accompagnée de la création
d'établissements de services touristiques (loisirs, balnéo, hôtellerie,
commerces, etc.).
- L'activité portuaire de transports de marchandises connaît une
croissance soutenue au cours du 21ème siècle du fait d'un soutien
important de la part des autorités publiques. Des extensions
importantes du port du Havre et des ports de proximité
du littoral (Dieppe, Fécamp, etc.) sont réalisées.
Les côtes basses urbanisées sont particulièrement sensibles au risque de
submersion de tempête ; l'extension des zones basses littorales
aménagées pour des activités industrialo-portuaires ou pour
des activités de loisirs/tourisme implique une augmentation
des enjeux exposés à la submersion.
Le maintien de l'activité de construction sur le littoral projeté dans le
scénario tendanciel, même s'il ne répond pas à une installation de
population résidente, a pour effet d'augmenter les enjeux exposés à la
submersion marine de tempête.
L’évaluation de l’évolution du risque de submersion marine à long terme
doit s’intéresser à l’évolution relative du niveau de la mer par rapport à la
côte (en mouvement elle aussi) ; les aménagement littoraux
pourraient créer une perte d'altitude de la côte du fait du
phénomène de subsidience (cf. ci-dessus), ce qui conduirait à
renforcer le risque de submersion pour ces territoires.
L'implantation projetée de nouveaux réacteurs nucléaires sur la côte haut-
normande (EPR de Penly à court terme) expose de nouveaux enjeux sur le
littoral régional (avec des effets en chaîne potentiellement importants pour
les systèmes écologiques et économiques locaux).
La réduction du risque de submersion dans le cadre d'un
scénario de territoire ambitieux implique une vigilence sur
l'exposition des nouveaux bâtiments et
équipements construits dans les zones à risque
dans une perspective d'évolution du climat (en
intégrant l'impact des aménagements littoraux et estuariens
sur les déterminents du phénomène de submersion). La mise
en oeuvre d'une politique d'urbanisation contrainte du littoral et
la préservation du cordon de galets et de l'épaisseur des
plages sont des éléments importants de cette politique
préventive du risque ; la généralisation des études
d'impact des aménagements littoraux sur la
morphologie des plages peut être une mesure de
soutien à un scénario de territoire positif.
Intrusion saline dans les
aquifères côtiers
- Les incertitudes sont encore très nombreuses sur l’évaluation de
l’élévation du niveau marin : l’ONERC retient une hypothèse «
optimiste » de +0,40 m, « pessimiste » de +0,60 m et «
extrême » de +1 m en 2100 par rapport à l’année 2000
- Les précipitations annuelles sont à la baisse pour
toutes les échéances et pour tous les scénarios ; le
recul du cumul pluviométrique est légèrement plus
important près des côtes
Les aquifères côtiers, qui sont en contact avec la mer sont plus ou moins
sensibles aux intrusions salines. Même si la vulnérabilité des aquifères
haut-normands est jugée moyenne par le BRGM, l'élévation du niveau
marin devrait faire évoluer l'équilibre eau douce/eau salée et
favoriser la pénétration d'un biseau salé dans les ressources
aquifères.
L'élévation du niveau marin et le recul pluviométrique (qui modifie les
temps d'inondation des espaces) sont de nature à modifier les salinités et
des valeurs de pH des sols en milieu estuariens. Cette évolution devrait
impacter la structure des communautés et sur la répartition spatiale des
espèces végétales. Globalement, la réorganisation des habitats
devrait se traduire par un accroissement des communautés
marines, au dépend des communautés typiquement
estuariennes.
- Le scénario tendanciel retient l'hypothèse d'une légère
croissance urbaine dans l'agglomération du Havre alors
que la population littorale présente une légère tendance au recul.
- La dynamique de construction sur le littoral est portée par le
développement des capacités d'accueil et loisirs à
destination des touristes.
L'augmentation des activités touristiques et, pour la région havraise, de la
population résidente entraîne une croissance de la pression
anthropique sur les aquifères côtiers (pour l'usage eau potable).
La croissance de ces prélèvements peut provoquer une perturbation de
l'équilibre eau douce/eau salée et le déplacement de
l'interface entre les masses d'eau, qui aurait pour
conséquence la salinisation de la ressource prélevée.
L'augmentation des prélèvements peut de ce fait renforcer l'impact de
l'élévation du niveau marin.
La prise en compte de l'élévation du niveau marin et de
l'augmentation "naturelle" de la pression saline dans les
aquifères côtiers dans le cadre d'un scénario positif conduirait
à maîtriser la demande en eau potable dans les
régions dépendantes des aquifères littoraux. Il s'agit
donc ici de conditionner les développements urbains
et touristiques sur le littoral à la capacité de
développement de l'exploitation des aquifères
côtiers ou à la possibilité d'exploitation d'autres
sources d'eau potable.
Fragilisation de la
biodiversité littorale et
estuarienne
- L'évolution de la température des eaux de surface est étroitement
liée à l'évolution de la température de l'air (au cours du 20ème
siècle, elle a augmenté de +1°C à l’échelle du globe et +2°C pour les
eaux de l’Atlantique Nord) ; il n'y a pas de projection sur le paramètre
mais l'évolution des températures de l'eau suivra celle
des températures atmosphériques ;
- Poursuite et accentuation de l'élévation de la
température atmosphérique moyenne projetée pour la
Haute-Normandie : +1,5°C à +3,5°C à l'horizon 2080 (l'augmentation
a été de +0,8°C dans le Nord de la France au cours du 20ème
siècle) ;
- Les incertitudes sont encore très nombreuses sur l’évaluation de
l’élévation du niveau marin : l’ONERC retient une hypothèse «
optimiste » de +0,40 m, « pessimiste » de +0,60 m et « extrême » de
+1 m en 2100 par rapport à l’année 2000
L’élévation du niveau de la mer peut provoquer une extension des
vasières à l’intérieur des fleuves et favoriser l’extension des
zones salées, ce qui peut impacter la biodiversité estuarienne.
La température de l’eau influence la phénologie de certaines
espèces et contrôle la répartition géographique de
nombreux organismes aquatiques.
L'évolution des équilibres climatiques peut être favorable à l'extension
de certaines plantes aquatiques invasives qui coloniseraient
les espaces estuariens et littoraux.
La tendance à la colonisation progressive d'espèces aviennes
méridionales devrait se poursuivre dans un contexte d'élévation des
températures atmosphériques.
- L'exploitation du littoral haut-normand est inscrite au
cœur du développement touristique de la région dans le
scénario tendanciel. Les équipements et bâtiments construits pour
favoriser la croissance du tourisme balnéaire sont installés dans les
zones basses, au plus près du front de mer (le littoral à falaises est
préservé).
- Dans les zones portuaires, le développement de l'activité
de transports maritime de marchandises a pour
conséquence l'accroissement des capacités d'accueil
et de stockage de biens le dans les estuaires. La
circulation des bateaux connaît une augmentation marquée dans les
ports haut-normands au cours du 21ème siècle.
Le développement de l'activité touristique et des capacités d'accueil des
zones portuaires entraîne une consommation importante
d'espaces naturels et un certain mitage des espaces
naturels sur la frange littorale (pression supplémentaire sur les
espaces intertidaux notamment, menacés par l'élévation du niveau de la
mer). Mitage et réduction des espaces naturels ont un impact direct sur la
capacité de certaines espèces faunistique et floristique à se maintenir
(développement, reproduction, migration).
L'impact des aménagements urbains est particulièrement
notable dans les espaces estuariens, interfaces entre le domaine
continental et le domaine marin, qui subissent un ensablement marqué du
fait de la croissance de l'activité portuaire (artificialisation des estuaires et
augmentation du trafic maritime), d'une part, et une salinisation du fait de
l'élévation du niveau marin, d'autre part.
La protection des habitats littoraux et estuariens devient un
objectif central des documents d'urbanisme et
d'aménagement du littoral dans le scénario positif. Une
dynamique de compensation des consommations
d'espaces intertidaux pour l'urbanisation (par la
création de nouveaux espaces pour le développement
d'habitats faunistiques et floristiques) est inscrite dans les
pratiques d'aménagement local.
La lutte contre la fragmentation des espaces
naturels inscrite dans le scénario positif permet de maintenir
les capacités d'accueil de populations avicoles migrant en
nombre important.
Fragilisation des
activités de pêche et
conchyliculture
- L'évolution de la température des eaux de surface est étroitement
liée à l'évolution de la température de l'air (au cours du 20ème
siècle, elle a augmenté de +1°C à l’échelle du globe et +2°C pour les
eaux de l’Atlantique Nord) ; il n'y a pas de projection sur le paramètre
mais l'évolution des températures de l'eau suivra celle
des températures atmosphériques ;
- Poursuite et accentuation de l'élévation de la
température atmosphérique moyenne projetée pour la
Haute-Normandie : +1,5°C à +3,5°C à l'horizon 2080 (l'augmentation
a été de +0,8°C dans le Nord de la France au cours du 20ème
siècle) ;
- Elévation de la température moyenne maximale (moyenne annuelle
des températures maximales quotidiennes) supérieure à l'élévation
de la température moyenne : +2°C à +6°C d'ici la fin du 21ème
siècle ;
- L'élévation des températures minimales en hiver explique une
réduction du nombre de jours de gel : le nombre de jours de
gel diminuerait de moitié d'ici la fin du 21ème siècle (de 40 jours
aujourd'hui à 15 à 25 jours en 2080) ; cette évolution conduirait à
une très faible occurence de gelée sur la zone littorale
L'élévation de la température des eaux de surface devrait amener une
évolution de la période de migration de certaines espèces
de poissons et peut aboutir à la disparition de certaines
espèces dans les espaces estuariens et littoraux.
L'évolution des aires de répartition de certaines espèces et l'évolution des
cycles de vie (perturbation des périodes de reproduction par exemple)
peuvent avoir un impact important sur le rapport
proie/prédateur et conduire à une disparition de certaines
espèces.
Les activités de pêche et conchyliculture subissent les impacts
d’évènements de submersion marine de tempêtes, qui devraient
augmenter. L’élévation de la température de l’eau marine peut impliquer
un processus de dégradation de la qualité de
l’environnement littoral défavorable aux espèces conchylicoles.
Le recul des gelées et l'élévation des températures minimales et moyennes
en hiver devrait impacter la production conchylicole.
L'augmentation de la fréquence des épisodes caniculaires devrait
impacter la répartition des espèces de poissons.
L’augmentation de la température devrait également
modifier la composition phytoplanctonique. Une anomalie
thermique (négative l’hiver et positive l’été) peut avoir des
conséquences directes sur la composition
phytoplanctonique et sur la taille des espèces. Ces évolutions
demanderont une adaptation de la filière pêche.
- Le scénario tendanciel prévoit une augmentation de
l'artificialisation de l'estuaire de la Seine du fait
notamment du développement de la zone industrialo-portuaire du
Havre et de l'activité des ports haut-normands. Les autres estuaires
haut-normands connaissent une artificialisation moins marquée.
- L'activité de pêche côtière en Haute-Normandie se maintient dans
un contexte concurrentiel difficile.
- L'activité portuaire est en croissance forte au cours du 21ème
siècle
L'artificialisation croissante de l'estuaire de la Seine et des espaces
estuariens en Haute-Normandie, cumulée à l'augmentation de l'activité
portuaire, aura un impact sur la qualité de l'environnement littoral ; elle
peut impliquer une certaine pollution de l'eau qui renforce
l'impact de l'élévation des températures marines sur la
dégradation des processus biogéochimiques (blooms algueux
et/ou phytoplanctoniques).
La circulation des bateaux peut être impactée par l'eutrophisation de l'eau
dans l'espace estuarien (obstruation des circuits de refroidissement) ; la
gestion des opérations portuaires peut, de ce fait, devenir
plus compliquée et plus coûteuse.
Le maintien des espèces exploitées par la filière de pêche
maritime passe par le maintien des capacités
nourricières des estuaires. C'est une orientation
essentielle du scénario positif.
Le développement des activités portuaires dans un scénario
positif veillerait par ailleurs à ne pas augmenter la
pollution de l'eau ; cela intègre une vigilence dans le cadre
des aménagements portuaires et une surveillance étroite des
circulations des bateaux.

Scénarisation DREAL Haute-Normandie
Impacts possibles du changement climatique Impacts possibles du développement du territoire
Projections climatiques pertinentes (Note Météo France) Impacts liés Scénario de territoire tendanciel Impacts liés Scénario de territoire "positif"
Espaces naturels et ruraux
Erosion de la biodiversité
Erosion des sols/ Coulées
boueuses
- L'évolution des fortes pluies n'est pas significative,
moins de 10% en valeur relative par rapport à la climatologie de
référence, même si en 2080 la tendance semble plutôt négative ;
A l’horizon 2030 en Seine Maritime le cumul de précipitations
hivernales pourrait augmenter de 1 à 4,5% et à l’horizon 2050 de 5 à
6%
La tendance s’inverse à plus long terme (2080), le bassin versant
pouvant perdre de 1,6% à 8,5% du cumul de précipitation sur la
période hivernale
Les événements de pluies intenses (pluies d’hiver et orages de printemps)
vont provoquer des phénomènes d’érosion et de ruissellement
entraînant des inondations et coulées boueuses. La Seine-Maritime
est particulièrement concernée : le pays de Caux concentre les pluies
orageuses de mai à octobre, pouvant entraîner une pluviométrie
importante en quelques heures et déclencher des phénomènes de coulées
boueuses.
Les projections ne permettent pas de trancher sur l'évolution de la
fréquence de ces événements, le risque érosion doit donc
demeurer un point d'attention dans le futur.
La problématique érosion/ inondation et coulées boueuse est bien
identifiée sur le territoire et des mesures sont mises en oeuvre. La
problématique érosion commence à être intégrée dans les
documents réglementaires (PLU, PPRI). Les objectifs de
développement régionaux des filières agricoles respectueuses de
l'environnement vont dans le sens du maintien de zones enherbées,
réduisant le risque érosion.
Cependant, la mise en place d'actions en amont sur les pratiques
culturales des agriculteurs et sur la gestion des eaux pluviales
urbaines des aménageurs demeurent volontaires et ne sont pas
systématiques. Les difficultés à mettre en oeuvre le "décret érosion"
sur le bassin de la Lézarde se prolongent et font que la
généralisation de ce type d'outil n'est pas prévue.
L'intégration du risque érosion dans les documents d'urbanisme, dans les
pratiques d'aménagement et agricoles continue de progresser. Cependant,
ces mesures n'assurent pas une prise en compte systémique du
risque érosion et restent encore peu contraignantes par rapport à la
priorité donnée à l'urbanisation. A l'échelle des activités et des
populations, la prise en compte du risque demeure marginale.
Le risque érosion est pris en compte de façon systématique
dans les choix de développement du territoire : un plan de gestion
des zones à risque élevé de ruissellement (comme définies par le
BRGM) est établi. Le projet de développement agricole,
déterminant pour l'évolution du risque érosion, est réfléchi en
fonction de cette problématique mais aussi de celles de la
ressource en biodiversité et en eau. Les mesures d'hydraulique
douce sont mises en oeuvre systématiquement dans les zones les
plus concernées, il en est de même de pratiques agricoles
alternatives et de petits aménagements (ex : enherbement) pour
limiter les effets d'imperméabilisation et l'érosion.
A l'échelle des activités et des populations a lieu un déploiement
massif de diagnostics de vulnérabilité dans les zones à risque.
Réduction de la
ressource en eau
Dégradation de la qualité
des eaux dans les
captages
- Le paramètre longue pluie en hiver est globalement à
la baisse sur toutes les échéances et tous les scénarios ;
Selon les projections de Météo France, le cumul annuel de
précipitation pourrait varier d’environ 3% sur l’ensemble de la région
à horizon 2030 et de 10 à 12% à l’horizon 2080 (cette tendance
pouvant être observée dès 2050 dans le scénario de réchauffement
le plus important) . Le cumul hivernal (essentiel à la recharge des
nappes) pourrait augmenter à l’horizon 2030 et 2050 mais diminuer
un peu à long terme (-4 à 5%), le cumul estival (qui va impacter les
débits d’étiage) diminuerait de façon plus drastique : déficit de 10 à
15% en 2030 et de -20 à -25% à l’horizon 2080 (plus marqués sur le
bassin de l’Eure). On arriverait à un niveau critique de 35% à 70%
de jours de sécheresse par an à l'horizon 2080, alors
qu'actuellement l'indicateur est inférieur à 10%. L’évolution serait
sensible dès 2030.
- L'évolution des fortes pluies n'est pas significative,
moins de 10% en valeur relative par rapport à la climatologie de
référence, même si en 2080 la tendance semble plutôt négative ;
- Sur la quantité : La réduction du cumul pluviométrique peut avoir des
incidences sur la recharge des nappes en hiver et le renforcement des
étiages sévères en été. La Haute Normandie est affectée par des
crises de sécheresse depuis 2003. Ce phénomène pourrait ainsi
s'accentuer à long terme.
- Sur la qualité : l’évolution de la température moyenne et des variations
de température autour de la moyenne peuvent modifier la température de
l’eau, les modifications du niveau cours d’eau vont impacter la
concentration de polluants, les phénomènes d’inondation et coulées
boueuses peuvent contaminer les captages d’eau potable. Si les
projections ne donnent pas de tendances significatives sur l'évolution des
pluies extrêmes, le risque de pollution des captages doit demeurer un
point de vigilance dans le futur.
Le SDAGE prévoit de gérer la rareté pour certaines masses
d'eau. Une gestion collective pour les masses d’eau (ou partie de
masses d’eau) souterraines en mauvais état quantitatif est mise en
place. Les masses d'eau font l’objet d’un bilan détaillé en vue de
déterminer les limites maximales de prélèvements.
D'un point de vue qualitatif, en dépit d'actions dédiées à l'évolution
des pratiques agricoles, une part majoritaire des masses d'eau n'est
pas au bon état écologique en 2012, la réalisation des objectifs
prend du retard.
L'intégration du changement climatique dans le SDAGE n'est pas
pleinement effective pour la révision du schéma en 2015.
La mise en oeuvre du SDAGE vient améliorer la gestion quantitative de la
ressource pour les masses d'eau en mauvais état quantitatif déjà
identifiées.
En dépit des actions dédiées à l'agriculture, un effort important reste à
consentir pour atteindre les objectifs de bon état écologique du SDAGE,
ainsi, du retard (2017 voire au-delà) est à prévoir sur l'atteinte des
objectifs de bon état écologique.
La mise en oeuvre du SDAGE impulse une dynamique sur le territoire
mais n'apporte pas une réponse globale à la baisse future du
cumul pluviométrique : de nouveaux points de tensions sur la ressource
(quantitatif et qualitatifs) apparaissent progressivement. La question du
changement climatique s'intègre au SDAGE tardivement, au fur et à
mesure des tensions constatées.
L'intégration du changement climatique devient proactive : une
étude dédiée est menée afin d'évaluer les conséquences de la
baisse du cumul pluviométrique sur le fonctionnement hydrologique
des bassins versants en Haute Normandie. En découle des
recommandations sur la répartition des usages de l'eau sur le
territoire et leur évolution en vue de les intégrer au SDAGE dès
2015 (et mise en place d'un processus d'amélioration continue sur
la connaissance des impacts et leur gestion).
Evolution des
rendements agricoles et
des filières agro-
alimentaires
- En été, les projections montrent une baisse des précipitations de
-10% environ dès 2030 et allant de -10% à -30% à l'horizon 2080,
sur un total de 300mm environ ;
- Le nombre de jours en situation de sécheresse
augmente déjà de 20% environ en 2030 et de 35% à 60% à
l'horizon 2080 ;
Les projections de Météo France vont dans le sens d’une hausse
des températures annuelles moyennes : de +1 à +1,4°C à 2030 ; de
+1,1 à +1,9 °C à 2050 et +1,6 à+3°C en 2080, avec une variation
estivale plus importante (les températures maximales varieraient de
+3 à +6°C dans l’intérieur des terres). Le nombre de jours de gel est
en diminution sensible dès 2030 sur tout le territoire: dans le
scénario B1 (faible changement climatique au niveau global) le
nombre de jours de gel diminue entre 30 (Eure) et 35% (Seine
Maritime), ce qui correspond à ce que connaît la Bretagne
actuellement. Les précipitations annuelles sont également en
diminution, plus fortement en été : selon Météo France, on arriverait
à un niveau critique de 35% à 70% de jours de sécheresse par an à
l'horizon 2080, alors qu'actuellement l'indicateur est inférieur à 10%.
La modification des paramètres climatiques comme la température, le
nombre de jours de gels et les régimes de vents et précipitations vont
entraîner des modifications des potentialités agro-climatiques au
niveau régional. Ces modifications climatiques peuvent avoir des effets :
- sur la phénologie des espèces et les durées favorables au
développement des cultures
- sur les rendements : effet positif de l’augmentation de la température
et des concentrations en CO2 ; effet négatif du développement possible de
nouveaux ravageurs ou de l’apparition de conditions de stress hydriques
Les axes stratégiques régionaux du développement de l'agriculture
définis par le Plan régional d'agriculture durable (PRAD) visent en
priorité à accroître la valeur ajoutée crée par les exploitations. Il
s'agit notamment d'accompagner les activités de valorisation locale
des productions haut-normandes, autour du maintien de
l'élevage, d'une part, dont l'autonomie serait renforcée par le
développement des cultures légumineuses et de l'herbe
et du développement du maraîchage, d'autre part.
Le développement de filières respectueuses de
l'environnement et d'une politique qualité des produits (filières
courtes, bio, labellisation, etc.) font partie des priorités de
développement.
Des actions continuent d'être entreprises pour favoriser l'intégration
des enjeux environnementaux - enjeux d'érosion, de
préservation de la biodiversité et de protection de la
ressource en eau (cohérence avec le SDAGE) notamment - à
l'échelle des exploitations. Un objectif de développement du tourisme
à la ferme et de l'agro-foresterie pour diversifier les activités des
exploitants est défini par le PRAD.
Les orientations du PRAD ne sont pas incompatibles avec les évolutions
climatiques de court terme mais pourraient créer, à moyen-long terme, une
plus grande exposition des activités aux aléas climatiques : les activités
fourragères et maraîchères pourraient souffrir d'un manque d'eau.
L'intégration des enjeux de préservation de la biodiversité, de préservation
des paysages et de protection de la qualité de la ressource en eau dans le
PRAD, dans une optique de valorisation du territoire et des productions
agricoles, est une orientation positive pour la pérennisation de l'activité.
Des recommandations sont formulées dans le PRAD pour
accompagner, dans une mutation progressive, les
exploitations et les filières agroalimentaires qui y sont liées vers une
plus grande création de valeur ajoutée.
Le territoire se prépare à tirer profit des opportunités qui sont
liées à l'augmentation des rendements (fourragers et herbe) et
peuvent contribuer à un renforcement de l'activité d'élevage par
une plus grande autonomie des exploitations.
Dans le long terme, les potentialités de nouvelles cultures pouvant
fonder une identité de terroir (vigne) devront être étudiées à
l'échelle régionale; l'exploitation des possibles
opportunités de développements de l'activité agro-
touristique sont déjà inscrites dans le PRAD.*
Les projections de quelques degrés de plus sur la température
moyenne à Rouen ou Évreux à l’horizon de fin de siècle correspond
à la température actuelle de Bordeaux par exemple. Mais c’est
aussi l’évolution de la variabilité des températures autour
de la moyenne, des régimes de précipitations, du
nombre de jour de gel, de l’ensoleillement qui, cumulés
aux perturbations anthropiques et à l’évolution naturelle des milieux,
vont aboutir à de nouvelles conditions de vie pour les espèces.
Les conséquences du changement climatique sur la biodiversité et les
forêts recoupent l’évolution des paramètres climatiques auxquels peuvent
être particulièrement sensibles certaines espèces et qui vont contribuer à
(re)définir leur aire de répartition et leur abondance relative et
avoir également des impacts sur leur phénologie (débourrement plus
précoce, chute de feuille plus tardive par exemple en forêt). De
nouvelles espèces voire ravageurs ou parasites sont
susceptibles d’apparaître.
Dans un premier temps, les mesures mises en place concerne un
état des lieux des acteurs de la biodiversité, la collecte et la
structuration des données existantes, coordonné par l'OBHN. Des
objectifs et un plan d'action suivent progressivement.
La politique de biodiversité a comme objectif d'enrayer l'érosion
constatée. Les trames vertes et bleues se mettent en place
progressivement.
La problématique changement climatique n'est pas une priorité
(l'identification des espèces concernées reste balbutiante). Pour autant, les
actions en faveur de la biodiversité vont dans le sens de la préparation du
territoire au changement climatique.
A court terme, la connaissance des impacts du changement
climatique sur la biodiversité est complétée et renforcée.
Des actions précoces sont mises en place sur la biodiversité,
en allant plus loin sur :
- une re-diversification systématique du paysage en complément
des aménagements,
- un ré-enrichissement des peuplements
- des mesures favorisant la circulation des espèces.
Compte tenu de la tendance à la densification, tout
aménagement intègre une compétence biodiversité et des
mesures en faveur de la biodiversité (tout en intégrant les autres
problématiques d'érosion, eau, énergie...).

Scénarisation DREAL Haute-Normandie
Impacts possibles du changement climatique Impacts possibles du développement du territoire
Projections climatiques pertinentes (Note Météo France) Impacts liés Scénario de territoire tendanciel Impacts liés Scénario de territoire "positif"
Zones urbaines
Inondation (débordement
de cours d'eau et
ruissellement)
- Les précipitations annuelles sont à la baisse pour toutes
les échéances et pour tous les scénarios : la diminution est
maximale à la fin du siècle avec -70mm à -150mm, soit -10% à -20%
du cumul actuel ;
- Une grande partie de la baisse des précipitations se
concentre sur les 6 mois les plus chauds ;
- L'évolution des fortes pluies n'est pas significative,
moins de 10% en valeur relative par rapport à la climatologie de
référence, même si en 2080 la tendance semble plutôt négative ; la
baisse du cumul total ne serait pas issue d'une diminution de
l'intensité des phénomènes pluvieux, mais de leur fréquence ;
- Le paramètre longue pluie en hiver est globalement à
la baisse sur toutes les échéances et tous les scénarios ;
- Pas de tendance affirmée sur l'évolution des débits des cours d'eau
mais prévisions de légère réduction du débit de la Seine
Les projections d'évolution de la pluviométrie et des débits des cours d'eau
ne permettent pas d'estimer de tendance forte sur l'évolution du risque
inondation, par débordement de cours d'eau et par ruissellement : le
risque inondation devrait se stabiliser.
Dans certaines zones estuariennes, l'élévation du niveau de
la mer peut, par un effet sur la hausse du niveau des fleuves,
renforcer le risque inondation par débordement ; cet effet peut
avoir un impact sur les zones industrielles (dans l'estuaire de la Seine
notamment) et, de manière indirecte, sur l'activité portuaire.
- La présence des agglomérations rouennaise et havraise est
renforcée par l'urbanisation croissante le long de la Seine
au cours du 21ème siècle pour faire des rives de Seine
un espace relativement dense.
- De nombreuses industries s'installent sur les bords de
Seine dans le scénario tendanciel pour accéder au fleuve et au
transport fluvial, puis maritime. Les activités logistiques se
développent pour occuper un espace de plus en plus étendu en bord
de Seine.
- Une importante offre de services se développe le long
de l'Axe Seine, qui crée un volume d'emploi important.
Les enjeux humains et matériels exposés au risque
inondation par ruissellement augmentent dans le scénario
tendanciel du fait d'une politique d'intensification urbaine qui
augmente la concentration de populations, d’activités économiques, de
services, d’équipements et d’infrastructures dans les zones urbanisées.
La densification urbaine peut conduire par ailleurs à une croissance de
l'artificialisation des espaces urbains qui entraînerait une
augmentation du risque inondation lié au phénomène de
ruissellement (la densification urbaine modifie les régimes d'écoulement
des eaux en surface et crée une pression supplémentaire sur les systèmes
d'évacuation des eaux pluviales et réduit les espaces d'infiltration des eaux
de pluie) ; volume d'eau ruisselée et débits et vitesses d'écoulement
augmentent.
Le scénario tendanciel prévoit égalemenet une augmentation des
enjeux exposés au risque inondation par débordement de
cours d'eau avec l'installation d'activités et population sur les rives du
fleuve. Le risque de débordement peut augmenter en aval des
zones les plus densément urbanisées si l'artificialisation des bords
de Seine conduit à une augmentation des rejets dans la Seine (diminution
de l'infiltration et évacuation des eaux de pluie).
Dans le scénario positif, une vigilance particulière est
apportée, dans le cadre des projets urbains, à prendre en
compte les impacts possibles des aménagements sur le cycle
de l'eau. Les études d'impact du projet urbain sur
l'évacuation des eaux de pluie et le risque
inondation par ruissellement sont généralisées
pour tous les projets urbains. Les données climatiques
de référence intégrées dans ces études prennent en compte
l'évolution projetée du climat (pluviométrie et température
notamment).
Le scénario positif implique également un "changement" dans
l'approche des projets urbains en zone à risque :
l'élaboration de Plans de préventin du risque
inondation dans les zones urbanisées de l'Axe
Seine prend en compte l'évolution possible des
aléas de référence, analysés à l'échelle micro dans un
contexte de changement climatique.
Dégradation de la qualité
de l'air
- Elévation de la température moyenne maximale
supérieure à l'élévation de la température moyenne :
+2°C à +6°C d'ici la fin du 21ème siècle ;
- Les jours de fortes chaleurs passent du statut
d'évènement rare à celui d'évènement courant : 10 à 40
jours concernés selon les scénarios et les zones en 2080 contre 5
en Seine-Maritime et 15 dans l'Eure en moyenne aujourd'hui ;
- Explosion du paramètre canicule : 5 à 15 cas en moyenne
par an en 2080 contre moins de 1 cas par an aujourd'hui ;
- L'intérieur des terres est plus marqué par le réchauffement ;
- L'été est plus fortement concerné par l'élévation des
températures : la température moyenne estivale augmente de
+2°C à +5°C à l'horizon 2080
Toutes choses égales par ailleurs, l'augmentation de la température
atmosphérique est de nature à renforcer les conditions favorables au
développement de l'ozone ; le changement climatique devrait
donc avoir un effet de dégradation de la qualité de l'air. Cette
dégradation de la qualité de l'air sera d'autant plus marquée dans les
centres urbains denses et dans les zones industrielles où se concentrent
les activités émettrices de polluants primaires de l'ozone (transport,
consommation énergétique dans les bâtiments ou l'industrie, etc.).
Il n'y a pas de tendance d'évolution des vents et les zones soumises aux
déplacements d'ozone aujourd'hui ne devraient pas évoluer. Les zones
agricoles et naturelles aujourd'hui impactées par une dégradation végétale
le seront plus fortement aux horizons 2050 et 2100.
La période d'apparition du phénomène de pollution par
l'ozone devrait s'étendre et l'aggravation du phénomène
devrait être plus importante l'été alors que les températures
estivales connaîtront des anomalies plus marquées.
- La concentration urbaine se développe le long de
l'Axe Seine, avec l'extension notamment des agglomérations de
Rouen et Le Havre.
- Les agglomérations connaissent une croissance
"intensive" organisée autour d'une densification
urbaine plus qu'une extension (cet objectif répond aux orientations
de la politique énergie-GES pour la maîtrise des consommations
énergétiques du territoire). Une composante importante de cette
croissance intensive est la revalorisation du cadre urbain
existant par des opérations de rénovation thermique
des bâtiments.
- Le développement des modes de transports alternatifs
(ferré et fluvial) est concentré sur le transport de
marchandises et le transport de voyageurs longue
distance (LGV) dans le scénario tendanciel.
- Les activités industrielles installées le long de la
Seine sont en croissance (notamment dans la zone industrialo-
portuaire du Havre qui s'étend).
- Les activités logistiques pour assurer le relais entre
transport terrestre et transport fluvial/maritime
connaissent un développement marqué le long de l'Axe
Seine.
La plus grande concentration des activités anthropiques (logements,
activités économiques, transports routiers, etc.) dans les zones urbanisées
est la source d'une augmentation de la pollution
atmosphérique dans les zones urbanisées. Le scénario
tendanciel correspond donc à un scénario de croissance de la
pollution à l'ozone des zones urbaines dans un contexte
climatique d'élévation des températures et d'augmentation de la fréquence
des périodes de fortes chaleurs et épisodes caniculaires.
L'augmentation de la pollution par l'ozone a un impact sur la
santé des résidents des agglomérations et, en zones
périurbaines où se déplacent l'ozone, sur la végétation.
Dans le bâti, la politique d'isolation des bâtiments peut conduire à une
dégradation de la qualité de l'air intérieur.
La vigilance sur le maintien/l'amélioration de la qualité de l'air
des zones urbanisées de la région dans le scénario positif
conduit à une évolution de l'organisation de la
politique urbaine avec l'intégration de contraintes
fortes sur les activités de transport routier et
pollutions industrielles (notamment lors des épisodes de
fortes chaleurs). La politique de transport évolue donc vers le
soutien aux modes alternatifs aux véhicules
routiers (transports ferrés de voyageurs et
marchandises, transports fluviaux de voyageurs et
marchandises, interconnexions fer-voie d'eau,
etc.) - la politique de transport est ici un point de
convergence important entre volet atténuation et volet
adaptation de la stratégie de développement durable de la
région.
Dans l'industrie, la région soutient une politique de maîtrise de
l'énergie et de développement de l'usage des énergies
renouvelables.
Effet îlot de chaleur
urbain
L'élévation des températures atmosphériques devrait avoir un impact
important sur le développement du phénomène d'îlot de chaleur urbain.
L'augmentation de la fréquence des épisodes de fortes
chaleurs et épisodes caniculaires projetée par Météo France
est un élément impactant majeur. Rouen, à l'intérieur des terres où
le réchauffement projeté est plus important, devrait connaître une certaine
augmentation du phénomène d'îlot de chaleur urbain (Le Havre, plus
aérée, est moins concernée).
L'augmentation du phénomène d'îlot de chaleur urbain
devrait avoir un impact important sur les populations
vulnérables (populations âgées et malades), renforcé par la dégradation
possible de la qualité de l'air.
La densification et la politique de rénovation thermique du bâti dans un
objectif d'amélioration de l'isolation des bâtiments se traduisent par une
augmentation de la surface des espaces urbains favorables
au développement d'îlots de chaleur urbains.
L'objectif du scénario de territoire positif au regard des enjeux
de préservation des zones urbaines de Haute-Normandie face
aux impacts potentiels du phénomène d'îlot de chaleur urbain
est d'engager une politique de revitalisation du cadre
urbain (rénovation du bâti existant et densification
de "la ville sur la ville") qui intègre les paramètres
des périodes climatiques chaudes et froides. Les
politiques de rénovation du bâti sont aujourd'hui conduites
dans un objectif de maîtrise du besoin de chauffage mais il est
nécessaire d'étudier le comportement du bâti lors des
épisodes de fortes chaleurs (restitution nocturne de la chaleur,
conception du rafraichissment du cadre urbain, organisation
de la circulation de l'air, etc.).
1
/
3
100%