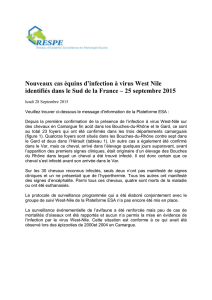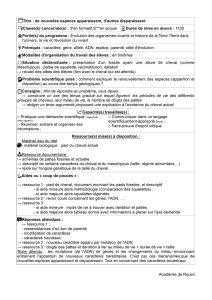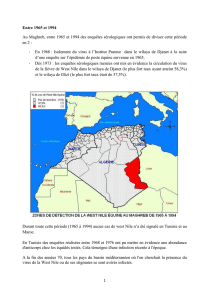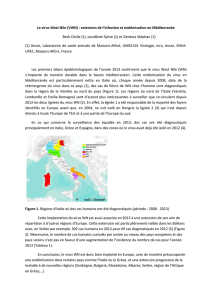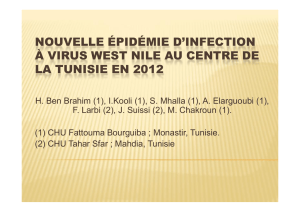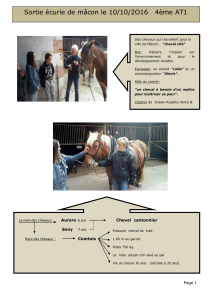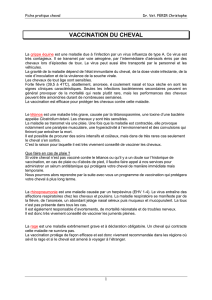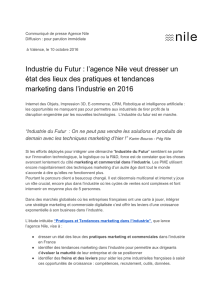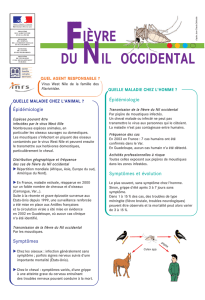Prévalence de l`infection par le virus West Nile chez le cheval en

La maladie de West Nile est une arbovirose, transmise par
des arthropodes hématophages, essentiellement des mous-
tiques. La maladie peut occasionnellement toucher l’homme
et le cheval, qui sont considérés comme des impasses épidé-
miologiques [10]. La maladie se traduit alors par des formes
variables allant de l’infection asymptomatique au décès [3,
17].
Les chevaux (et autres équidés) sont considérés comme
plus sensibles que l’homme et donc souvent comme les révé-
lateurs de la circulation du virus [18, 19]. Plusieurs épizoo-
ties ont eu lieu récemment : Egypte 1960 [1], France 1962-
63 [11, 19], Maroc 1996 [2], Italie 1998 [4], USA depuis
1999 [17, 24]. Au cours de ces épizooties, le taux de létalité,
bien supérieur à ce qui est observé chez l’homme, a varié de
26 à 43%.
Les vecteurs seraient essentiellement des moustiques orni-
thophiles [14]. Les oiseaux sont des réservoirs biologiques à
l’intérieur desquels le virus s’amplifie [26]. La mortalité est
faible. Le rôle des oiseaux migrateurs dans la réintroduction
et la dissémination du virus d’un pays à un autre a été forte-
ment envisagé, notamment lors de l’épidémie de Roumanie
en 1996 (migration de l’Afrique du Nord vers la Roumanie
[23]) et plus récemment en Israël [15]. Plus de 25 espèces
réservoirs ont été répertoriées en Europe [10, 21].
En France, une épizootie de West Nile fut signalée en
1962-1963 en Camargue chez des chevaux avec plusieurs
cas humains associés [20]. Une enquête sérologique menée
en 1975-1976 avait mis en évidence des anticorps dans les
populations animales [22]. Depuis, aucune épizootie n’avait
été signalée. En août 2000, à environ 35 km de Montpellier,
une seconde épizootie de West Nile s’est déclarée [16]. Au 5
novembre 2000, 78 cas équins (définis par la présence de
signes cliniques évocateurs associés à une réaction positive
par une technique ELISA de détection des IgM dont la pré-
sence signe une infection récente) ont été diagnostiqués, 21
sont morts. Trois départements ont été concernés : l’Hérault,
le Gard et les Bouches-du-Rhône. Malgré de nombreuses
suspicions, aucun cas humain n’a été recensé.
Une large étude sérologique a été réalisée sur tous les ani-
maux localisés à 10 Km autour d’un cas probable ou
confirmé par le laboratoire. Les échantillons sanguins ont été
obtenus pour 5107 chevaux [7]. La prévalence des IgG obte-
nue a été p = 8,5 %. Aucun effet de l’âge sur la séropréva-
lence n’a été observé, mais un effet de la taille de l’effectif
des chevaux a été trouvé. Les chevaux vivant dans un petit
effectif étaient plus souvent infectés que ceux d’un effectif
plus grand. La répartition géographique des chevaux positifs
a montré l’existence d’une zone à haute prévalence en zone
sèche, dans la région de Lunel. Des moustiques ont été col-
lectés dans la zone et aucun « pool » n’a été trouvé positif, le
vecteur principal de cette épizootie demeure donc inconnu.
Prévalence de l’infection par le virus West Nile
chez le cheval en Camargue en 2001
A. LEBLOND1*, S. ZIENTARA2, J. CHADOEUF3, N. COMBY4, M.A. HENG5et P. SABATIER1
1TIMC - UMR 5525 - Unité Environnement et Prévision de la Santé des Populations, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, 1 avenue Bourgelat , 69280 Marcy l’Etoile, France.
2Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, 22 rue Pierre Curie, 94703 Maisons-Alfort Cedex 07, France.
3INRA Laboratoire de Biométrie, Site Agroparc, 84914 Avignon Cedex 9, France.
4Institut Universitaire Professionnalisé de Vannes, Génie Informatique et Statistique, rue Yves Mainguy, 56000 Vannes, France.
5Cabinet Vétérinaire, rue de Chenours BP 29, 19230 Arnac Pompadour, France.
* Auteur chargé de la correspondance : [email protected]
SUMMARY
Prevalence for West Nile Virus infection in the horse in the Camargue
area, South of France (2001). By A. LEBLOND, S. ZIENTARA, J.
CHADOEUF, N. COMBY, M.A. HENG and P. SABATIER.
West Nile disease is considered as a re-emerging disease in France. An
ELISA IgG test was used to test the horses. Among 488 horses sampled,
5.3 % were positive. The disease is transmitted by infected mosquitoes to
dead - end hosts as humans and horses. Birds are the reservoirs.
The survey presented in this paper aimed at seeking for a low - level cir-
culation of West Nile Virus and identifying risk factors for the infection in
the horse. Among the horses included in the study, four horses which were
IgG negative in 2000 were found positive in 2001. The statistical analysis
identified the following risk factors in the environment of the horse studs:
breeding of game birds (OR = 6,9; p = 0,002) and the presence of ponds
(OR = 10,4; p = 0,008). The spatial analysis suggested the presence of two
significant clusters of positive stables in the dry zone.
Our results suggest the presence of a low - level circulation of West Nile
Virus during 2001. The risk factors identified should be evaluated in further
studies and, if confirmed, could be included in global surveillance protocols
for the early warning of risk of epidemic.
Keywords: West Nile Virus - Horse - ELISA assay - Risk
factor - Environment - Cluster.
Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84
RÉSUMÉ
L’encéphalite à virus West-Nile est une maladie ré - émergente qui sévit
en Camargue sous forme d’épizooties touchant les chevaux. Le virus est
transmis par les moustiques et les hôtes réservoirs sont les oiseaux.
L’objectif de l’enquête présentée ici était de rechercher l’existence d’une
circulation à bas bruit du virus et d’identifier des facteurs de risque d’infec-
tion chez le cheval. Le test de laboratoire utilisé a été un test ELISA en IgG.
La prévalence apparente de l’échantillon était de 5,3 % (n = 488). Quatre
chevaux négatifs en 2000 s’avèrent positifs en IgG en 2001. Les facteurs de
risque identifiés dans l’environnement des écuries positives sont : la pré-
sence de gibier d’élevage (OR = 6,9 ; p = 0,002) et la présence de mares
(OR = 10,4 ; p = 0,008). L’analyse spatiale montre que les écuries positives
sont significativement agrégées et suggère l’existence de deux foyers en
zone sèche.
Nos résultats sont en faveur d’une circulation à bas bruit du virus West
Nile dans la zone d’étude. L’identification de facteurs de risque de l’infec-
tion chez le cheval devrait être confirmée par des études ultérieures. À
terme, ces indicateurs pourraient être utilisés pour une surveillance et une
alerte précoce du risque épidémique.
Mots-clés : Virus West Nile - Cheval - ELISA - Facteur de
risque - Environnement - Cluster.

Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84
La Camargue présente toutes les conditions écologiques
pour que le virus West Nile s’y exprime : zones humides,
fortes densités de moustiques, de chevaux et surtout d’oi-
seaux sédentaires ou migrateurs [8, 9]. Le cheval est omni-
présent dans cette région, il vit à la fois dans les zones
urbaines et sauvages, par conséquent il peut être considéré
comme une bonne sentinelle pour l’étude de la circulation de
certains agents pathogènes.
Le premier objectif de notre étude était de rechercher,
après un épisode épidémique, l’existence d’une circulation
virale à bas bruit dans la population équine de Camargue. Le
second objectif était d’identifier des facteurs de risque de
séropositivité vis-à-vis du virus de West Nile, liés à l’envi-
ronnement et au mode de vie du cheval.
Matériel et Méthodes
TYPE D’ÉTUDE
L’étude a été réalisée entre décembre 2001 et mars 2002.
La méthode d’enquête choisie a été une étude transversale de
séroprévalence à visée étiologique. La zone d’étude a été
délimitée par un périmètre défini par les villes : Mauguio à
l’ouest, Tarascon et Beaucaire au nord , Saint Martin de Crau
et Port-Saint-Louis à l’est et la mer au sud. Le protocole uti-
lisé a été réalisé selon un schéma proche de l’enquête réali-
sée par l’USDA (United States Department of Agriculture)
aux Etats Unis [25].
La population cible était l’ensemble des chevaux résidant
dans le Gard, l’Hérault et les Bouches du Rhône. En réalité,
du fait de l’existence de chevaux semi-sauvages, il s’agissait
de l’ensemble des chevaux vus par les vétérinaires de la zone
d’étude.
La population source a été définie par l’ensemble des che-
vaux nés, élevés et vivant toute l’année dans la zone définie
précédemment, ou bien résidant en permanence dans la zone
depuis au moins deux ans ; les chevaux sélectionnés devaient
passer une partie de l’année en zone humide (un minimum de
3 à 6 mois comprenant la période estivale) et rester dans la
zone pendant la période à risque (mars à novembre). Une
zone humide a été définie comme une zone située à moins de
500 mètres des marais, marécages ou étangs.
PRINCIPE DU TEST SÉROLOGIQUE ELISA IGG WEST
NILE
L’analyse sérologique a été réalisée au laboratoire de viro-
logie de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments), considéré comme laboratoire de référence
pour le diagnostic de l’infection chez le cheval en France.
Selon le laboratoire, la sensibilité du test est 99% et sa spéci-
ficité 98%.
Une méthode ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent
Assay) a été utilisée pour la recherche d’IgG. Le principe de
la méthode consiste à révéler la liaison antigène-anticorps en
y attachant un marqueur, enzyme capable d’induire une réac-
tion colorée. L’antigène souche du virus Sénégal 93 est uti-
lisé. Les antigènes West Nile préparés sur cellules Vero ser-
vent à sensibiliser une plaque « ELISA » à 96 cupules pen-
dant une nuit à +4°C. Les sérums à analyser sont ensuite mis
en contact avec les antigènes, puis révélés par un conjugué
constitué par la protéine G (P.G) couplée à la Peroxydase. La
protéine G a pour fonction de reconnaître la fonction du frag-
ment constant (FC) des immunoglobulines.
Une seule dilution de l’échantillon n’est utilisée, car la
densité optique, mesurée dans les cupules au moyen d’un
spectrophotomètre, est proportionnelle à la quantité d’anti-
corps présente dans le sérum. La réaction est considérée
positive dès lors que la densité optique (D.O.) du sérum est
au moins équivalente à celle du témoin positif de référence,
ou si cette D.O. est égale ou plus grande de dix fois à la D.O.
du témoin négatif de référence.
Lorsque la D.O. a été comprise entre 5 à10 fois la D.O. du
témoin négatif, le résultat a été considéré douteux. Ces
sérums ont été testés à nouveau en ELISA pour être classés
positifs ou négatifs.
DÉFINITION DES CAS
Dans cette étude, un cheval « positif » a été défini comme
tout cheval dont le résultat de la sérologie ELISA IgG WN
était positif et une « écurie positive » toute écurie pour
laquelle au moins un des chevaux prélevés présentait une
sérologie positive.
SÉLECTION DES ÉCURIES
Le recrutement des vétérinaires participant à l’étude, basé
sur le volontariat s’est réalisé par contact téléphonique : 17
vétérinaires ont finalement participé à l’enquête.
Il a été demandé à chaque vétérinaire de réaliser une carto-
graphie des écuries susceptibles d’accepter de participer à
l’étude. Dans un second temps, l’échantillonnage a été réa-
lisé en deux étapes ; un choix aléatoire des écuries parmi les
écuries proposées par les vétérinaires a tout d’abord été
effectué, en recherchant une répartition homogène des écu-
ries sélectionnées sur la zone d’étude. Puis le nombre de che-
vaux à prélever (x) dans chaque écurie a été défini en fonc-
tion du nombre total (n) de chevaux présents dans celles-ci :
lorsque n < 5, x = n prélèvements ont été effectués, lorsque n
est compris entre 5 et 20, x = 5, lorsque n > 20, x = 15. Le
choix des chevaux prélevés au sein de chaque écurie a été
réalisé de manière à être représentatif de l’effectif des che-
vaux au sein de l’écurie en termes de répartition de l’âge et
du sexe.
Toutes ces modalités ont été définies en collaboration avec
les vétérinaires participants au cours d’une réunion d’infor-
mation et précisées de nouveau dans le guide de procédure
fourni à chacun d’eux.
« QUESTIONNAIRE CHEVAL »
La récolte des informations concernant le cheval a été réa-
lisée par le vétérinaire traitant de l’écurie, lors de la réalisa-
tion des prises de sang. Ce questionnaire regroupait des
informations concernant chaque cheval (Encadrés 1 & 2).
Une feuille de consentement éclairé a été signée par cha-
cun des responsables d’écurie participant à l’étude. De plus,
l’anonymat strict ainsi que la confidentialité des résultats ont
été assurés (autorisation CNIL n°792166).
78 LEBLOND (A.) ET COLLABORATEURS

Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84
INFECTION PAR LE VIRUS WEST NILE CHEZ LE CHEVAL EN CAMARGUE EN 2001 79
Ecole nationale Vétérinaire de Lyon
Code du cheval
Date
• Race (ou apparenté)
Camargue ❏Trotteur Français ❏Arabe ❏
Espagnol ❏Pur Sang ❏Poneys ❏
Selle Français ❏AQPS ❏Autre ❏
• Sexe
Femelle ❏Hongre ❏Entier ❏
• Age
• Couleur de la peau
Sombre ❏Claire ❏
• Couleur de la robe
Gris ❏Alezan ❏Bai ❏
Pie ❏Noir ❏Autre
Vétérinaire
Responsable
Cheval
I) IDENTIFICATION
II) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
III) CARACTERISTIQUES SANITAIRES GLOBALES
/ / 2001
Nom :
Adresse :
Tel : Fax :
Nom :
• Lutte contre les insectes Oui ❏Non ❏ , si oui :
Jour Nuit (crépuscule,
aube)
Répulsifs ❏❏
Couvertures ❏❏
Autre ❏❏
• Etat général
Bon ❏Moyen ❏Mauvais ❏
• Vaccination régulière
Oui ❏Non ❏
• Vermifugation régulière
Oui ❏Non ❏
• Maladies récentes Oui ❏Non ❏
• Principal
Jour Nuit
Stalle ou box uniquement ❏❏
Stalle ou box +/- padock ❏❏
Padock sec uniquement ❏❏
Padock sec avec abris ❏❏
Pâture uniquement ❏❏
Pâture avec abris ❏❏
Autre ❏❏
• Temps moyen passé en zone humide/an ou de mars à novembre
Moins de 25 % ❏25 à 75 % ❏Plus de 75 % ❏
IV) LOGEMENT
ENCADRÉ 1.—« Questionnaire cheval » : Caractéristiques de l’animal.

80 LEBLOND (A.) ET COLLABORATEURS
Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84
« QUESTIONNAIRE ENVIRONNEMENT »
Le questionnaire « environnement » a été rempli au cours
d’un entretien qui a eu lieu avec chacun des responsables des
écuries participant à l’étude. La localisation géographique
des écuries a été effectuée par méthode GPS (Global
Positioning System). Afin de pouvoir comparer correctement
les données obtenues, un même enquêteur a réalisé toutes les
visites. Les informations ainsi récoltées concernaient l’écu-
rie et ses alentours. Les biotopes ont été décrits dans un
rayon de 500 mètres autour de l’écurie. Les catégories défi-
nies visaient à différencier les espèces d’oiseaux susceptibles
de fréquenter ces biotopes au cours de la période à risque :
roselière / rizière / marais ; bois / buisson / garrigue ; agglo-
mérations / bâtiments ; cultures sèches / blé / olivier / verger
/ vigne ; plage / dune / sable. De même, la présence d’eau
autour de l’écurie a été qualifiée afin d’obtenir des indica-
teurs de présence des espèces de moustiques susceptibles
d’être vecteurs : eau permanente ou temporaire, stagnante ou
non, salée ou non.
ANALYSE STATISTIQUE
Afin de tenir compte de la coexistence possible de plu-
sieurs mécanismes de transmission en fonction des biotopes,
une variable « zone » a été attribuée aux chevaux et aux écu-
ries. Trois zones ont été différenciées au moyen de la gestion
anthropique ou naturelle de leurs milieux, la présence ou non
de zones humides et la mise en œuvre ou non de mesures de
lutte contre les moustiques : une zone sèche (au nord), une
zone humide démoustiquée au sud-ouest et une zone humide
non démoustiquée au sud-est.
Pour l’analyse, les données continues du « questionnaire
cheval » (âge, délais d’acquisition) ont été regroupées en
classes : pour l’âge les classes créées sont de 0 à 4 ans, de 5
à 14 ans, et plus de 15 ans. Les données nominales présentant
un trop grand nombre de classes ont été regroupées afin
d’obtenir des effectifs suffisants dans chaque classe.
Des tests de Chi2, ou dans certains cas des tests exacts de
Fisher ont été réalisés afin de déterminer si les différences
observées entre les groupes étaient significatives ou non.
Une valeur de p inférieure à 0,05 était considérée comme
significative, indicatrice d’une association potentielle.
L’analyse multi-variée a été réalisée par procédure pas à
pas (p = 0,1) à l’aide du logiciel Stata(r) (Version 7.0, Stata
Corporation, USA), pour les chevaux d’une part et les écu-
ries d’autre part. Les variables incluses dans le modèle initial
étaient d’une part les variables pour lesquelles l’analyse bi-
variée donnait p < 0,25 et d’autre part des variables considé-
rées comme des facteurs de risque dans la littérature ou des
II) ACTIVITE, de mars à novembre
• Activité principale du cheval
Loisir ❏Course ❏Travail (ferme..) ❏
Course ❏Reproduction ❏Autre
• Déplacement
But du déplacement
Randonnée ❏Feria ❏Course ❏
Compétition ❏Reproduction ❏Autre
Le cheval a-t-il été testé en 2000 Oui ❏Non ❏ , si oui quels étaient les résultats
IgG positif ❏IgG négatif ❏
IgG positif ❏IgG négatif ❏
Le cheval a-t-il montré un des signes suivants en 2000
Augmentation de l’appréhension ❏Faiblesse des membres antérieurs ❏
Dépression ❏Incapacité à se tenir debout ❏
Apathie ❏Paralysie des membres ❏
Head shaking ❏Parésie ❏
Paralysie flasque de lèvre inférieure ❏Autre
Ataxie ❏
II) WEST NILE 2000
Dans la zone étudiée Hors de la zone étudiée
Nombre de jours en déplacement
Destination principale (3 max)
ENCADRÉ 2.—« Questionnaire cheval » : Activité estivale de l’animal et « statut West Nile » en 2000.

études antérieures. Les interactions ont été testées à poste-
riori sur les variables retenues dans le modèle final.
Enfin, une analyse spatiale a été réalisée (logiciel R®, The
R Development Core Team, Version 1.5.0) pour rechercher
l’existence d’agrégats dans la structure spatiale des écuries
positives ou négatives. Le cadre probabiliste est celui des
processus ponctuels marqués [6]. Un processus ponctuel
marqué est défini par les positions des événements et les
attributs ou marques associées à chaque position. Ce cas cor-
respond notamment à celui des maladies infectieuses : un
premier processus détermine la position des individus (écu-
ries), un deuxième l’infection (statut des écuries : positive ou
négative). Dans notre cas, les positions des sites prélevés
constituent le processus spatial proprement dit, le statut séro-
logique constitue le processus des marques. Pour un proces-
sus bi-varié (2 types de marque 1 et 2), l’indépendance du
processus des marques et du processus spatial, se traduit par
l’hypothèse que les n1 évènements de type 1 sont un échan-
tillon aléatoire des n1+n2 évènements de type 1 et 2. Cette
hypothèse porte le nom de permutation des marques (ou «
random labelling ») : une fois les positions fixées, les
marques sont attribuées au hasard. Par conséquent, les hypo-
thèses testées concerneront davantage les marques que le
processus de points.
Classiquement, un processus ponctuel peut se décrire sous
3 motifs : aléatoire, agrégé ou régulier. Le motif aléatoire
correspond au cas où il n’y a pas de relation entre les événe-
ments (indépendance spatiale). L’hypothèse nulle testée ici
est la suivante : il n’existe pas de zone avec plus de sites
positifs que ce que l’on attendrait s’ils étaient répartis au
hasard ; les « risques » sont répartis au hasard.
La fonction Khat bi-variée du logiciel R a été employée
ici. Cette fonction est une estimation de la fonction de Ripley
K(r) corrigeant les effets de bord. Le critère est le nombre de
voisins à moins d’une distance donnée d’un point, pour un
processus d’une marque « positive » ou « négative ». La cor-
rection des effets de bord permet de construire un estimateur
non biaisé de K(r). Elle s’appuie sur une correction locale
portant sur la contribution de chaque point situé près de la
frontière.
Lorsque la répartition spatiale des écuries est statistique-
ment différente de la répartition attendue pour des marques
réparties selon le hasard, une cartographie de prévalence
peut être construite [5].
Résultats
ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA SÉROPRÉVALENCE
Au cours de cette étude 17 vétérinaires ont réalisé 488 pré-
lèvements sanguins répartis dans 102 écuries. Sur les 488
chevaux testés, 26 (5,3 %) ont présenté une sérologie IgG
positive, 3 (0,6 %) une sérologie IgG douteuse, 437 (89,6 %)
une sérologie négative, 22 (4,5 %) résultats étaient man-
quants. Aucune sérologie IgM ne s’est révélée positive
(0/488).
La comparaison du résultat sérologique des chevaux lors
des prélèvements de 2000 [7] et de celui de notre enquête a
révélé deux types d’évolution : 3 chevaux IgG positifs en
2000 (IgG+2000) sont retrouvés négatifs en 2001(IgG-2001)
et 4 chevaux IgG-2000 sont devenus IgG+2001.
Sur les 102 écuries concernées, 24 (24 %) présentaient au
moins un cheval avec une sérologie positive parmi les che-
vaux prélevés, 3 (3 %) présentaient au moins un cheval avec
une sérologie douteuse, 72 (71 %) ne présentaient aucun che-
val positif parmi les chevaux prélevés, et 2 (2 %) résultats
étaient manquants. Trois écuries présentent au moins deux
chevaux positifs. La figure 1 montre la répartition géogra-
phique des différentes écuries participant à l’étude en fonc-
tion de leur statut sérologique.
ANALYSE MULTIVARIÉE
Les chevaux pour lesquels le résultat du test ELISA était
douteux ont été considérés comme négatifs pour ces ana-
lyses. L’analyse bi-variée n’a pas mis en évidence une rela-
tion significative entre la positivité sérologique des chevaux
et leurs caractéristiques physiques (âge, race, sexe ; p > 0,5)
ou leur activité (p > 0,3).
Pour les chevaux, les variables incluses dans le modèle ini-
tial ont été la zone, le logement de jour, le temps passé en
zone humide et l’activité. Quatre cent cinquante-sept obser-
vations ont été utilisées. Finalement, seule la variable zone a
été retenue dans la procédure pas à pas: la localisation en
zone sèche constitue un facteur de risque (p = 0,013, OR =
4,35) (tableau I).
INFECTION PAR LE VIRUS WEST NILE CHEZ LE CHEVAL EN CAMARGUE EN 2001 81
Revue Méd. Vét., 2005, 156, 2, 77-84
FIGURE 1.—Localisation des écuries incluses dans l’étude en fonction de
leur statut sérologique vis-à-vis du virus de West Nile. Une écurie est
définie positive lorsque au moins un de ses chevaux est positif au test
ELISA IgG.
TABLEAU I.—Résultats de l’analyse multivariée chez le cheval (OR : Odds
ratio ajusté ; IC 95% : intervalle de confiance à 95%, NC : non calculé).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%