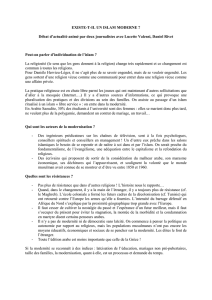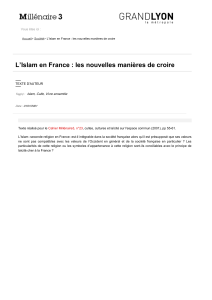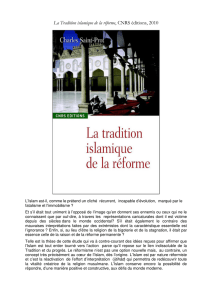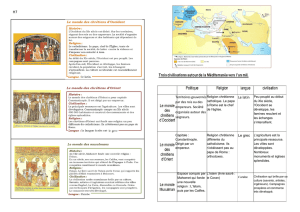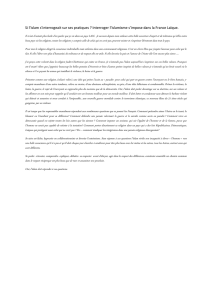La guerre de l`article premier n`aura pas lieu Sami Bostanji A la

Observatoire de la Transition Démocratique
1
La guerre de l’article premier n’aura pas lieu
Sami Bostanji
Professeur à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis
A la faveur d’une liberté d’expression, longtemps étouffée, on a assisté au
lendemain du 14 janvier à l’émergence au-devant de la scène politique d’un
débat fondamental ayant trait aux rapports entre Politique, Droit et Islam
au sein de l’Etat. Cela remettait à l’honneur une question centrale,
constamment biaisée par les régimes autoritaires qui ont hérité de la phase
postcoloniale.
Sur ce terrain miné par les clivages qui séparent les acteurs politiques, un
certain consensus semble s’offrir autour du concept d’Etat civil. Ignoré, il y
a quelques mois, le terme Etat civil fait une pénétration fulgurante dans le
lexique politico-juridique tunisien. Tant et si bien, que les principales
parties prenantes au jeu politique en arrivent à oublier leurs dissensions,
s’attelant chacune de son côté à lancer un appel non équivoque à couler les
institutions de la deuxième république dans le moule de l’Etat civil. Par une
sorte d’effet d’attraction, un curieux phénomène de convergence s’établit
sur la scène politique tunisienne pour entériner ce nouveau concept.
Pour s’en rendre compte, il suffit d’égrener les positions des principaux
pôles politiques en concours : le pôle moderniste progressiste et le pôle
islamiste. Dans ce contexte, il est à rappeler qu’après un lâcher d’essai
orienté vers la revendication d’un Etat laïc, les modernistes ont vite fait de
changer leur fusil d’épaule. Désormais, ils crient haut et fort que le salut de
la Nation passe par la consécration du caractère civil de l’Etat, laquelle
consécration est parfaitement conciliable avec le maintien de l’ancienne
formulation de l’article premier de la Constitution qui prévoit que l’Islam
est la religion de l’Etat tunisien. Quant aux islamistes, leur noyau dur
revendique l’Etat civil en précisant toutefois que cet Etat ne peut se
dissocier du référentiel islamique qui est appelé à accompagner, de
manière incontournable, toute édification d’un nouveau cadre
constitutionnel (Voir en ces sens, l’Interview de l’un des hommes forts du
Parti Ennahdha, Ali Laaridh, Journal Le Maghreb, 2 septembre 2011 ; voir
également, Le programme du Parti Ennahdha, Journal El Fejr, 16 septembre
2011).
Est-ce à dire que l’on se trouve en présence d’un concept qui présente des
potentialités fédératrices au point de contenir des mouvances qui
semblaient prima facie antinomiques ou bien faut-il tout simplement voir

Observatoire de la Transition Démocratique
2
dans ce phénomène de convergence une simple manœuvre politicienne
destinée « à botter en touche » les questions qui dérangent en attendant la
joute finale qui aura lieu sur le terrain de l’élaboration de la nouvelle
Constitution tunisienne ?
Ces questionnements nous amènent à une introspection théorique de la
clef de voûte de ce débat : le concept d’Etat civil.
Dans son acception générale, l’Etat civil s’oppose à l’Etat théocratique. Au
rebours de celui-ci, il repose sur l’idée que l’Etat ne peut être défini par une
référence quelconque à la religion, fut-elle celle de la majorité de ses
ressortissants. Ceux-ci participent à l’exercice de la souveraineté par
l’élection de leurs représentants, lesquels représentants sont appelés à
forger des normes organisant la vie en société en contemplation des
principes d’égalité et de liberté, sans l’interférence d’une quelconque
transcendance divine.
L’appel à ce concept nécessite une reconfiguration des notions clés du cadre
étatique: société, pouvoir et droit.
La société est identifiée au regard de son appartenance à une nation
spécifique constitutive d’un Etat. La notion d’Umma, autrefois fédératrice
de la collectivité, est reléguée au champ du symbolique ou tout au plus,
celui du cœur. L’allégeance est donc concrétisée par un lien politico-
juridique : la nationalité, lequel lien est rétif à toute interférence du
religieux.
Quant au pouvoir, il trouve son fondement exclusif dans la souveraineté
populaire. Point n’est besoin ici de chercher une quelconque validation de
ce pouvoir au regard du sacré (Compagnons privilégiés du Prophète ou
encore un prétendu lien de sang avec un membre de la famille du
Prophète). Le gouvernant exerce le pouvoir par la volonté du peuple qui,
par le biais de ses représentants, fixe les modalités d’exercice du pouvoir et
les conditions au regard desquelles celui-ci prend fin.
Enfin, le droit est désacralisé en ce sens qu’il est dissocié du voile sacré qui
l’a toujours couvert en terre d’Islam. Sur le plan formel, le droit n’est plus
une production des jurisconsultes, il est désormais l’apanage exclusif de
l’Etat qui s’approprie le monopole de la production des normes juridiques
suivant des techniques bien établies. Sur le plan substantiel, le droit
apparaît comme une médiation entre des intérêts antagonistes. A cet effet,
il se présente comme le reflet des besoins et des exigences de la société qu’il
prend en charge. Mieux encore, le droit se projette parfois comme un
vecteur du changement social emportant dans son sillage une véritable
mutation des relations qu’il est appelé à gouverner. Ce droit s’élabore sur
terre sans prétention d’ancrage au ciel.
Au regard de cette présentation, on comprend mal comment le concept
d’Etat civil peut se concilier avec la référence à l’Islam en tant que religion

Observatoire de la Transition Démocratique
3
de l’Etat tunisien. Plaider pour l’Etat civil tout en cherchant à maintenir le
lien ombilical avec le modèle originel place les chantres d’un tel discours
dans l’impasse: quelle que soit la portée à conférer au référent religieux, le
résultat de cet « attelage baroque » pèche par son incohérence. A défaut de
pouvoir être justifiée, cette position trouve son explication dans la pression
des faits politiques qui balayent toutes les certitudes théoriques et viennent
rappeler que la Politique reste avant tout «l’art du possible».
I- Les incohérences du concept
Si l’on affirme, comme le pense en sourdine la frange moderniste que la
référence à l’Islam doit être cantonnée dans le champ du symbolique on est
alors acculé à s’interroger sur l’utilité d’une telle référence. Sachant que la
solution véhiculée par l’article premier a été élaborée dans un contexte post
colonial, on peut émettre de sérieux doutes sur l’opportunité de la
pérenniser au-delà de son contexte originel. Il est à rappeler à cet égard que
la formulation, à l’aube de l’indépendance, de l’article premier de la
Constitution tunisienne véhicule un effet d’annonce à double détente :
l’annonce à la fois d’une rupture et d’une continuité par rapport à l’ancien
système.
Ce texte évoque la rupture par rapport au passé sur le plan de
l’organisation politique. Cette rupture se traduit par le passage d’une
monarchie sous protectorat français à un Etat-Nation indépendant organisé
suivant un mode républicain. La rupture vient ici exalter la souveraineté
fraîchement acquise du nouvel Etat.
Quant à la référence aux éléments de continuité, elle permet de rassurer la
population tunisienne : le nouveau fait politique n’emporte pas une
subversion sur le passé puisque la société tunisienne reste soudée par les
segments traditionnels, en l’occurrence la langue et la religion. De ce point
de vue, la religion musulmane apparaît comme l’un des éléments
fédérateurs de la Nation.
Les prescriptions de l’article premier de la Constitution de 1959 se
retrouvent dans la quasi-totalité des Constitutions arabes. Cette disposition
s’inscrit dans la voie de l’instrumentalisation des symboles religieux par les
acteurs politiques. Lorsque la matrice structurante d’une collectivité est
animée par le sacré, le référent religieux reste une source intarissable de
consolidation du pouvoir. Il est ici question de capter l’audience et la force
structurante de ce référent auprès de la population tunisienne, de
l’endosser et de l’afficher afin de profiter des bienfaits de légitimation qu’il
emporte. L’utilisation de ce référent apparaît donc comme une nécessité
pour des régimes en quête de stabilité. Il révèle également que
contrairement aux Etats laïques, il y a dans ces systèmes une interférence

Observatoire de la Transition Démocratique
4
entre le Politique et la Religion. D’un côté, l’Etat gère l’Islam dans l’espace
public (organisation de l’enseignement et du culte), d’un autre côté, l’Islam
influence certains aspects du système politique (l’exigence par exemple que
le chef de l’Etat soit d’obédience musulmane).
Toutefois au-delà de ces aspects, force est de constater que pour le cas
tunisien, la place du religieux dans l’édification des institutions juridiques et
politiques fut très tôt neutralisée. Cette assertion trouve consolidation, tout
d’abord, sur le terrain de l’organisation du pouvoir qui s’est faite selon les
paradigmes du constitutionnalisme occidental tournés vers l’idée centrale
de limitation du pouvoir. Cette conception se traduit notamment par
l’exaltation de l’idée de souveraineté populaire, l’affirmation du principe de
séparation des pouvoirs et la proclamation des libertés publiques. Par
ailleurs, le législateur tunisien ne s’est jamais obligé à aligner la loi sur les
principes de la Sharia; de même, le Conseil constitutionnel n’a jamais
contrôlé, de manière frontale, l’islamité des lois.
Certes, certains juges ont vu dans l’article premier, un visa ouvrant la voie à
l’interprétation de certains textes, notamment ceux du Code du statut
personnel, par référence au droit musulman classique. Néanmoins, une telle
lecture ne demeure pas moins contestable dans la mesure où elle se trouve
en porte-à- faux avec le caractère national de ce Code ainsi que les
principes d’égalité et de liberté de conscience qui coiffent l’ordre juridique
tunisien.
Si l’on se place dans la perspective qu’il faut maintenir cet article dans la
dimension symbolique qui lui a été attribuée successivement par les
régimes de Bourguiba et Ben Ali et qu’il faut, en parallèle, maintenir la
perspective de laïcisation du droit, on ne peut s’empêcher de s’interroger
sur l’utilité d’une telle entreprise.
Y a-t-il, aujourd’hui, un besoin impérieux 56 ans après l’accès du pays à
l’indépendance, de faire pareille déclaration identitaire ? Avons-nous
encore besoin de nous rassurer ? Pourquoi s’obstiner à se représenter au
regard d’une seule strate identitaire au mépris des autres éléments
constitutifs de notre identité ? N’est-ce pas oublier que l’identité n’est pas
un état mais plutôt un processus. « Elle n’est pas une essence, mais une
donnée historique qui se construit, se déconstruit et se reconstruit au gré des
conjonctures économiques et sociales, locales ou régionales » (Sélim Abou,
De l’identité et du sens, La mondialisation de l’angoisse identitaire et sa
signification plurielle Perrin/PUSJ 2009). Notre identité arabo-musulmane,
à la supposer exclusive est-elle vraiment menacée dans son existence si on
venait à omettre ce genre de mention?
Autant d’interrogations qui fissurent le mur de certitudes des adeptes de
cette position. L’Etat civil invoqué est certainement viable sans cet effet
d’annonce qui interpelle un référent religieux. Partant du principe que les

Observatoire de la Transition Démocratique
5
dispositions inutiles affaiblissent les dispositions nécessaires, le maintien
de cette solution devient nuisible car elle nourrit une représentation du
droit et de la politique qui tourne le dos à la réalité. Cette attitude
schizophrénique joue sur l’ambiguïté de l’association Etat civil – Islam et
entretient le flou de ce binôme. Elle appelle à la méfiance car, comme le
souligne Edgar Morin « La conscience n’est jamais assurée de surmonter
l’ambiguïté et l’incertitude » ( E.Morin, Le paradigme perdu ) . Pis encore en
regardant devant soi, l’Histoire nous apprend que l’ambiguïté est souvent
le masque derrière lequel s’embusque la perversion.
Mais le danger est plus grand dès lors qu’on réfléchit à dissocier l’article
premier de son caractère symbolique pour le canaliser vers un terrain plus
concret où il autoriserait une plus grande pénétration de la religion dans les
domaines politique et juridique. Ce projet qui tient à cœur à certains
dirigeants islamistes et à une bonne partie de la base acquise à leur cause
viendrait alors déconstruire un à un les éléments de l’Etat civil par une
confusion entre le temporel et le spirituel ; de même qu’il emporterait
l’affaiblissement du principe d’égalité qui se trouverait battu en brèche par
les nombreuses discriminations véhiculées par le droit musulman classique
(discrimination en raison de la religion, du sexe , de l’origine de la naissance
…). Enfin, assisterait-on à travers une telle approche à la réactivation in fine
d’une identité religieuse aux lieu et place de l’identité nationale. Sous cet
angle, Droit et Politique obéiraient à une conception identitaire au sein de
laquelle l’Islam transcende les règles appelées à régir les rapports
gouvernants-gouvernés et à réguler, de manière générale, l’organisation de
la vie sociale. L’incompatibilité de cette démarche avec le concept d’Etat
civil est saillante. C’est toute l’organisation rationnelle que présuppose ce
concept qui se trouve ici ruinée. S’il est vrai que l’Etat civil est une
illustration édifiante de la modernité, il est aussi vrai que celle-ci
s’accommode mal de toute transcendance. Comme le souligne Juergen
Habermas, la modernité est nécessairement un phénomène endogène ; elle
ne peut trouver sa référence dans autre chose qu’elle-même.
Loin d’assumer les véritables implications de l’Etat civil, les acteurs
politiques de la scène tunisienne semblent nourrir ce concept d’une vision
qui le délite de sa conception originelle. C’est là qu’entrent en jeu la
pression des faits politiques. On sort alors du domaine théorique des
concepts pour aller sur le terrain de la stratégie politicienne.
II- La pression des faits politiques
Par l’intermédiaire du concept d’Etat civil, les acteurs politiques simulent
l’accalmie en essayant de maintenir les divergences en suspens ; chaque
partie cherchant à bénéficier d’un « temps mort » qu’elle espère prolonger à
 6
6
 7
7
1
/
7
100%