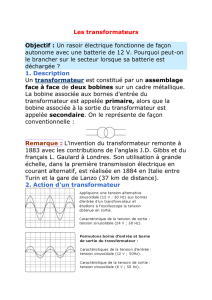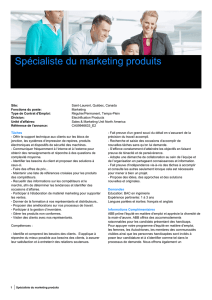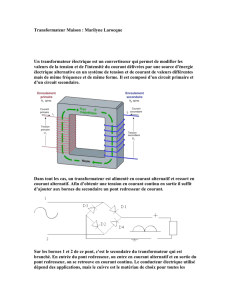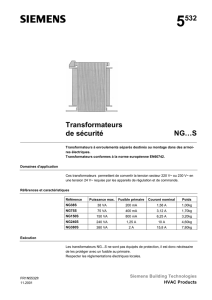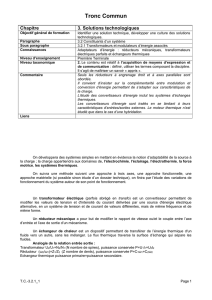ABB teste actuellement un nouveau transformateur de traction

11PETiT . . . mais puissant 11
PETiT . . .
mais puissant
ABB teste actuellement un nouveau transformateur de traction
MAX CLAESSENS, DRAŽEN DUJIC, FRANCISCO CANALES,
JUERGEN K. STEINKE, PHILIPPE STEFANUTTI, CHRISTIAN
VETTERLI – L’innovation technologique est souvent affaire
de taille. En témoignent de nombreux domaines où la masse
et le volume ont un impact direct sur la productivité et où
d’importants efforts de recherche sont consentis pour
gagner en compacité et en légèreté. Or, jusqu’à présent,
certains équipements faisaient de la résistance, notamment
les transformateurs de puissance dont la taille minimale
obéit avant tout aux lois de la physique : le circuit magné-
tique doit en effet être dimensionné pour supporter le
champ magnétique. Le marché ferroviaire impose des
exigences particulières au transformateur de traction :
il faut, d’une part, libérer de la place au profit des voyageurs
et, d’autre part, limiter la charge admissible par essieu tout
comme l’énergie nécessaire à l’accélération du train. Par
chance, la physique offre ici une piste pour alléger et réduire
de volume les transformateurs de traction. En effet, plus la
fréquence augmente, plus la taille du circuit magnétique
diminue ; ce principe vaut aussi pour les appareils de faible
puissance comme les chargeurs d’ordinateurs portables.
Pour autant, l’appliquer à un matériel aussi volumineux et
lourd que le transformateur de traction n’est pas qu’une
question d’échelle ! ABB a relevé le défi et développé un
prototype à électronique de puissance testé sur une
locomotive.

12 revue ABB 1|12
La multiplicité des systèmes d’électrifica-
tion du réseau ferré européen, héritage
de l’histoire, est souvent le reflet de ce
qui se faisait de mieux au début de l’élec-
trification d’un pays ou d’une région
➔1.
À bord des trains traditionnels tirés par
une locomotive, un transformateur lourd
n’est pas forcément pénalisant car il
contribue à l’adhérence des roues sur
les rails. L’effort de traction maximal
que la locomotive peut produire sans
perte d’adhérence est limité par sa
masse. Or, pour
les lignes de voya-
geurs, la tendance
est aujourd’hui aux
automotrices où la
chaîne de traction
n’est plus regrou-
pée dans la loco-
motive, mais répar-
tie sur toute la lon-
gueur du train,
dans les rames de
passagers. Face au
nombre croissant
d’essieux motori-
sés, l’adhérence n’est plus un facteur qui
limite l’accélération du train ; par contre,
la masse et la taille du transformateur
demeurent une contrainte majeure pour
les concepteurs de trains.
Le train idéal combinerait la légèreté et la
compacité des équipements des engins
ferroviaires alimentés en continu aux
faibles pertes de transport du train ali-
menté en haute tension alternative. En
d’autres termes, le transformateur se
voit imposer une cure d’amincissement !
L
es premières lignes ferroviaires
électrifiées étaient principale-
ment réalisées en tension conti-
nue. À l’époque, cette tension
ne pouvant être abaissée par du matériel
embarqué, les trains étaient alimentés
par les sous-stations en basse tension
(750 V à 3000 V) directement fournie aux
moteurs de traction. Or, à ce niveau de
tension, les pertes dans le conducteur
aérien sont élevées.
Ultérieurement, l’électrification alterna-
tive monophasée à des tensions supé-
rieures (15 kV/16,7 Hz et 25 kV/50 Hz)
fut introduite, réduisant les pertes de
transport mais imposant l’installation, à
bord des trains, de transformateurs
lourds et volumineux.
Or, nous l’avons dit, sa taille et son poids
obéissent aux lois de la physique : plus la
fréquence est basse, plus le transforma-
teur est volumineux. En augmentant la
fréquence, on gagnerait à la fois du
poids et de l’espace. Tel fut le raisonne-
ment suivi par l’équipe de projet ABB du
transformateur de traction à électronique
de puissance PETT (Power-Electronic
Traction Transformer).
Le PETT à la loupe
La chaîne de conversion de puissance
de la plupart des trains modernes ali-
mentés en alternatif est illustrée en
➔2.
Le courant alternatif capté de la caté-
naire (conducteur aérien) circule dans les
enroulements primaires d’un transforma-
teur basse fréquence pour atteindre les
rails, le retour du courant s’effectuant
par ces derniers. La tension réduite dis-
ponible au niveau des enroulements
secondaires du transformateur alimente
un hacheur réseau quatre quadrants
(4Q) qui la convertit en tension de bus
continu. Enfin, un onduleur convertit
cette dernière en courant alternatif de
fréquence et de tension variables pour
les moteurs de traction. Les auxiliaires
peuvent également être alimentés par le
bus continu.
Pour utiliser un transformateur moyenne
fréquence, un convertisseur doit être
placé en amont du transformateur
➔3.
Les gros transformateurs étant
en majorité destinés à des
applications stationnaires, la
traction ferroviaire est proba-
blement la première application
à tirer profit de la réduction de
masse des trans forma teurs.
Photo p. 11
Locomotive de manœuvre Ee 933 des Chemins
de fers fédéraux suisses (CFF), qui embarque le
démonstrateur PETT d’ABB.
Non électrifiés
750 V CC
1 kV CC
3 kV CC
15 kV/16,7 Hz CA
25 kV/50 Hz CA
1 Électrification des réseaux ferroviaires européens

13PETiT . . . mais puissant
série une cascade de modules convertis-
seurs côté haute tension dont les sorties
sont connectées en parallèle côté conti-
nu ➔4. Cette topologie donne une solu-
tion évolutive et permet une redondance
M parmi N.
La tension alternative fournie par la caté-
naire est filtrée par une inductance avant
d’alimenter le premier module convertis-
seur. Chaque module se compose d’un
bloc redresseur actif AFE (Active Front
End) et d’un bloc convertisseur continu-
continu ➔5. Le bloc AFE est essentielle-
ment un pont en H qui régule la charge
des condensateurs du bus continu et
autorise également la régulation active
du facteur de puissance.
Convertisseurs en cascade
Cette topologie en cascade permet de
plus la commutation indépendante de
chaque module et, donc, des commandes
imbriquées des ponts en H.
Si elles sont uniformément imbriquées
(décalées de 360 °/N, N désignant le
nombre de niveaux), le côté réseau du
convertisseur perçoit une fréquence de
commutation apparente (équivalente)
2N fois supérieures aux fréquences de
commutation réelles de chacun des ponts
en H. Cette fréquence de commutation
apparente élevée (combinée au plus
grand nombre de niveaux intermédiaires
de tension) donne une distorsion harmo-
nique inférieure à celle des convertis-
seurs de traction traditionnels, réduisant
les besoins de filtrage en entrée. Des
exemples de formes d’onde sont repro-
duits en ➔6.
Côté secondaire de ce dernier, un redres-
seur alimente le bus continu.
Cette topologie pose un défi majeur :
l’installation obligatoire d’un convertis-
seur côté haute tension. La génération
actuelle de composants semi-conduc-
teurs ne pouvant bloquer les tensions
utilisées en électrification ferroviaire alter-
native, un montage en série s’impose.
Plutôt que de raccorder en série un très
grand nombre de semi-conducteurs
pour former des valves, ABB a monté en
La multiplicité des
systèmes d’électri-
fication du réseau
ferré européen,
héritage de l’his-
toire, est souvent
le reflet de ce qui
se faisait de mieux
au début de l’élec-
trification d’un
pays ou d’une
région.
Caténaire 15 kV/16,7 Hz - 25 kV/50 Hz CA
Rail (masse)
Transformateur
principal basse
fréquence
1
Convertisseur
principal
Bus continu
Moteur
de traction
M
2 Chaîne de conversion d’un train moderne alimenté en CA
3
3
3 Chaîne de conversion à transformateur moyenne fréquence
Caténaire 15 kV/16,7 Hz - 25 kV/50 Hz CA
Rail (masse)
Transformateur
moyenne
fréquence
1
Bus continu HT Bus continu BT
Moteur
de traction
M
3
3

14 revue ABB 1|12
Transformateurs moyenne fréquence
Ces transformateurs jouent un triple
rôle. Primo, ils assurent l’isolement gal-
vanique entre la haute tension alter-
native du réseau et la basse tension de
la charge. Secundo, ils adaptent la
tension continue de 1,5 kV de la charge
au niveau intermédiaire de la tension
de 3,6 kV du bus continu. Tertio, ils
aident les modules de transistors IGBT
des circuits résonants LLC (cf. infra)
à fonctionner en régime de commuta-
tion douce. La réduction de taille accen-
tuant le problème de la rigidité élec-
trique, cet aspect demande une étude
approfondie.
Les neufs transformateurs du démons-
trateur PETT sont logés dans la même
cuve à huile, tout comme l’inductance
réseau et le chargeur de démarrage
➔7.
Le transformateur
de traction utilise
la plate-forme
de commande
AC 800PEC d’ABB
pour applications
lentes et rapides.
4 Montage en série d’une cascade de modules convertisseurs côté primaire et sorties
raccordées en parallèle côté secondaire
Rail
Caténaire
Module 2
Module 1
Module N
5 Chaque module se compose d’un bloc redresseur actif (AFE) et d’un bloc convertisseur CC/CC.
CA/CC
IGBT 6,5 kV/400 A
S1 S5 S7
Cr Lm
TR
Lr
SC
S2 S6 S8
S3
S4
C2 C4
C1 C3
CC/CC
IGBT 3,3 kV/800 A

15PETiT . . . mais puissant
Régime de commutation du circuit
LLC
Chacun des neufs transformateurs
moyenne fréquence fait partie du conver-
tisseur CC/CC associé
➔4. En utilisant
les inductances parasites et de magnéti-
sation des transformateurs ainsi que les
condensateurs du circuit externe, on
crée un circuit LLC résonant (Lr, Lm
et Cr en ➔5) aux avantages suivants :
– Large plage de régulation de sortie ;
– Réduction des pertes de commuta-
tion côté primaire par la commutation
à tension nulle sur la plage complète
de la charge ;
– Faible courant de blocage commandé
par conception (commutation à
courant quasi nul) ;
– Faible contrainte de tension et
commutation à courant nul sur le
redresseur à diodes côté secondaire ;
– Fonctionnement indépendant de la
charge à la fréquence de résonance.
Un circuit LLC étant basé sur l’effet de
résonance, les variations de la fréquence
de commutation peuvent servir à réguler
la tension de sortie. La version actuelle du
PETT n’utilise toutefois pas cette possi-
bilité ; le convertisseur CC/CC résonant
du circuit LLC fonctionne en boucle
ouverte avec une fréquence de commu-
tation fixe de 1,75 kHz, inférieure à la
fréquence de résonance.
Plate-forme de commande
AC 800PEC
La plate-forme de commande devait
remplir les conditions suivantes :
– Maintien d’un courant d’entrée
sinusoïdal ;
– Facteur de puissance quasi unitaire ;
La compacité du
PETT permet de
le monter sous
la caisse ou en
toiture, libérant un
maximum d’espace
pour les passagers
et réduisant la
consommation
énergétique des
trains.
6 Formes d’onde mesurées du transformateur PETT
Formes d’onde mesurées avec le démonstrateur PETT fournissant 900 kW (a, b),
500 kW (c, d) et 100 kW (e, f) au moteur de traction CC.
iTr_HV : Courant primaire transformateur
iTr_LV : Courant secondaire transformateur
uS6_ce : Tension collecteur-émetteur
de l’IGBT S6 de ➔5.
uline : Tension réseau
iline : Courant réseau
uload : Tension de charge
-1250
0
1250
(V)
-50
0
50
(A)
0,0500,15 0,20,1
c) Time (s)
1000
2000
3000
(V)
-200
0
200
(A)
0,200,6 1,00,4
b) Temps (ms)
1000
2000
3000
(V)
-100
0
100
(A)
0,200,6 1,00,4
d) Temps (ms)
1000
2000
3000
(V)
-20
0
20
(A)
0,200,6 1,00,4
f) Temps (ms)
-1250
0
1250
(V)
-15
0
15
(A)
0,0500,15 0,20,1
e) Temps (s)
-1250
0
1250
(V)
-100
0
100
(A)
0,0500,15 0,20,1
a) Temps (s)
a
c
e
b
d
f
 6
6
 7
7
1
/
7
100%