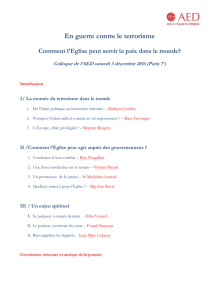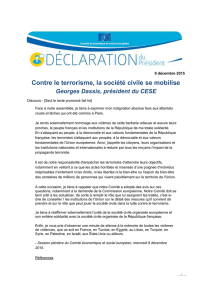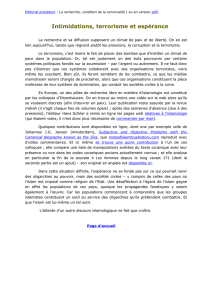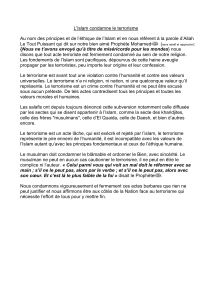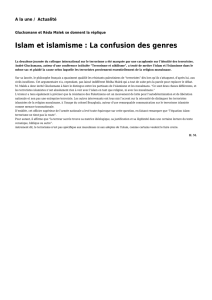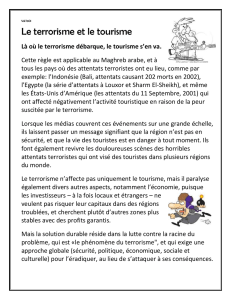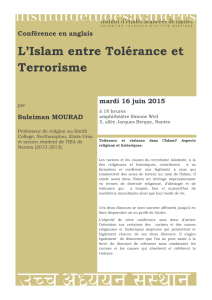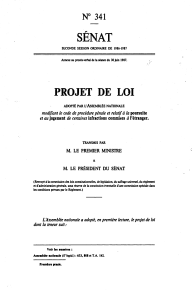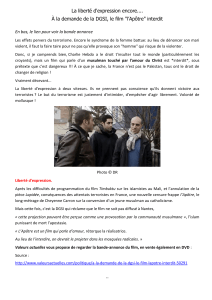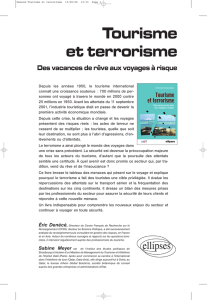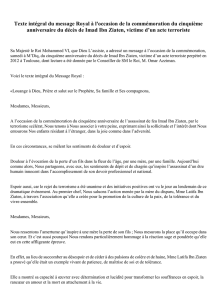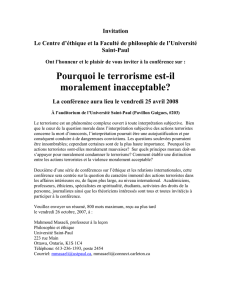« Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas » André Malraux

5
« Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas »
André Malraux
« Terrorism is theatre »
Jenkins, 19741
1 HOFFMAN, Bruce, Inside terrorism, 1998, P. 138.

6
INTRODUCTION
Le 25 juin 1996 attentat de Dharhan contre une base américaine, 7 août 1998, attentat
contre les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie ; octobre 2000, attentat suicide
contre le destroyer Cole au Yemen ; 11 septembre 2001, triple attentat suicide à New York,
Washington et en Pennsylvanie ; 23 février 2002, assassinat du journaliste américain Daniel
Pearl, 10 octobre 2002, attentat à la voiture piégée à Bali, 11 mars 2004, dix bombes
explosent dans quatre trains à Madrid, 7 Juillet 2004, quatre explosions ont lieu à Londres
dans les transport en commun. Du Maroc au Pakistan, de l’Arabie Saoudite à la Tchétchénie,
de New York au continent européen, aucun pays n’est épargné devant ce qui semble être le
nouveau « rouleau compresseur » de la terreur.
En effet, ces dix dernières années ont vu se succéder une série de bouleversements
internationaux qui ont comme dénominateur commun d’être le fait de ce qui est
communément appelé « le terrorisme islamiste ». La nouveauté de la menace ainsi que son
instantanéité ont pris de cours les observateurs habituels qualifiés de la scène politique
internationale. Dès lors, les médias, forts de leur atouts (audience large et variée, ubiquité,
rapidité de réaction et de diffusion) ont opéré une véritable prise de pouvoir explicatif. Ils se
sont ainsi saisi des évènements et ont tentés d’y apporter une explication, une raison d’être,
face à une population qui se sentait choquée et dépourvue devant cette menace inconnue et
injustifiée à ses yeux. Par conséquent la question de l’internationalisation du terrorisme
islamiste sera le fil conducteur de cette étude.
Le terrorisme n’est pas l’apanage de l’histoire contemporaine. Néanmoins,
l’extrémisme islamiste marque une rupture en tant qu’il devient un autre moyen de lutte
primordial à prendre en compte dans les paramètres internationaux. En effet, cet acte ne
répond en rien aux critères classiques de lutte. Il ne s’agit en aucun cas de guerre
conventionnelle ni de débat démocratique. En ce sens, le terrorisme islamiste constitue une
véritable « troisième voie » au sens ou Nasser en a été le représentant lors de la guerre froide
face aux deux blocs capitaliste et communiste. Il ne s’agit pas d’utiliser les moyens d’actions
conventionnels. En réalité, la lutte s’inscrit dans un système d’actes qui ne répondent pas à la
logique de l’action armée, ni aux normes politiques et internationales. De plus le terrorisme
islamiste est à ce jour le plus médiatiquement visible et le plus important en tant que
mouvement politique et religieux.
Si l’incompréhension a été, et demeure, la première des réactions face aux événements
violents qui secouent l’ensemble du monde, l’heure est à la tentative d’explication et à la
quête de justification. En ce sens, les médias jouent un rôle tout particulier et primordial au
sens ou ils tentent de fournir les clefs explicatives des actes terroristes. A l’inverse, les médias
sont aussi utilisés comme un moyen d’action nouveau. La scène médiatique s’élargissant,
l’audience étant variée et pouvant se situer n’importe où, l’image devient un important
dispositif stratégique pour les terroristes qui trouvent un écho rapide et assuré aux quatre
coins du globe. Et c’est cette alternative conflictive qui peut permettre de décrypter quelles
sont les justifications des actions des terrorismes islamistes.

7
Notre étude détient pour but d’analyser dans quelles mesures le terrorisme islamiste
constituerait une troisième voie médiatique pour la fédération d’une idéologie unique
islamiste, en totale opposition à l’idéologie dite occidentale.
Cette étude ne se veut en aucun cas exhaustive puisque les cadres temporels, les
acteurs et les corpus médiatiques sont clairement définis et délimités. Les événements du 11
septembre 2001 marquant le réel coup d’envoi du terrorisme international médiatisé, cette
étude s’appuiera sur les actions terroristes les plus marquantes médiatiquement à compter de
2001. Il sera question de la difficulté de définir véritablement le phénomène « terrorisme
islamiste ». Néanmoins, quelques groupes médiatiquement visibles, notamment Al-Qaida,
feront figure de référence et de base de notre analyse.
De plus, il s’agira de mettre en perspective différents évènements et les discours
médiatiques qui en découlent. De même, il incombera de déconstruire les présupposés
sociologiques qui forme la pensée occidentale afin de pouvoir envisager une justification des
actes terroristes. En effet, le sujet étant au cœur même de l’actualité, il a été maintes fois
développé et fait souvent preuve de regards biaisés puisque idéologiquement orientés. Enfin,
cette étude est à la fois comparative puisqu’elle analyse le comportement des médias (presse
écrite et audiovisuelle, site Internet) face aux actes terroristes et le traitement de l’information
sur le monde arabo-musulman (point de vue institutionnel, regard interne et externes aux
faits). Mais elle est également thématique puisqu’elle resitue l’action terroriste au sein de la
culture arabo-musulmane afin d’en interroger les velléités identitaires.
Ce travail est le résultat de la conjonction d’un intérêt pour le monde arabo-musulman
et d’une passion pour le travail journalistique. Il y a eut avant tout la volonté de mieux
comprendre la nouveauté des enjeux constitués par le terrorisme médiatisé et internationalisé.
Néanmoins, ce projet s’inscrit aussi dans une perspective plus large de professionnalisation
dans le domaine journalistique et tout particulièrement dans le journalisme politique et
géopolitique international. Il aurait été particulièrement intéressant de réaliser une étude
comparative des stratégies médiatiques au sein du phénomène global du terrorisme, et non pas
uniquement le terrorisme islamiste. Néanmoins, la nécessité de se focaliser sur un thème
précis et de choisir un axe d’étude m’a conduit à délimiter l’étude au terrorisme islamiste, et
ses implications médiatiques. Le terrorisme islamiste marquant en quelque sorte un tournant
dans la médiatisation de la terreur, de par ses implications internationales et identitaires.

8
SOMMAIRE
Citations………………………………………………………………………………………. 5
Introduction…………………………………………………………………………………… 6
Sommaire……………………………………………………………………………………... 8
CHAPITRE I CADRE DE COMPRÉHENSION ET CLEFS IDÉOLOGIQUES.......... 10
SECTION I LA RHÉTORIQUE SUR LE TERRORISME : APPROPRIATION ET UTILISATION
DU TERME……………………………………………………………………………………………11
SECTION II LES BARRAGES SOCIOLOGIQUES ET HISTORIQUES DE COMPRÉHENSION ET
D’ACTION…………………………………………………………………………………………… 19
SECTION III L’ACTUALITÉ COMME « CATALYSEUR » DU NÉGATIF ET DE
L’AFFRONTEMENT………………………………………………………………………………… 25
CHAPITRE II LE TERRORISME ISLAMISTE, ENTRE MYTHES ET REALITES 29
SECTION I LE TERRORISME ISLAMISTE : SPÉCIFICITÉS, MULTIPLICITÉS ET MOYENS DE
LUTTE……………………………………………………………………………………………….. 30
SECTION II JIHAD ET TERRORISME : VERS UN NOUVEAU MOYEN DE LUTTE ?............. 33
SECTION III LA PROPAGANDE JIHADISTE : UNE MENACE RÉELLE ET ORGANISÉE ?..... 42
CHAPITRE III UN NOUVEAU TRAITEMENT MEDIATIQUE DE LA MENACE?..49
SECTION I ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA MISE EN IMAGE.............................................. 50
SECTION II INTERNATIONALISATION DE LA MÉDIATISATION : CRITIQUES ET
LIMITES……………………………………………………………………………………………… 58
SECTION III BROUILLAGES DES CLEFS DE COMPRÉHENSION À LA SUITE DE LA
DÉTERRITORIALISATION………………………………………………………………………… 63
Conclusion…………………………………………………………………………………....76
Bibliographie………………………………………………………………………………… 77
Table des matières…………………………………………………………………………… 82

9
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
1
/
78
100%