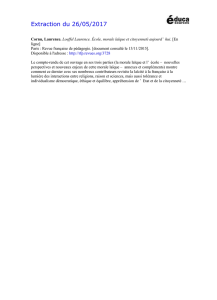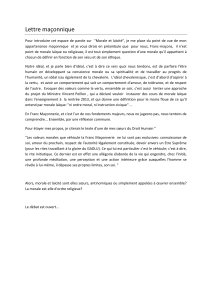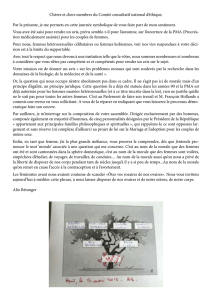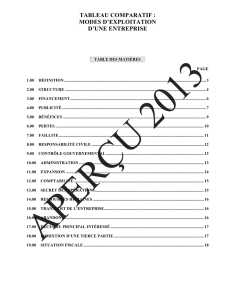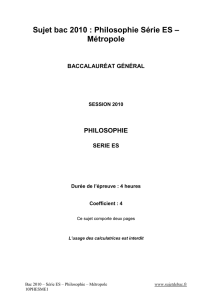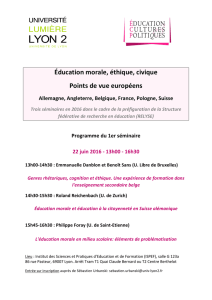« il est urgent de rebâtir du commun » La morale laïque face à l

.10 LES IDÉES EN MOUVEMENT LE MENSUEL DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT N° 204 DÉCEMBRE 2012
dOssier
DÉBAT
« Il est urgent de rebâtir
du commun »
À la n du mois d’août, Vincent Peillon a annoncé vouloir instaurer une
« morale laïque (…) du plus jeune âge au lycée ». Depuis, le ministre de
l’Éducation nationale a lancé une mission 1 pour rééchir aux contours d’un
enseignement. Il répond à nos questions.
Les Idées en mouvement : Quelle
est votre dénition de la morale
laïque ?
Vincent Peillon : C’est tout
simplement celle qu’en donnait
Jaurès. La morale laïque, c’est une
morale indépendante – non pas
opposée, mais indépendante – de
toute croyance religieuse préa-
lable. Une morale qui repose sur
la raison, l’universalisme, l’huma-
nisme et qui postule que pour
« sentir et comprendre ce que
vaut d’être homme et à quoi cela
engage », il n’y a besoin de se
mettre sous l’égide d’aucun
dogme particulier. Pour trans-
mettre cette morale, ces valeurs,
ce sens de la justice, cette ré-
flexion sur le bien et le mal – con-
trairement à ce qu’affirmait le précé-
dent président de la République –
les prêtres ne sont pas supérieurs
aux instituteurs. C’est la morale
de la République, la morale de la
liberté, une liberté « réglée par le
devoir » ; la morale de l’égalité qui
pose l’égale dignité de tous les ci-
toyens et garantit l’égal traitement
de tous les élèves ; la morale de la
fraternité, du respect mutuel, de
la solidarité qui compte parmi les
valeurs essentielles que l’école
doit transmettre.
En quoi la morale laïque a-t-elle
une actualité particulière en
2012 ?
Vous le savez bien : notre pays
traverse une crise de sens sans
précédent. Le débat insensé sur
l’identité nationale, la stigmatisa-
tion des uns et des autres comme
seule réponse à une forme de cris-
pation identitaire et religieuse, ont
profondément troublé nos conci-
toyens. On entend aujourd’hui
des choses effarantes dans la
bouche de certains qui prétendent
défendre la laïcité, alors qu’ils ne
cherchent en réalité qu’à alimen-
ter la division et le conflit. Ces
divisions, comme toujours, se
nourrissent de l’ignorance : de
l’ignorance de l’autre, mais aussi
et surtout, de l’ignorance de ce
qui nous unit, de ce qui fait de
nous un peuple, une nation. Il est
urgent de rebâtir du commun, par
le savoir, par la raison. Cela a tou-
jours été la mission historique de
l’école, en France plus que par-
tout ailleurs. Au moment où notre
pays doute, où notre pacte répu-
blicain se fissure, nous devons re-
nouer le fil de cette histoire. L’en-
seignement de la morale laïque y
contribuera.
Concernant son enseignement à
l’école, ne faut-il pas en faire un
des grands référentiels
interdisciplinaires commun à
tous les enseignements plutôt
qu’une discipline spécique ?
La question du périmètre et
des modalités de cet enseigne-
ment est au cœur du travail que
j’ai confié à la mission sur la mo-
rale laïque. Aujourd’hui, il existe
une « instruction civique et mo-
rale » en primaire. Mais cette di-
mension morale disparaît ensuite
de l’éducation civique au collège,
et de l’ECJS (éducation civique,
juridique et sociale) au lycée : ce
n’est pas cohérent. Il faut davan-
tage de lisibilité, davantage de
progression. Je souhaite égale-
ment que cet enseignement soit
évalué, tout au long de la scola-
rité. Cela ne veut pas dire, évi-
demment, qu’il y aura des profes-
seurs de morale. Au contraire, je
suis convaincu que l’ensemble de
la communauté éducative doit
s’en saisir : la mission de former
des citoyens responsables et libres
incombe à tous ses membres.
D’autant plus que ces sujets se
prêtent particulièrement bien à la
pédagogie de projet, à l’interdisci-
plinarité. Une réflexion sur l’éga-
lité fille-garçon par exemple, a
tout à gagner à un regard croisé
entre les enseignants de plusieurs
disciplines et la vie scolaire. De
même sur la laïcité, ce sont toutes
les disciplines – et pas seulement
l’histoire – qui peuvent être con-
voquées… La morale laïque, c’est
l’affaire de tous. n
1. Alain Bergounioux, historien et
secrétaire national PS en charge de
l’éducation, Rémy Schwartz, conseiller
d’État et rapporteur général de la
commission « Stasi » sur la laïcité en
2003 et Laurence Loeffel, professeur
de philosophie à l’université Lille-III,
sont les trois membres de la mission
de réflexion sur la morale laïque. Ils
rendront leurs travaux sous forme d’un
rapport fin mars 2013.
on a l’habitude de faire remonter l’ensei-
gnement de la morale laïque à Ferry,
Buisson, Paul Bert, les pères fondateurs
de l’école républicaine, mais on pourrait aussi
citer Renouvier, Fouillée, Guyau, qui, chacun
à leur manière, s’employèrent à fournir les élé-
ments de cette morale. Morale, car il s’agit de
transmettre un certain nombre de valeurs et de
façonner des comportements. Laïque, moins
dans son contenu propre, laquelle est le fonds
commun de la morale sociale traditionnelle
(« la bonne vieille morale de nos pères », dira
Ferry), mais dans sa présentation et son arti-
culation, qui ne doit rien à l’enseignement de
l’église et à la Révélation consignée dans les
textes sacrés. À tel point qu’une des premières
querelles auxquelles elle donna lieu fut celle
des devoirs envers Dieu. Certains des républi-
cains anticléricaux (il est vrai, imprégnés de
spiritualisme déiste) voulurent inscrire dans
cette morale des « devoirs envers Dieu », fon-
dés sur une analyse purement profane. C’en
était trop pour les cléricaux, qui se voyaient
ainsi concurrencés sur leur propre terrain : la
tentative fut abandonnée sous leur pression.
Mais cette escarmouche reste significative de
l’ambition qui habitait alors la morale laïque :
construire une morale en tout point identique
à la morale traditionnelle (ou dominante), qui
s’impose par les seuls outils de la raison
humaine.
UNE ÉCOLE SANS DIEU
MAIS PAS SANS MORALE
Ils n’innovaient d’ailleurs pas complète-
ment sur ce point et retrouvaient les tentatives
qui avaient été au début du siècle celles de
Cousin et de Guizot, quoique nettement
moins en rupture avec le catholicisme. Simple-
ment, ces derniers retrouvaient par les voies
de la seule philosophie une doctrine analogue
à celle de l’église. Pendant longtemps, ce fut
ainsi un mixte de positivisme comtien et de
criticisme kantien qui servit de philosophie
sous-jacente à cet enseignement moral. Et c’est
bien le même fonds philosophique que la
IIIe République vint réactiver, avec la ferme
conviction que « l’école sans Dieu » n’était pas,
au contraire, une école sans morale, et même
© Ministère de l’Education nationale
La morale laïque face
à l’individualisme
L’enseignement de la morale laïque, ou mieux, l’éducation morale
laïque, a une longue tradition. Aujourd’hui, cette morale doit
affronter un individualisme relativiste, qui ne reconnaît que peu de
règles morales communes.

LES IDÉES EN MOUVEMENT LE MENSUEL DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT N° 204 DÉCEMBRE 2012 11.
dOssier
pouvait l’emporter sur sa rivale du point de
vue de son élévation morale.
UNE SOCIÉTÉ TRAVERSÉE PAR LES
QUESTIONS MORALES
La difficulté contemporaine est tout autre :
l’éducation morale doit avant tout affronter
non une conception concurrente, quoique clé-
ricale, mais un individualisme relativiste qui
ne reconnaît que peu de règles morales com-
munes, sinon de réciprocité formelle. De là le
soupçon maintes fois formulé qu’une telle mo-
rale soit une entreprise de moralisation à des-
tination des classes « dangereuses », une façon
de les soumettre à la norme sociale. Chacun
règle sa vie comme il l’entend et l’idée de laï-
cité est progressivement et insensiblement de-
venue synonyme d’abstention envers les ques-
tions morales en général. Notre acceptation de
règles communes se limite à leur utilité prag-
matique (ne pas tous parler à la fois, sous
peine de cacophonie), et nous ne saurions aller
au-delà par crainte d’attenter à la liberté des
consciences. Pourtant, de nombreuses ques-
tions morales ne cessent de se poser et de ta-
rauder notre société, à tel point que nous mul-
tiplions les instances spécifiques ou les
déontologies particulières, dans tous les do-
maines : bioéthique bien sûr, mais aussi
conduite des affaires, ou comportement des
hommes et femmes politiques. Il n’est pas sûr
que l’abstention envers toute réflexion morale
soit le meilleur moyen de s’y préparer. Après
tout la question de la justice fiscale n’est pas
qu’une question d’efficacité économique de
telle ou telle mesure, et il peut paraître mora-
lement inacceptable de parler d’« exil fiscal ».
Et ce n’est pas là moraliser les pauvres.
●Joël Roman
Pour aller plus loin, consulter les ouvrages et les textes
issus des trois colloques sur la morale laïque organisés
par la Ligue de l’enseignement :
Quelle place pour la morale ?, éditions Desclée de
Brouwer, 1994.
École, morale laïque et citoyenneté aujourd’hui,
Laurence Loeffel (dir.), Presses universitaires du
Septentrion, 2009.
Les actes du colloque de 2011 « Pourquoi et
comment faut-il développer une culture éthique à
l’école publique ? », co-organisé avec l’association
Confrontations, sont prévus aux éditions Privat. Un
blog : http://ethique-ecole.hautetfort.com présente
quelques aspects de ce travail en cours.
La morale
laïque contre
l’« ennemi
intérieur »
Le retour de la morale laïque à l’école ne fait
pas l’unanimité. Pour le philosophe Ruwen
Ogien 1, le projet de Vincent Peillon est confus et
conservateur. Il va même plus loin en l’accusant
d’être dirigé contre des « ennemis intérieurs qui ne
partageraient pas les valeurs de la République ».
Peu après mai 1968, l’ensei-
gnement de la morale dis-
parut des écoles, avec les
blouses grises et les bonnets
d’âne. À part quelques fétichistes,
personne, depuis, n’a insisté pour
réclamer le retour de l’uniforme et
des châtiments grotesques. Mais
le projet de faire revenir la morale
à l’école est devenu une obses-
sion, à telle enseigne que François
Béguin pouvait à juste titre évo-
quer récemment « l’éternel retour
de la morale à l’école ». Le dernier
projet en date, celui de Vincent
Peillon, se distingue surtout par
son appellation. Ce n’est pas la
morale qui sera enseignée, mais la
morale « laïque ». Ce projet est
aussi confus que les précédents.
Tout d’abord, derrière l’idée
de morale laïque, telle que la
conçoit le ministre de l’Éducation,
il y a la croyance que si on laisse
les enfants réfléchir rationnelle-
ment, penser librement, en de-
hors de tout dogme religieux
ou politique, ils reconnaîtront né-
cessairement la grandeur des
« valeurs de la République » : so-
lidarité, altruisme, générosité, dé-
vouement au bien commun, etc.
Cette croyance est naïve. La raison
est malheureusement insuffisante
pour justifier les « valeurs de la
République ». Même si c’est re-
grettable, la réflexion rationnelle
peut parfaitement aboutir à rendre
attrayantes des valeurs comme
l’égoïsme, la concurrence achar-
née, la récompense au mérite, et
même l’argent. On peut rejeter ces
valeurs au nom du « vivre en-
semble », mais on ne peut pas dire
qu’elles sont irrationnelles.
CONFUSION DU JUSTE
ET DU BIEN
Ensuite, le projet du ministre
de l’Éducation confond la ques-
tion du juste et celle du bien. La
première concerne nos rapports
aux autres : dans quelle mesure
sommes-nous respectueux, équi-
tables, etc. ? La seconde est diffé-
rente. Elle est celle de savoir ce
qu’on va faire de soi-même : du
style de vie qu’on veut mener, du
genre de personne qu’on doit
être, des ingrédients de la vie
« bonne » ou « heureuse ». Faut-
il être un épargnant raisonnable
ou un flambeur ? Un lève-tôt qui
essaie d’en faire le plus possible,
ou un lève-tard qui essaie d’en
faire le moins possible ? On peut
concevoir un certain accord entre
tous les citoyens sur l’importance
du respect d’autrui, de l’équité
ou de la réciprocité dans les rela-
tions interpersonnelles, c’est-à-
dire du juste. C’est plus difficile
à envisager pour le bien person-
nel, la vie bonne, ou le sens de la
vie. Pour éviter d’imposer des
conceptions controversées du
bien personnel à l’école, seule
l’instruction civique, qui ne s’en-
gage pas de ce point de vue, de-
vrait y être envisagée. L’enseigne-
ment de la morale, au sens de
l’éducation à la vie bonne ou
heureuse, ne devrait pas y avoir
de place.
Bref, le projet est si bancal in-
tellectuellement qu’on est bien
obligé de se poser des questions
sur le but qu’il vise vraiment. Je
me permets une hypothèse.
Autrefois, les cours de morale
étaient censés préparer les enfants
de la République à devenir de
braves petits soldats, courageux et
disciplinés, bouleversés à la vue
du drapeau national, connaissant
La Marseillaise par cœur, et prêt à
verser l’« impôt du sang » pour
défendre la patrie contre ses enne-
mis extérieurs.
UNE PENSÉE CONSERVATRICE
SUR L’ÉCOLE
Aujourd’hui, l’enseignement de
la morale semble plutôt dirigé con-
tre un ennemi intérieur, une classe
dangereuse qui ne partagerait pas
les « valeurs de la République ».
Lorsque le ministre proclame
un peu partout dans la presse qu’il
est nécessaire de restaurer un en-
seignement de morale « laïque » à
l’école, ce n’est évidemment pas
parce qu’il s’inquiète de l’immora-
lité des élèves de Louis-Le-Grand
ou d’Henri-IV !
Le projet est plutôt dirigé con-
tre les « barbares » des quartiers
défavorisés.
Il vise aussi à séduire ceux que
le flot de propos alarmistes sur la
violence scolaire et la « montée de
l’intégrisme » inquiète ou effraie.
Le ministre de l’Éducation na-
tionale consacre ainsi l’hégémonie
de la pensée conservatrice sur le
sujet de l’école, comme d’autres
ministres de gauche l’ont consa-
crée, par leurs déclarations, sur les
questions du travail sexuel, de
l’homoparentalité, de l’immigra-
tion, et de la sécurité.
C’est une tendance qu’il faut, à
mon avis, combattre sans se lasser.
●Ruwen Ogien
1. Ruwen Ogien est philosophe,
directeur de recherche au CNRS,
membre du Centre de recherche Sens,
Éthique, Société. Ses travaux portent
notamment sur la philosophie morale et
la philosophie des sciences sociales. Il
a publié de nombreux ouvrages, dont
L’Éthique aujourd’hui. Maximalistes et
minimalistes (Gallimard, 2007) et plus
récemment L’Influence de l’odeur des
croissants chauds sur la bonté humaine
et autres questions de philosophie
morale expérimentale (Grasset, 2011).
© Flore-Aël Surun/Tendance oue
1
/
2
100%