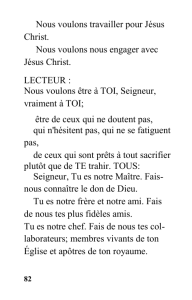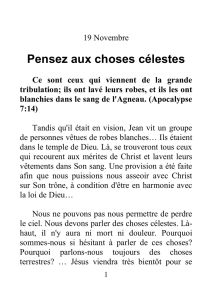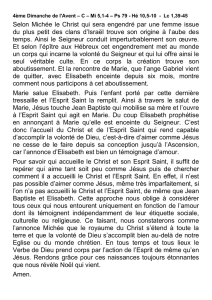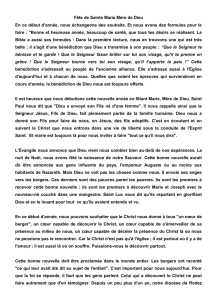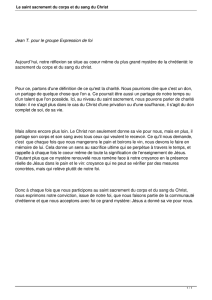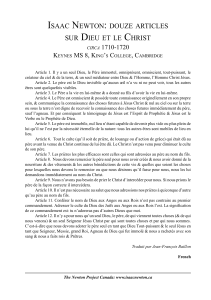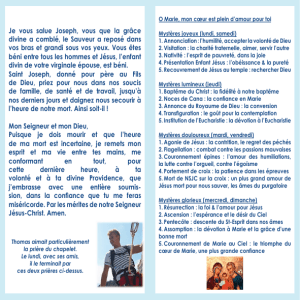Les trois corps de charité du Christ

1
Conférence présentée dans le cadre d'une session annuelle de recherche pastorale
organisée en février 2014 dans le diocèse de Quimper
Les trois corps de charité du Christ
Par jean-Yves Baziou
1
Allons à l’origine pour voir comment s’esquisse le style de vie de charité dans les trois
corporéités du Christ : Jésus, le corps sacramentel puis le corps ecclésial du Christ.
Jésus : le libre don de soi
La forme évangélique de l’exercice de l’autorité est le service. Des expressions
reviennent dans la bouche de Jésus : les premiers seront les derniers, le plus grand parmi vous
sera votre serviteur. Ce style évangélique d’exercice du pouvoir est compris comme étant en
rupture avec les façons habituelles de faire : « il n’en est pas ainsi parmi vous »
2
. La manière
dont Jésus se démarque paraît s’appuyer sur une évidence commune : « vous le savez »
3
. En
effet comment sont habituellement posées les relations de pouvoir : « les chefs des nations les
tiennent sous leur pouvoir (katakurieuousin) et les grands sous leur domination »
4
. Le verbe
grec signifie exercer sa domination à son bénéfice, faire sentir sa puissance. Le rapport
inégalitaire de pouvoir consiste, tel donc qu’il est vécu habituellement, à établir un rapport
de sujétion forcée. Cette sujétion forcée est perçue comme négative dans les évangiles, à
commencer par le magnificat : « Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les
humbles »
5
. C’est face à cette relation d’assujettissement que les évangiles posent le rapport
de pouvoir comme une relation de service : « Au contraire si quelqu’un veut être grand parmi
vous, qu’il soit votre serviteur (diakonos) »
6
. Cette relation de service tendra à désigner
l’existence chrétienne elle-même.
Mais, rapporté à Jésus, ce comportement se précise encore : « C’est ainsi que le Fils
de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude »
7
. Le don de la vie en rançon transforme quelque peu la relation de service. Il la
rapproche de la situation de l’esclave : « Et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il
soit votre esclave (doulos) »
8
. Le propre de l’esclave est de pouvoir être vendu, de « servir »
1
Notice bio-et bibliographique de l’auteur : http://theologie.icl-lille.fr/img/pdf/BAZIOU.pdf
2 Mc 10, 43 ; Mt 20 ; 26 ; Lc 22, 26
3 Mc 10, 42 ; Mt 20, 25
4 Mt 20, 25
5 Lc 1, 52
6 Mt 20, 26
7 Mt 20, 28
8 Mt 20, 27

2
à un échange marchand. Il a une valeur d’usage : on quitte ici une relation de service où
chacun est à égalité de dignité. Le mot « service » peut donc être ouvert dans deux directions.
La première le rapporte à une relation où l’un sert un autre ; la seconde pose un lien où l’un
sert à un autre. Dans ce dernier cas l’idée de rançon évoque celle du rachat. Le Fils de
l’homme n’est pas seulement celui qui sert les autres mais celui qui sert au rachat des autres
ou de quelque chose. C’est donc la relation d’échange « de » soi qui vient caractériser le
service au sens chrétien : Jésus va jusqu’au bout du « servir » dans l’acte d’être vendu. Ce
faisant, il disparaît comme sujet capable d’initiative, ce que dit bien l’image de la livraison : il
fut livré pour. C’est en allant au plus bas de la relation de service que Jésus permet le rachat,
c’est-à-dire l’élévation de ceux pour qui il se livre. Ce mouvement de l’abaissement qui
accomplit une élévation est fréquent dans les évangiles. Par exemple Jésus rencontre les gens
les plus méprisés pour en reconnaître la dignité : on peut penser à l’épisode de la femme
adultère, ou à la parabole de l’enfant prodigue. De même il accepte l’invitation de Zachée.
Les récits évangéliques mettent ainsi en évidence le caractère de livraison de son
existence. Mais Jésus se livre librement. Saint Jean va méditer sur ce point : le libre don de soi
caractérise et résume l’existence de Jésus
9
. La désappropriation de soi fait partie de son
pouvoir. Son autorité intègre un mouvement de « dé-maîtrise » : Jésus vit selon une logique
de kénose. Avec ce terme, saint Paul parle de dépouillement, du geste de se vider, de la perte
de toute forme. Cette absence de forme fait apparaître comme en creux l’image d’une
humilité de Dieu. L’idée de gloire divine se renverse : Dieu est puissant au point de se lier à
l’extrême impuissance. Adopter l’impuissance est une marque de puissance dans la mesure où
elle est librement voulue. La puissance de Jésus se manifeste dans sa capacité à la transcender
dans l’humilité. C’est par là qu’il participe à l’être de Dieu dans l’acte de se livrer librement.
Mais cette livraison de soi, cet abandon de Jésus n’équivaut pas à un anéantissement. Elle a
une fécondité : l’eucharistie et les évangiles.
L’eucharistie porte le sens de ce don de Jésus. Elle unit, dans sa symbolique même, le
geste de se livrer et l’état du Christ livré : le pain rompu est la métaphore du corps brisé et le
vin celle du sang versé. Jésus a lui-même signifié dans le dernier repas qu’il s’en remettait au
Père, à l’Esprit et à l’Eglise qui, elle, « fait activement à travers les temps ce que le geste de
Jésus lui a remis »
10
. Se livrer de cette sorte entre les « mains » de Dieu et des autres est une
façon de renoncer à disposer de soi-même. Par le don de soi, Jésus indique une orientation de
vie : passer « de l’oeuvre qu’on accomplit soi-même à l’oeuvre qu’on laisse réaliser en soi »
et qui est celle de Dieu
11
. C’est ce qu’il réalise lui-même en passant d’une attitude de décision
sur soi à une disposition d’accueil : il accueille ceux qui viennent après lui comme ceux que
Dieu lui donne et lui-même leur est donné comme un sacrement. Le don de soi fait qu’il
demeure comme nourriture pour ceux qui s’en reçoivent, le suivent et le fréquentent. Telle est
la signification de son association à la symbolique du pain et du vin : il rassasie d’avoir été
lui-même broyé. Il irrigue les vies de s’être donné. Ainsi l’eucharistie rend-t-elle compte dans
l’Eglise de la forme pascale du Christ.
9 Jn 10, 18 ; 1 Jn 3, 16
10
H. U. von Balthasar, La gloire et la croix, III, Tome 2, Paris, DDB, 1990, p. 130
11
ibidem, p. 131

3
Quant aux évangiles, ils sont des paroles sur la Parole de Dieu en personne ; ils sont la
trace paradoxale d’une existence peu à peu privée de toute parole ! Les paroles des évangiles
ne remplacent pas l’abandon ni le deuil de Jésus : la parole qui parle le plus haut reste le
silence de la croix. Leur sens est d’indiquer seulement que le pouvoir ultime est exercé par un
Seigneur qui ne triomphe pas à la manière des seigneuries terrestres. Son triomphe passe par
l’abandon. C’est ainsi que M. Gauchet a pu parler de « Messie à l’envers », à rebours
justement de nos imaginaires communs de réussite.
Ajoutons que le don de soi de Jésus est sans réserve car il s’exerce sans retour
équivalent. Le thème de l’illimité du don revient souvent dans les évangiles. Ainsi il n’y a pas
de limite à l’amour du prochain : « vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, Lui, pour
les ingrats et les méchants. Montrez-vous miséricordieux, comme votre Père est
miséricordieux »
12
. Les écrits évangéliques soulignent encore la disproportion entre la
grandeur de la moisson et la rareté des ouvriers, l’exigence par rapport à l’ouvrier qui doit
servir sans mesure
13
. Démesure aussi par rapport au figuier : il devrait porter du fruit alors
que ce n’est pas la saison. Cette notion de démesure induit un style de relations qui dépassent
la logique de l’échange marchand. L’Evangile opère le dépassement de la logique
d’équivalence. A l’inverse d’Aristote pour qui on rend « des choses égales pour des choses
égales » et « des choses inégales pour des choses inégales »
14
, le Christ tient qu’il peut y avoir
des choses égales pour des choses inégales : par exemple tous les hommes peuvent être traités
également en dépit de leur inégalité de force ou de statut. Ce qui importe ici est que cette
démesure du don n’est pas pure perte : par le don sans réserve de lui-même, Jésus donne force
au-delà de lui-même. Sa force et son pouvoir adviennent à leur plénitude et à leur
accomplissement à l’extrémité du don. La langue française exprime ce mouvement dans une
formule très suggestive pour notre propos : on peut « être vidé » à aider un autre. Ainsi
s’exprime Robert Badinter quand il raconte le comportement de l’avocat de Bomtems (dernier
condamné à avoir subi la peine de mort en France), Philippe Lemaire, à partir du moment où
Bontems est averti de l’exécution par guillotine : « Alors commença une chose extraordinaire.
Philippe prit Bontems par le cou et lui parla. Ce n’état pas un discours mais une incantation
verbale où, sans cesse, revenait le mot courage. (…)Il interdit à l’horreur d’entrer, il ferma
Bontems à la peur, à l’angoisse, (…) Philippe avait toujours sa main sur son épaule. (…)
Philippe lui parlait… l’étreignit (…). Nous entendîmes le claquement sec de la lame sur le
butoir. (…) Philippe appuyait sa tête contre le mur. Toutes ses forces il les avait données à
Bontems pour qu’il meure bien. Maintenant, il n’en pouvait plus. Il était le coureur épuisé qui
s’effondre après l’arrivée »
15
.Tel est le sens chrétien de la mort du Christ : s’il s’est vidé de
lui-même, c’est pour donner force à d’autres. Ajoutons que le mot « vider » en langage
populaire peut désigner aussi l’acte d’une exclusion : les exclus se font vider de partout... Cet
aspect n’est pas non plus étranger à la Pâque du Christ : celui-ci s’est vidé, a été vidé ... sans
trop se défendre.
12 Lc 6, 35-36
13 Lc 17, 7-10
14
C. Bruaire, Politique et miséricorde, Communio, n° 6, juillet 1976, p. 18-22
15 R. Badinter, L’exécution, Paris, Livre de Poche, p. 216-219

4
Le corps eucharistique du Christ
Evoquons à présent le corps eucharistique du Christ. Concernant les corporéités
du Christ, saint Paul fait une distinction entre le corps psychique et le corps spirituel
16
. Le
corps psychique est le corps singulier de Jésus. Le corps spirituel est le corps de résurrection
du Christ. Pour saint Paul la disparition du corps psychique de Jésus est le négatif nécessaire à
l’avènement du corps de résurrection du Christ. Il a fallu que Jésus meure pour que soit
reconnue sa face christique, pour que le Christ soit pleinement manifesté. Et si le corps
psychique était lié à un temps et un lieu, le corps spirituel est ouvert à l’ensemble des hommes
et au futur du temps historique. Paul lie donc mort et résurrection de telle sorte que la Passion
conditionne la résurrection. C’est cette articulation qui ouvre sur une intelligence de
l’eucharistie.
Paul va notamment débattre avec les Corinthiens pour défendre la mémoire de la Cène
dans le repas cultuel chrétien. Le Christ est le président du repas mais cette présidence ne doit
pas effacer la condition crucifiée du ressuscité. C’est ce qui différencie le repas cultuel
chrétien par rapport aux repas cultuels hellénistiques. Dans l’environnement hellénistique, des
sacrifices d’animaux étaient offerts dans les temples. Une partie des viandes était brûlée pour
le dieu tandis que le reste était consommé par le clergé et les fidèles lors d’un repas rituel. Le
dieu était considéré comme invitant à sa table et la présidant lui-même : ainsi parlait-on de la
« table du Seigneur » dans le culte à Sarapis. Une place était même réservée au dieu : elle était
symbolisée soit par la présence, sur le lit de table, d’une statuette richement habillée, soit par
un fidèle jouant le rôle du dieu. Or dans le rituel eucharistique chrétien, il n’est pas seulement
dit que le Christ préside actuellement le repas, mais aussi que cette présidence est celle du
Crucifié : le repas est encadré par les paroles de la Cène qui donnent le sens de la Croix. Le
repas chrétien est dominé par la mort du Ressuscité. Le repas eucharistique est l’espace-temps
de mémoire de la mort de Jésus
17
. Il y a pour saint Paul indissociabilité de la Croix et de la
Résurrection. Or les Corinthiens tendaient à oublier ce lien avec le crucifié, réduisant du coup
le repas chrétien à un repas cultuel hellénistique ne célébrant que la présence du dieu. Dans le
milieu corinthien, la Croix fait problème. Saint Paul l’y présente d’ailleurs comme un signe de
folie
18
. Pour lui, le ressuscité demeure le crucifié et la Croix est le signe du salut pour tous.
Le repas chrétien n’a de sens que rattaché à la Croix. Il est le signe et l’annonce de la mort du
Seigneur : « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne »
19
. En rappelant les paroles de
bénédiction du dernier repas de Jésus, les chrétiens affirment que celui qui préside, celui qui
continue de rompre le pain et de tendre la coupe, est le Seigneur qui se dispose lui-même à
être crucifié. Ils rappellent donc un départ : l’anamnèse de la Cène signifie la Croix toujours
là. Le Corps eucharistique du Christ est aussi le corps du Crucifié qui demeure dans le présent
16 - 1 Co 2, 6 - 16
17 - 1 Co 11, 26
18 - 1 Co 1,17 - 18 . 23 ; 1 Co 2, 2 - 8
19 - 1 Co 11,26

5
de l’Eglise et des vies. Et en recevant le corps eucharistique du Christ, la communauté se
range sous la souveraineté du crucifié
20
. Qu’en résulte-t-il alors pour le lien ecclésial ?
Le lien sacramentel : le Christ comme trait d’union
Le corps ecclésial du Christ ne s’enracine pas dans la naissance, la parenté ou
l’appartenance culturelle. Ce sont des rites sacramentels qui en rendent membres,
particulièrement le baptême et l’eucharistie : ils signifient le lien essentiel à l’altérité du Christ.
Le lien essentiel au Christ est d’abord mis en évidence par le fait que les communautés
chrétiennes naissantes n’ont pas de lieu de culte particulier : les bâtiments spécifiques
n’apparaîtront que vers le troisième siècle. Les réunions se font dans les maisons, c’est-à-dire
sur les lieux de la vie quotidienne et profane
21
. Il n’y a pas non plus d’objets, de vêtements ou
de symboles uniquement cultuels, pas plus que d’ablutions ou de prescriptions de pureté. Ce
qui est décisif n’est pas le lieu ou les objets mais le nom du Christ, ce que font apparaître le
baptême et le partage eucharistique.
Ainsi, avant d’intégrer à une communauté spécifique, le baptême est fait « au nom
de Jésus-Christ ». Il engage une double relation. Tout d’abord, par le baptême, chacun est uni
à la mort - résurrection du Christ : « Nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa mort
que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec
lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts (...), nous menions nous aussi une vie
nouvelle »
22
. Ensuite, c’est sur cette base que le lien au Christ établit une relation entre les
baptisés car il réunit diverses identités religieuses, culturelles et sociales : « Nous avons tous
été baptisés (...) pour être un seul corps, Juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres »
23
. Le
baptême laisse apparaître une double mise en relation, d’une part entre le baptisé et le Christ,
d’autre part entre les baptisés par la médiation du rapport au Christ.
20 - C. Perrot, Lecture de 1 Co 11,17 - 34, in ACFEB
Le corps et le Corps du Christ dans la première épître aux Corinthiens, Paris, Cerf
(Lectio Divina n°114), 1983, p. 96
21 - La maison est une unité fondamentale de la Cité antique. Elle ne se définit pas seulement par des relations de parenté mais comme une
entité où les différents membres entretiennent des relations à la fois d’interdépendance et de subordination. Le chef de la maison est le père
de famille qui est responsable de tous ceux qui y vivent et en vivent : famille, esclaves, anciens esclaves devenus clients, salariés, associés ou
fermiers. Les fouilles de Pompéi ont fait apparaître la structure matérielle de ce type de groupe social : “chambres privées et bureaux du chef
de famille, zone pour les femmes et les enfants, appartement des esclaves, chambres, magasins vers la rue ( taverne ? hôtel ?) avec, au centre,
la chambre à manger comme lieu de rencontre”. ( Yann Redalié, Paul après Paul. Le temps, le salut, la morale selon les épîtres à Timothée
et à Tite, Genève, Labor et Fides, 1994, p. 266).
La maison va représenter l’élément-noyau du christianisme naissant. La liste finale des salutations en conclusion de l’épître aux Romains
mentionne ainsi plusieurs communautés domestiques. Le Livre des Actes cite les maisons de Corneille ( Ac 10, 2), de Lydie (Ac 16, 15), du
geôlier à Philippes (Ac 16, 31-34), de Crispus (Ac 18, 8 et 1 Co 1, 14), de Titius Justus chez qui saint Paul descend à Corinthe (Ac 18, 7).
C’est aussi dans la chambre haute d’une maison que les Onze élisent Matthias ( Ac 1, 13 et 26). L’expérience de la Pentecôte est mise en
scène dans une maison ( Ac 2, 2). Avant sa conversion, saint Paul “pénétrait dans les maisons” pour persécuter l’Eglise (Ac 8, 3). En
s’appuyant sur des communautés domestiques, le christianisme se situe dans la ligne de la tradition juive de la diaspora qui s’est structurée à
partir des familles. Mais il s’en distingue sur le point que nous mettons en évidence : il n’y a pas de Temple comme référence centrale, ni
d’unité généalogique.
22 - Rm 6, 3 - 4
23 - 1 Co 12, 13
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%