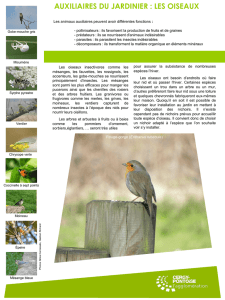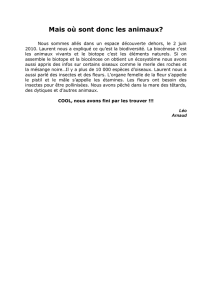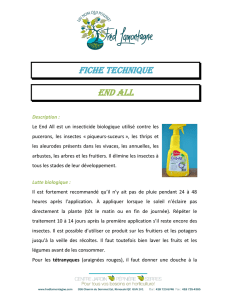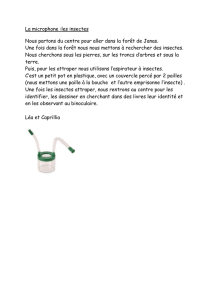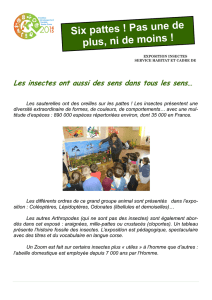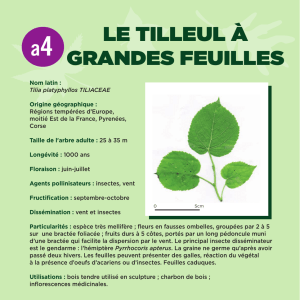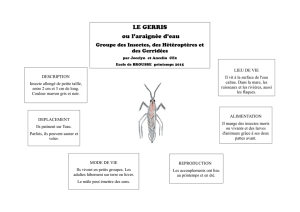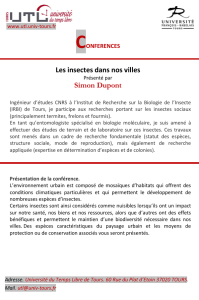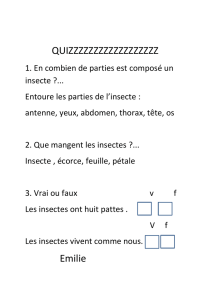télécharger le pdf - Alisea


découvrir la biodiversité
la faune
Environ 60 espèces d’oiseaux pour la
plupart nicheurs dont 5 remarquables ;
5 mammifères terrestres et 5 espèces
de mammifères volants (chauve-souris) ;
6 espèces d’amphibiens dont une
remarquable ;
2 espèces de reptiles ;
37 espèces d’insectes ;
12 espèces de lépidoptères (papillons) ;
5 espèces d’orthoptères (criquets) ;
7 espèces d’odonates (libellules) ;
10 espèces de coléoptères (scarabées).
Alyte accoucheur
© Laurent Lebois
© Aliséa
© Ali Taylor © Aliséa
les chiffres clés du vésinet
Trèfle semeur
Pouillot fitis
Hérisson Commun
Ce guide est complété par le livret « 2 parcours pédestres
à la découverte de la biodiversité du Vésinet ». Ces guides
sont accessibles auprès du secrétariat Écologie Urbaine et
Environnement ou en téléchargement sur le site Internet de la Ville:
www.levesinet.fr
500 hectares de superficie communale ;
5 lacs artificiels (sur 6,4 hectares): le lac Supérieur, le lac Inférieur, le Grand lac
des Ibis, le lac de la Station et le lac de Croissy ;
4 km de rivières ;
31 hectares de pelouses classées , dont 14 hectares de pelouses
sablo - calcaires ;
Plus de 40 000 arbres dont 6 000 sur le domaine public.
le diagnostic de la biodiversité, réalisé
en 2012, a permis d’identifier de
nombreuses espèces .
la flore
les surfaces de pelouses laissées en
prairie naturelle ont permis d’identifier :
Plus de 260 espèces végétales sur
moins de 100 hectares inventoriés ;
Une cinquantaine d’espèces
végétales remarquables, 6 espèces
menacées, avec souvent des populations
exceptionnellement importantes ;
Entre 3 et 7 espèces qui pourraient
être protégées dès 2013/2014
(évolution de la réglementation à venir) ;

définition
la biodiversité : c’est la diversité du
vivant:
des milieux naturels ;
des espèces ;
des gènes.
Aujourd’hui, on connaît près d’1,6 million
d’espèces animales et végétales sur
terre, sur 3,6 à 100 millions qui existeraient
(selon les estimations).
la disparition de la biodiversité
les causes sont diverses mais sont
souvent liées à l’activité humaine. Les
principales causes sont :
1ère cause: la destruction des habitats.
La modification du paysage par l’urba-
nisation croissante, le bétonnage, ont
fragmenté les habitats, empêchant ainsi
la circulation des espèces, nécessaire à
leur alimentation et leur reproduction.
2ème cause : la prolifération des
espèces invasives.
Ces espèces proviennent d’autres conti-
nents ou de pays voisins. Elles n’ont pas de
prédateurs ou de concurrents qui permet-
traient de limiter de manière naturelle
MieuX coMprendre la biodiversite
leur répartition et leur abondance dans
les habitats naturels. De fait, elles détério-
rent, déplacent ou détruisent les espèces
indigènes dans les forêts, les zones
agricoles, les zones humides.
3ème cause: la pollution.
Elle est émise sous de nombreuses
formes : pollution atmosphérique, pollu-
tion des sols et de l’eau, pesticides,
matières particulaires et métaux lourds.
La pollution peut également perturber
les processus écologiques et la pollution
lumineuse joue un rôle négatif pour de
nombreuses espèces d’oiseaux.
DISPARITION DE LA BIODIVERSITÉ =
PERTES DE CHANCE POUR L’ÊTRE HUMAIN
Des espèces disparaissent avant
même qu’on les ait découvertes,
privant ainsi les êtres humains de
leur utilisation à des fins alimentaires,
médicales, de fabrication, de
cosmétiques ou tout simplement
d’étude.
La disparition d’une espèce entraîne
l’effondrement de tout un système
écologique en détruisant la chaîne
alimentaire.
LES TRAMES VERTES ET BLEUES
SONT CONSTITUÉES DE CORRIDORS
ÉCOLOGIQUES
La prise en compte des connexions
entre les espaces naturels se traduit
à l’échelon national par la création
de la trame verte et bleue, découlant
des réflexions du Grenelle de
l’environnement (Loi Grenelle II de
mai 2010) et concrètement par la
réalisation du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique.
la circulation des espèces
un réseau écologique comprend trois
éléments de base :
Des zones noyaux : elles sont des
puits de biodiversité. Ce sont des zones
riches en espèces et en ressources néces-
saires à leur développement.
Des corridors écologiques (ou
« continuités écologiques ») : ils assu-
rent les relations entre les zones noyaux.
Ils peuvent être linéaires (haie boisée,
bande fleurie, route, cours d’eau, talus…)
ou ponctuels, parfois appelés « pas japonais ».
Des zones tampons: elles protègent
les zones noyaux et les corridors des
influences extérieures potentiellement
dommageables.
Renouée du Japon
© Pixeltoo
© Aliséa
© NASA
ZIEM =
Zone d’Intérêt Écologique Majeure

la nature des sols du vésinet
LE BIOTOPE
Le terme biotope doit être entendu
au sens large de « milieu indispensable
à l’existence des espèces de la faune
et de la flore ».
C’est une aire géographique bien
délimitée, dont les conditions
particulières (géologiques, hydrologiques,
climatiques, sonores…) sont nécessaires
à l’alimentation, la reproduction,
le repos de certaines espèces.
En 1604, le roi Henri IV achète le bois et
le fait estimer: « terres non labourables,
en friches, bruyères, hayes, buissons,
pasturages et joignant icelles terres,
une petite garenne peuplée de lapins».
Une superficie de 31 hectares (312 783 m²).
Le Vésinet est donc constitué de milieux
sableux secs et pauvres en nutriments,
autrefois appelés « Garennes » et utilisés
pour la chasse aux lapins.
Ces caractéristiques créent de fortes
contraintes écologiques sur les biotopes :
Un sol sableux qui retient mal l’eau
et les nutriments solubles tels que l’azote,
le phosphore, le potassium, nécessaires
aux espèces, avec cependant un apport
satisfaisant en calcium et magnésium
(terrasses alluviales peu décalcifiées).
Un apport en eau dépendant de la
nappe dans la craie: en été, la nappe
phréatique descend, créant ainsi un
stress hydrique très important.
les 3 MilieuX du vesinet
© brgm
la communauté végétale, c’est-à-dire
les types de plantes et herbes spéci-
fiques à un milieu, dépend du type de
nature du sol, tant au niveau géologique
qu’au niveau de l’humidité présente
dans le sol.
Au niveau géologique, la Seine a déposé
des sédiments sur la plaine alluviale, mais
également des matériaux sableux et
caillouteux. L’eau passe à travers le sol
poreux (elle « percole » dans les terres), les
nutriments sont ainsi entraînés dans les
profondeurs.
Il existe 3 types de milieux au Vésinet :
Les milieux ouverts correspondant
aux zones de pelouses et principalement
situés dans l’espace public ;
Les milieux boisés correspondant en
majorité à l’espace privé ;
Les milieux aquatiques constitués
par les lacs et rivières et principalement
situés dans l’espace public.

les MilieuX ouverts : les pelouses sablo-calcaires
L’amélioration de l’état de certaines
pelouses dégradées est possible en
supprimant des facteurs défavorables,
tels que les densités trop fortes d’oiseaux
(Oies Bernaches du Canada) qui piéti-
nent les pelouses ou la présence de robi-
niers, arbres qui en enrichissant le sol en
azote appauvrissent la diversité végétale
autour d’eux.
les gestes de la coMMune
la fauche tardive
La gestion différenciée des espaces
verts, qui consiste à « réaliser le bon entre-
tien au bon endroit » se traduit sur les
pelouses par des modes de tonte différents.
Sur les pelouses présentant un intérêt
floristique très fort, la commune a défini
des zones prioritaires pour lesquelles elle
pratique une fauche tardive. Cela signifie
que la pelouse n’est tondue qu’une seule
fois par an (en septembre) une fois que
le cycle de reproduction des plantes a
été effectué. Le cortège floristique est ainsi
maintenu et de nombreuses espèces des
prairies (papillons, crickets, oiseaux etc)
peuvent s’alimenter et se reproduire au
sein de ces espaces.
Les autres zones ne sont tondues que de
5 à 7 fois par an. Les produits de la tonte
sont finement broyés sur place et déposés
sur le sol pour l’enrichir et l’humidifier.
la protection foncière
Les pelouses sont
classées au titre des
Monuments et des Sites,
elles sont donc incons-
tructibles.
© Paulo 1184
© Aliséa
© Michael Appel
Demi-deuil
le diagnostic écologique a mis en
évidence la présence de pelouses
sablo-calcaires qui sont remarquables à
deux niveaux :
Leur superficie: 7 ha de pelouses
en bon ou très bon état ont été recensés
et 7 ha en mauvais état mais suscep-
tibles d’être restaurés assez aisément. La
commune abrite donc environ 1 % du
total de la surface des pelouses sablo-
calcaires intégrées au réseau Natura 2000
français, ce qui, selon l’évaluation du
Ministère de l’Ecologie, fait du Vésinet
un site important au niveau national
pour la conservation de cet habitat
particulièrement rare et menacé (moins
de 2000 ha en tout dans le réseau Natura
2000 français).
Leur typicité et leur richesse floristique:
il est extrêmement rare de trouver autant
d’espèces caractéristiques menacées sur
un même site.
Une cinquantaine d’espèces végétales
remarquables a été identifiée sur ces
pelouses dont le Trèfle semeur en danger
d’extinction et qui a la particularité de
semer lui-même ses graines en les enfouis-
sant dans le sol.
les gestes citoyens
la gestion différenciée de vos pelouses
La préservation de la flore ne doit pas
être limitée qu’au domaine public. La mise
en place dans un endroit de votre jardin
d’une zone plus « sauvage » permettra à
cette flore remarquable de se développer.
Cet espace, même de quelques mètres
carrés, doit être situé de préférence à
l’écart des chemins de circulation pour
éviter le piétinement et le dérangement.
L’entretien de cette « friche » se fait une
fois par an à l’automne, avec exportation
des produits de fauche (vous pouvez les
mettre dans votre composteur).
LES INSECTES POLLINISATEURS, ESSENTIELS À LA VIE !
Il s’agit d’insectes, en particulier les hyménoptères (abeilles), qui, en butinant
les fleurs pour se nourrir, transportent du pollen d’une fleur à une autre et en assurent
la pollinisation.
Ces insectes sont indispensables à la production de graines, de fruits et légumes.
80 % des plantes ont absolument besoin des abeilles pour être fécondées.
Pourtant ces insectes sont en déclin, menacés par les différents polluants présents
dans la nature (insecticide, désherbant…).
Globalement même si les chiffres ne sont pas arrêtés, 20 à 30 % des abeilles
disparaissent chaque année (avec une augmentation du pourcentage
ces dernières années).
Voici les insectes remarquables des pelouses du Vésinet qui sont favorisés :
l’Oedipode turquoise, espèce protégée en Ile-de-France
l’Hespérie de l’alcée (ou L’Hespérie de la passe-rose), espèce déterminante
de ZNIEFF
le Demi-deuil, espèce déterminante de ZNIEFF
Mais les populations d’insectes ordinaires sont aussi fortifiées et pérennisées.
Pelouses en fauche tardive
© Aliséa
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%