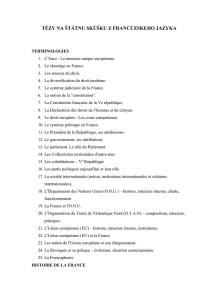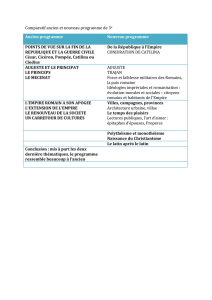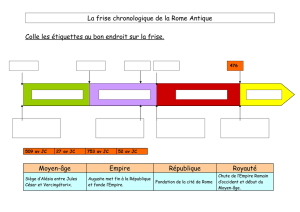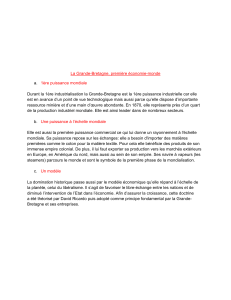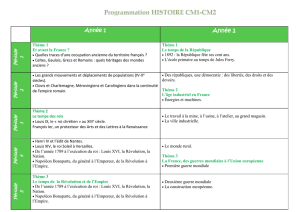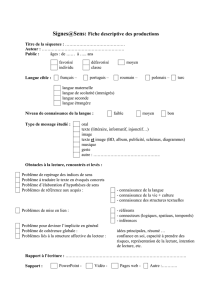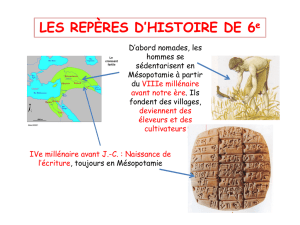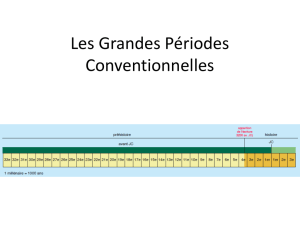L`imaginaire du francais et du turc dans le saint

1
L’IMAGINAIRE DU FRANÇAIS ET
DU TURC DANS LE SAINT EMPIRE AU
XVIIE SIÉCLE
A mesure qu’ils stylisèrent le « morcellement » du Saint
Empire en Etats territoriaux, à défaut donc de toute évidence de
leur identité politique, les contemporains durcirent les images
de l’autre, tendues entre les deux pôles de la barbarie (le Turc)
et de la civilisation (le Français). La guerre de Trente ans
(1618-1648), vécue comme une guerre civile et une guerre de
religion, puis les offensives menées successivement – ou
concomitamment – par la France à l’ouest et l’Empire ottoman
au sud-est, intensifièrent ces représentations en même temps
qu’elles leur firent subir de profondes inflexions.
A première vue, ces deux images diffèrent largement
l’une de l’autre tant par leur origine que dans leur expression.
Celle du Turc, d’abord, était partagée entre deux inspirations
divergentes. D’un côté, l’interprétation de la statue vue en
songe par Nabuchodonosor (Daniel 2 [31-44], 7, 8), qui lui
conférait une dimension prioritairement macro-historique, voire
eschatologique. De l’autre, une construction du barbare héritée
de l’Antiquité, propre à faire le miel de toutes sortes de récits
anecdotiques ; l’image du Français, issue des attaques des
humanistes contre la civilisation « welsch » (c’est-à-dire
« romaine », ou plutôt « latine ») s’ancrait dans un anti-
curialisme virulent, prompt à la satire. L’une et l’autre toutefois
s’adressaient prioritairement aux Allemands, et avaient pour
fonction de souligner ex negativo – de façon plus normative que
descriptive - l’originalité allemande, si bien qu’elles doivent
être comparées et confrontées l’une à l’autre.
Cet article se propose de souligner la complexité des
représentations du barbare et du civilisé ; il montrera que ces

2
images et leur politisation progressive, accompagnée et
amplifiée par un rabattement de l’une sur l’autre, reposèrent sur
les théories médicales et scientifiques des fonctions cognitives.
Le terme d’« imaginaire » sera donc pris dans son sens fort, à
savoir celui des conceptions que les contemporains se formaient
de l’imagination. Cet article se réclame non pas de l’« histoire
des mentalités » - dans laquelle l’« imaginaire » est
implicitement assimilé à la notion, fort vague, de
« représentation » -, mais du champ de recherche avant tout
anglo-saxon de l’épistémologie des sciences. Les sources
exploitées seront par conséquence celles qui se présentent
comme des fictions, voire comme des visions ou des rêves.
Ainsi pourront être dégagés les différents « lieux » (physiques
ou abstraits) où s’insinua la frontière entre l’« extérieur » et
l’« intérieur », et les divers modèles anthropologiques desquels
les images de l’autre puisèrent leur expression. On dégagera
précisément le passage de la physiologie (comme fondement du
mimétisme du Français) à l’épistémologie (la
« fictionalisation » des images) au cours du siècle.
Le mimétisme du Français
La guerre de Trente ans cristallisa une réflexion
générale sur la nature du pouvoir et sur ses limites, c’est-à-dire
sur les relations entre la violence, le discours et les signes. A
l’instar, notamment, de la France des guerres de Religion, on
attribua à la langue un pouvoir conjuratoire sur le drame civil.
À la différence, toutefois, du voisin occidental, où des
théoriciens avaient imposé à l’orée du XVIIe siècle un style dit
« vulgaire » par référence à Dante à la Cour du Louvre, unique
et centrale, en Allemagne, des princes et des hommes de lettres
se regroupèrent (souvent de façon seulement épistolaire) dans
des « sociétés de langue » (Sprachgesellschaften) dispersées de
la Silésie à Strasbourg
i
. A leurs yeux, l’épuration des mots,
français avant tout, dont la langue semblait avoir été envahie en
même temps que l’Allemagne par les soldats, avait un sens
politique. Considéré comme le propre de l’homme en société,
comme le truchement par lequel le désir singulier était dépassé et

3
absorbé dans la culture, le langage était promu en un instrument
apte à fonder la paix.
Aussi, la maxime aristotélicienne, par laquelle la guerre
voyait la prévalence de l’« intérêt particulier » (Eigen-Nutz) sur
le « bien commun » (gemeiner Nutzen) fut investie d’une
dimension linguistique. La guerre, c’était Babel, car plus
personne ne voulait comprendre autrui ni lui obéir. En guise de
remède à cette perversion sémantique, maints libelles
avancèrent les qualités dites « ancestrales » du peuple
allemand : son « honnêteté » (Redlichkeit) et sa « sincérité »
(Aufrichtigkeit). Ces termes avaient alors un sens très fort.
L’« honnêteté » désignait la conformité de la chose à l’être, de
la parole à la pensée. Quant à la «sincérité », elle était dotée,
dans les textes avant tout d’inspiration luthérienne, d’une
connotation théologique : Aufrichtigkeit dérivait sans doute de
aufrecht halten, « tenir droit », désignant la capacité de
l’homme, même après le péché originel à s’amender, ou du
moins à retenir encore une lueur divine – ceci avant tout face à
l’anthropologie calviniste, bien plus pessimiste. L’unité
politique et linguistique semblait porter la promesse d’une
réconciliation théologique de l’homme avec son Dieu. Cette
aspiration très forte se cristallisa autour du thème de la raison
d’Etat et de l’influence, jugée pernicieuse, du modèle aulique
français.
Le thème de la raison d’Etat pointait l’émergence et la
montée en puissance de l’individu politique caractérisé par la
force et le calcul, bref, l’inverse du « bien commun ». Par
rabattement sur le topique baroque de l’opposition entre l’être et
l’apparence, la raison d’Etat en vint à être reléguée dans le
domaine du simulé, du vain et du faux. Le porte-parole le plus
éloquent (et le plus influent) de ces représentations et de leur
fixation sur le courtisan français, fut le satiriste Johann Michael
Moscherosch, contempteur et acteur – en tant qu’envoyé du
Wurtemberg à la cour de France en 1645-1646 – des nouveaux
modèles politiques, et auteur des Visions de Don Quevedo,
adaptées par la suite dans quantité de libelles
ii
.
Reprenant l’image, créée par Plutarque pour présenter
le chef spartiate Lysandre et employée par Machiavel dans le
chapitre 18 du Prince - et devenue depuis un lieu commun de

4
l’antimachiavélisme
iii
-, Moscherosch qualifiait le prince par la
double image du loup (pour la force) et du renard (pour la ruse).
Jouant sur l’attrait récent pour les arcana imperii – quant bien
même cette doctrine avait été élaborée en réaction à
Machiavel -, il introduisait son lecteur dans les chambres du
pouvoir. La première salle du gouvernement était tapissée de
manteaux multicolores, cousus à l’extérieur de fourrures mais
garnis à l’intérieur de doublures dépravées de loup et de renard ;
tous arboraient de grandes maximes : Bonum Publicum, Salus
Populi, Conservatio Religionis, etc. Mais leur usage et
mésusage quotidiens les avaient tant décousus qu’elles ne
tenaient plus que par le fil de l’intentio, par lequel on faisait
passer la haine, l’envie, la faveur, les présents et la jouissance
pour de l’amitié. La deuxième salle était décorée de masques si
finement coloriés qu’on les aurait pris pour des visages
humains ; parés des mots Simulatio, Calumnia, Ius Iurandum et
Fucus et utilisés lors des entrées et des mascarades princières,
ils servaient à extorquer des contributions de guerre et à
tromper les sujets. La troisième salle contenait tous les outils du
barbier, les jabots par lesquels on coupait les contributions, la
lessive acide avec laquelle on punissait les chefs rebelles et on
tourmentait le Saint Empire comme l’avaient dix années durant
la France et la Suède. Enfin, on avait rangé dans une armoire les
lunettes de l’Etat par lesquelles on pouvait transformer
l’apparence, la taille et la couleur des objets
iv
. La politique non
seulement était du ressort du feint, mais transformait aussi la
réalité en apparence trompeuse ; elle semblait rapprocher l’un
de l’autre le mensonge de la vérité. Ce qu’on rejetait dans la
« raison d’Etat », considérée à ce point ennemie que le terme
était ostensiblement écrit en français, c’était un nouveau statut
de la vérité.
La raison d’Etat était en effet incarnée par le courtisan
« à la mode » (Alamode), brillant de la séduction du monde,
attifé d’une accumulation de signes (les vêtements, les
mimiques et les locutions français). Tirant sa force d’un
discours où il se mettait en représentation, il avait une pensée
sans cesse autre, sans commencement ni fin ; son discours, qui
jamais ne faisait retour sur lui-même et jouait incessamment sur
l’illusion, dissolvait toute vérité absolue. Derrière la satire du

5
courtisan français se profilait sans doute un nouveau type
social, l’« honnête homme », désintéressé, inscrit dans des
relations sociales non hiérarchiques et tenant sa parole (c’était
toujours à un supérieur que la flatterie s’adressait)
v
. Dans sa
volonté de retrouver l’être sous l’apparaître et d’interdire toute
intrusion de l’illusion, Moscherosch refusait de cautionner des
degrés dans le faux discernés dans la littérature courtisane : le
secret (un trait de la politique, ni bon ni mauvais en soi), la
dissimulation (la suspension délibérée de la vérité) et la
simulation (un acte intentionnel). Le déboîtement des limites
religieuses et éthiques, placées désormais à l’extérieur du
pouvoir, menaçait le régime traditionnel de la véracité. Pour y
remédier, il fallait établir une frontière étanche entre le vrai et le
faux. Or la séduction du courtisan « à la mode » tenait
d’abord aux glissements de cette démarcation. Au cours du
XVIe siècle, c’était sur la question du non-conformisme
religieux que l’on s’était ingénié à tracer une frontière entre
l’intérieur et l’extérieur – propre à distinguer dans les domaines
dogmatiques (l’interprétation de l’Eucharistie et du signe),
sociologique (la médiation du clergé), puis physiologique (la
médiation entre les cinq sens extérieurs et les trois sens
intérieurs - l’imagination, la mémoire, l’entendement -, que les
« enthousiastes » niaient en prônant une inspiration immédiate
par des visions et des rêves) ce qui était « luthérien » de ce qui
était « enthousiaste » ou sectaire. Tandis que vers la fin du
XVIe siècle, l’imagination tendait à être définie comme la
faculté de former des fictions et de feindre le réel, on fit de la
conscience et du cœur les instances clefs de l’âme en même
temps que les critères de la véracité. Pour Moscherosch, la
séduction du courtisan français ne tenait pas à une opération de
l’imagination (comme ses contemporains, le satiriste se défiait
tant de la chose qu’il s’interdisait d’en prononcer le nom) mais
à ce que son action court-circuitait les voies usuelles de la
connaissance pour frapper directement les cœurs.
Dès le début de la vision « Welt-Wesen », Moscherosch
peignait un courtisan « à la mode » : homme supérieur en
apparence, il s’avérait, tandis qu’il s’approchait, à tel point
boursouflé par un orgueil intérieur qu’il était semblable à une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%