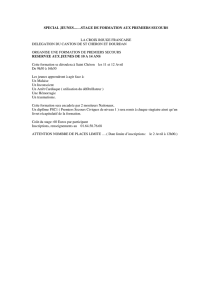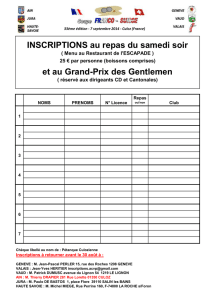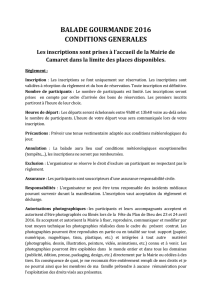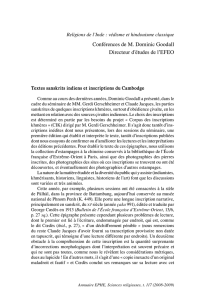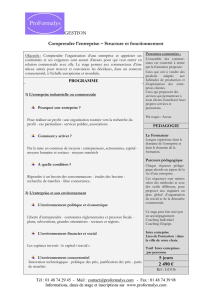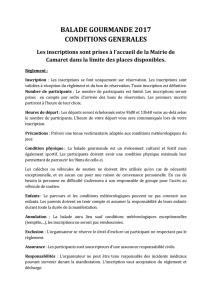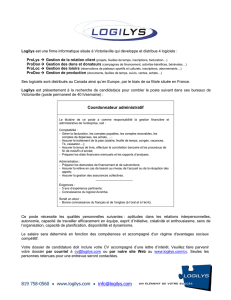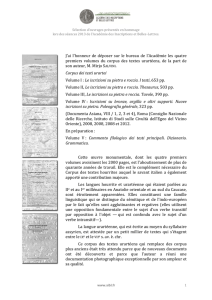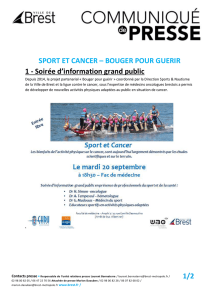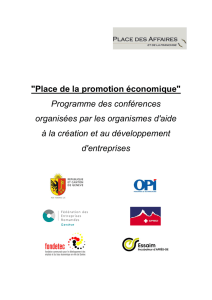L`éloquence des pierres. Usages littéraires de l`inscription au XVIIIe

Sélection d’ouvrages présentés en hommage
lors des séances 2015 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
www.aibl.fr 1
« J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de l’Académie de
la part de son auteur l’ouvrage de Sophie Lefay,
L’éloquence des pierres. Usages littéraires de l’inscription au
XVIIIe siècle, Classiques Garnier, 2015, 359 pages.
Ludovico Magno, abundantia parta, “À Louis le Grand,
l’abondance est partie” : c’est en citant ce contre-sens riche
de sens que les modernes du siècle des Lumières prônent
l’exclusion du latin, réputé illisible, dans le domaine des
inscriptions. Pourtant, et malgré le précédent éclatant de la
Galerie des Glaces, le débat sur la langue n’est pas clos, il se
poursuivra jusqu’à la veille de la Révolution, puisque se
rejoue autour des années 1770-80, avec les mêmes
arguments, opposant Diderot à Voltaire, la querelle
engagée quelque cent ans plus tôt entre l’abbé Lucas et
François Charpentier. Il faudra la Convention, le rapport
enflammé de l’abbé Grégoire et le décret du 24 nivôse de
l’an II, “nouvel édit de Villers-Cotterêts”, pour que la question paraisse, un moment,
presque réglée.
L’autre débat, de la simplicité contre l’enflure, est grevé par les déclarations contre le
style réputé bombastique des inscriptions monarchiques : on cite avec indignation,
comme si justement elles n’avaient pas été écartées, les inscriptions refusées par
Louis XIV et l’on veut ignorer que l’épigraphie de la gloire, telle que la définissent en
France un Boileau ou un Pellisson, se définit, contre la démesure italienne, par une
exigence de sobriété. Le préjugé n’empêche pas le développement d’une rhétorique
républicaine, bavarde et lourdement pédagogique, utilisant tous les supports, y compris
les noms des rues, pour inculquer systématiquement et partout les valeurs de la société
régénérée.
Même si est ainsi assuré (par antipéristase) le lien avec l’âge précédent, à qui l’on doit la
création en 1701 de l’Académie du même nom, l’inscription officielle n’est ni le vrai sujet
ni l’intérêt principal du livre ; l’enquête s’élargit à son utilisation par les individus : les
graffitis énigmatiques dont Restif de la Bretonne orne les quais de l’île Saint-Louis (un
système d’abréviations latines qui n’ont de sens que pour lui), le langage des murs et des
cachots de la Bastille, les inscriptions versifiées des parcs et des jardins, comme celui de
Beaumarchais ou le tombeau de Rousseau à Ermenonville, les épitaphes parodiques,
enfin, comme l’indique le sous-titre, la part de la fiction et de l’imaginaire : les
inscriptions en peinture, ou qui ornent la scène ou inondent la littérature romanesque :
les vers du Tasse et le chiffre de Julie tracés par Saint-Preux sur le rocher, ou ces “voix
qui sortent de la pierre” dans Paul et Virginie, dans les élégies de Parny, dans Corinne, et
dans cent autres, connus, Vivan Denon, Madame de Genlis, et moins connus…, sans
parler de messages plus privés encore, gravés sur une chaussure de femme ou avec un
diamant sur une vitre par une amante de Casanova, tous mêlant enjeux poétiques et
philosophiques et enjeux de la sensibilité.
Inspirée par Michel Delon, c’est la partie la plus neuve et la plus attachante de cet
ouvrage foisonnant. J’emploie ce mot à dessein, pour caractériser un mode de
composition (quatre chapitres : Signifier, Accomplir, Éterniser, Imprimer) qui, sans en

Sélection d’ouvrages présentés en hommage
lors des séances 2015 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
www.aibl.fr 2
épuiser aucune, mêle les sources à la manière d’un essai plus que d’une étude historique.
Mais c’est un choix assumé, comme celui qui limite l’enquête aux frontières de notre
pays.
Quelques regrets : une fausse élégance, l’adoption répétée du mot “épigraphe” pour
inscription, le mot en ce sens est usité à l’époque, ambigu aujourd’hui, bien que la
dernière livraison du Dictionnaire de l’Académie semble réhabiliter une acception qui
avait vieilli ; une tendance à minimiser la dette contractée à l’égard du siècle précédent :
par exemple le livre-monument de Sylvain Maréchal, Histoire universelle en style
lapidaire, est bel et bien le descendant direct d’un type d’ouvrage inventé et illustré, en
latin il est vrai et par les jésuites italiens, Tesauro, Mascolo, Alberti, Boldoni, Giuglaris,
mais aussi représenté en France par Pierre Labbé ; plus grave est la thèse qu’il aura fallu
attendre le XVIIIe siècle pour voir (je cite), “à la faveur du basculement de la philologie
vers l’archéologie, apparaître une épigraphie sortie du cadre strict de l’érudition
livresque”. Pour finir comme j’ai commencé, je dédie à mes confrères latinistes cette
curieuse lecture d’une inscription gravée en l’honneur de Voltaire : Voltario, saeculi sui
miraculo, aere eruditorum conlato, “À Voltaire, miracle de son siècle, traduit en bronze
par les gens de lettres”.
Pierre LAURENS
Le 23 octobre 2015
L’éloquence des pierres.
Usages littéraires de l’inscription au XVIIIe siècle
Classiques Garnier
1
/
2
100%