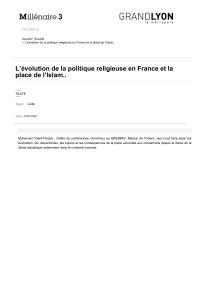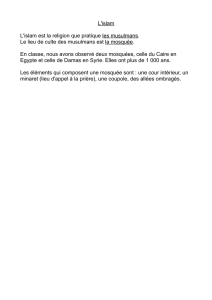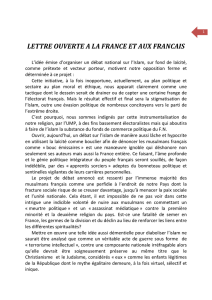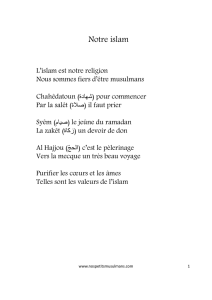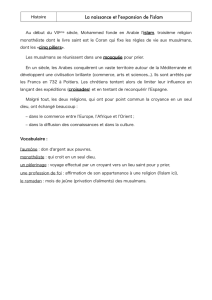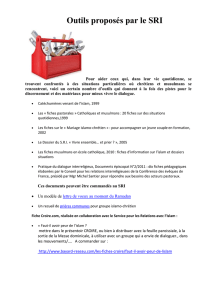Il est minuit, la France s`éveille

Il est minuit, la France s’éveilleIl est minuit, la France s’éveille
« Hollande. Son plan pour contrer le FN. » Au lendemain de
la nuit meurtrière du 13 novembre, la une de Society,
encore placardée au dos de nombreux kiosques parisiens,
claque comme une accusation. Tout comme la manchette du
Monde, datée du 12 novembre : « Le plan de Matignon contre
le FN. » Lutter contre la menace frontiste, voilà donc ce
qui, à la veille de la tuerie, préoccupait nos dirigeants
– et les grandes consciences de leur presse. Pendant que
nos ennemis se préparaient militairement à accomplir leurs
crimes, l’Élysée et Matignon se tiraient la bourre pour savoir qui serait
« le meilleur rempart contre le Front national » – et qui, accessoirement,
exploiterait le mieux ce terrible danger pour faire avancer ses propres
actions électorales. Pendant que la fascination du djihad se répandait dans
une fraction de la jeunesse de quartiers islamo-salafisés, une bonne partie
de la corporation médiatique s’employait à dresser des listes de salauds qui
« font le jeu du Front national ». Il faut croire qu’il était plus gratifiant

– et moins fatigant – de fantasmer le retour de la bête immonde que de se
prendre la tête avec l’islam radical.
Alors que les familles endeuillées, et avec elles tout le pays, pleurent
leurs morts, ces rodomontades résistantes, ces postures pseudo-héroïques
semblent rescapées d’un autre temps. Le samedi 14 novembre, Paris était
désert, sauf quelques endroits où on se pressait pour être triste et avoir
peur ensemble, et dans cette atmosphère de « jour d’après », on se disait
que, cette fois, on avait vraiment changé de monde. Quelques jours plus tard,
on est moins sûr. D’après le Monde du 22 novembre, nous sommes entrés dans
« La France d’après ». Mais après tout, pourquoi cette fois ? Pourquoi pas
après Merah ? Pourquoi pas après Charlie et l’Hyper Casher ? Avons-nous
changé de monde après Tati, après le RER Saint-Michel, après le Drakkar de
Beyrouth ?
D’abord, pourquoi le nier, on s’habitue. On n’est pas moins horrifié, on est
moins surpris. Du reste, le retour aux affaires courantes est de plus en plus
rapide. Après le 13 novembre, il ne nous a fallu que quelques jours pour
recommencer à parler d’autre chose – et à acheter des chaussures. On a fait
de la poésie après Auschwitz, on fera les soldes après le Bataclan.
Et pourtant, peut-être que, cette fois, tout ne redeviendra pas comme avant.
En tout cas pas aussi vite que d’habitude. D’abord, on l’a abondamment
répété, « maintenant, tout le monde se sent visé » – même les « Français
innocents », comme l’a remarqué l’ami Guillaume Erner, non sans acidité, en
référence à la bourde de Raymond Barre après l’attentat de la rue Copernic1.
Désormais, nous disent nos ennemis, nous tuerons des dessinateurs, des juifs
et des bobos. Pourquoi des bobos ? C’est ainsi, plus besoin de dessiner
Mahomet ou d’être juif pour susciter la haine du djihadiste – ce qui signifie
a contrario qu’il ne sert à rien d’être accommodant, à moins que ces
accommodements aillent jusqu’au renoncement à fréquenter les bistrots.
Ensuite, il est devenu impossible d’ignorer que le terrorisme islamiste, chez
nous, n’est pas un phénomène importé mais une production locale. Quel que
soit le rôle de Daech comme camp d’entraînement, comme sponsor et comme Terre
promise rêvée, c’est dans nos villes et, de plus en plus, dans nos campagnes,
que se recrutent les assassins. On se rappelle la stupeur d’Israël, après
l’assassinat d’Yitzhak Rabin, il y a vingt ans, parce qu’« un Juif avait tué
un Juif ». Nous devons nous y faire : ce sont, pour l’essentiel, des Français
qui tuent des Français. Nous avons des ennemis lointains et d’autres de
l’intérieur.
Si quelque chose a changé pour de bon, c’est que, grâce notamment à la
conjonction de ces deux éléments, la France d’après est un peu plus la France
que celle d’avant. Si beaucoup de gens, y compris à gauche, ont retrouvé le
goût du tricolore et de la Marseillaise, suscitant d’homériques affrontements
sur Facebook, ce n’est pas parce qu’ils sont au garde-à-vous, prêts à défiler
au son du canon, mais parce que, en nous sommant de défendre ce que nous
avons en commun, les tueurs refont de nous un peuple. Certains trouveront
qu’il manque parfois de panache, ce peuple. « Nous sommes les enfants de
Descartes et de Voltaire », écrit Brice Couturier dans la magnifique adresse
aux djihadistes que nous publions dans les pages qui suivent. Certes. Mais

les terroristes n’ont pas attaqué une librairie (on se demande bien
pourquoi…). Et nous sommes aussi les enfants du rock et de l’oisiveté, de
l’alcool et de la télé, du porno et du mariage gay (oui, oui… ils finiront
par me convertir…).
Si c’est aux terrasses des cafés qu’est aujourd’hui réfugiée la civilité
française, défendons les terrasses par les armes ! Si on menace notre liberté
de nous abrutir en boîte de nuit, sauvons les boîtes de nuit ! S’ils
détestent le sexe, le stupre sera notre langue et notre sol ! En somme, quand
les djihadistes s’attaquent à ce que nos existences ont de frivole et même de
vain, nous redécouvrons, à travers leur regard hébété, à quel point ces
frivolités et ces vanités nous sont chères. Pierre Manent propose de passer
un compromis avec les musulmans sur les mœurs. Au contraire, c’est le moment
de proclamer qu’elles ne sont pas négociables. Vous n’êtes pas obligés d’en
profiter (la minijupe n’est pas une obligation, tout de même…), mais vous
êtes obligés de laisser vos sœurs et vos filles s’y adonner si ça leur
chante. Ah, ils s’en prennent au ventre mou de notre civilisation ? Ils
apprendront vite que ce ventre mou est dur à cuire et verront de quel bois se
chauffe l’Occidental avachi.
Tout de même…, on dirait que cette fois, nous avons compris. Après Charlie et
les grandes envolées sur l’esprit du 11 janvier qui devait continuer de
souffler, nous avons été priés de nous battre la coulpe pour les crimes des
Kouachi et Coulibaly, rapport à l’apartheid que nous leur avions fait subir.
Et on nous a expliqué sur tous les tons que tout ça n’avait rien à voir avec
l’islam et que le problème numéro un de la France, c’était l’islamophobie.
Rien de tel aujourd’hui. Le président en fait même un peu trop dans le
tricolore quand il nous demande de pavoiser nos fenêtres. Perso, je
préférerais que l’idée vienne de moi. Et puis il ne faudrait pas que cette
orgie de symbole finisse par tenir lieu de politique. Bon, en haut lieu,
malgré la difficulté qu’a eue le président, dans les premiers jours, à
prononcer le mot « islamiste », on semble mesurer l’ampleur de la menace
intérieure et déterminé à se donner les moyens de la combattre. Délivrés de
certaines complications procédurales par l’état d’urgence, les policiers se
félicitent d’avoir, pour la première fois depuis janvier dernier, les coudées
franches pour taper dans les fourmilières islamistes. Et si à la gauche de la
gauche, on communie dans la dénonciation du « tournant sécuritaire » de
Hollande, la France des bistrots, elle, redoute plutôt qu’il soit sans
lendemain. Partagée entre le soulagement de voir ses gouvernants agir et
l’envie de leur demander des comptes – Qu’avez-vous fait pendant dix mois ?
–, cette France-là ne croit pas que ses libertés soient menacées et se
préoccupe assez peu des menaces pesant sur celles des salafistes et
assimilés. L’humeur du moment, un brin excessive, serait plutôt : « Coffrez-
les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! » Cependant, et quoi que feignent de
croire Olivier Besancenot et quelques autres, nul ne propose d’abolir l’état
de droit et les libertés publiques en France.
Il faut noter que même Laurent Joffrin, le patron de Libération,
habituellement pourfendeur inlassable de l’islamophobie, découvre qu’il y a
une parenté entre l’arbre et la forêt et que le danger ne tient pas seulement
à quelques dizaines de fanatiques prêts à passer à l’acte qui n’auraient

« rien à voir » avec la religion d’amour et de tolérance que l’on sait :
« Tous les salafistes, loin de là, ne sont pas terroristes, écrit-il dans son
édito du 24 novembre. Mais la plupart des terroristes identifiés à ce jour
sont passés par le salafisme. La plupart des musulmans ne sont pas
salafistes. Mais les salafistes sont une branche extrême, fondamentaliste, de
l’islam. » Cette petite musique, nouvelle sous cette plume, est peut-être la
preuve que l’ère du déni est en train de prendre fin.
Dans ce contexte, le « Pas d’amalgame » n’est plus très tendance. Non pas,
évidemment, qu’il soit devenu légitime de faire des amalgames – entre ceux
qui aiment leur pays et ceux qui le haïssent. Au contraire, l’actualité
invite aux éclaircissements. La France n’a pas un problème avec l’islam mais
avec certaines de ses expressions, incompatibles avec les mœurs françaises,
présentes notamment dans « l’islam des cités ». Et le risque d’amalgame est
d’autant plus faible que nombre de voix musulmanes, institutionnelles ou
individuelles, reconnaissent aujourd’hui que ces expressions existent et
qu’il faut les combattre. Pour un type qui fera sauter – ou pas – sa ceinture
d’explosifs, combien d’admirateurs qui se contentent de maudire les juifs, la
France et l’Occident ? La parole de notables de l’islam officiel, inaudible
pour une grande partie de la jeunesse musulmane, est franchement dévaluée. Au
moins, pour la première fois, reconnaissent-ils la gravité de la situation et
leur responsabilité dans celle-ci.
Mais le plus encourageant, c’est que les tueurs aient, à l’inverse de ce
qu’ils voulaient, provoqué un réflexe patriotique chez nombre de Français
musulmans qui, anonymes ou célèbres, sont sortis du silence. Comme ce gars
énervé qui s’est filmé dans sa voiture expliquant « C’est à nous de faire le
boulot et de repérer ces bâtards ! » Comme l’économiste Hakim El Karoui qui,
pour la première fois sans doute, parle « en tant que », dans une tribune
parue dans Le Monde. « Les Français musulmans ne peuvent plus se contenter
d’adopter une posture victimaire. Il faut combattre les idées salafistes »,
écrit cet ancien conseiller de Jean-Pierre Raffarin qui, il y a quelques
années, a signé un livre avec Emmanuel Todd. On aimerait citer in extenso ce
texte tonique et autocritique : « Nous [Français de confession musulmane]
n’avons pas réussi à nous organiser par nous-mêmes. […] Nous avons laissé des
États étrangers financer le culte musulman. […] Nous nous sommes cachés
derrière des discours lénifiants et sympathiques (“l’islam est une religion
de paix”, “l’islam est l’ennemi de la violence”), incontestablement vrais,
mais qui oublient que l’islam, c’est aussi ce qu’en font les musulmans. Et,
notamment, les musulmans qui font le plus de bruit. […] Nous avons laissé le
poison de la salafisation des esprits se répandre. Aujourd’hui, nous sommes
face à nos responsabilités. Et notamment ceux qui ont fait les meilleures
écoles, suivi les plus beaux parcours, cru dans l’idée que la religion
n’était qu’une affaire privée dans une République laïque. Eh bien non, c’est
aussi une question publique. Malheureusement. Et c’est à notre génération,
née en France, élevée et éduquée par l’école de la République, de prendre les
choses en main. » On espérait de telles voix depuis longtemps.
En attendant, qu’on se rassure, si François Hollande caressait des rêves de
dictature, il doit être déçu. L’union nationale est encore facultative – et
c’est heureux. Certes, nul n’a revendiqué publiquement le droit de ne pas

être Paris puisque, cette fois, tout le monde – ou presque – « pouvait
s’identifier ». Mais après quelques jours de sidération compréhensible, la
divergence a repris ses droits et le parti de l’Autre – partiellement
reconverti en camp de la paix – est de nouveau en ordre de bataille. Et il
entonne de nouveau la chanson de la France coupable – à l’intérieur comme à
l’extérieur.
Ce néopacifisme, qui se diffuse dans une partie de la jeunesse avec le mot
d’ordre « Leur guerre, nos morts », ne manque pas de partisans dans le monde
intellectuel. Gageons, avec un peu d’ironie, qu’il ne tardera pas à
rassembler le FN et l’extrême gauche – encore que, maintenant que Poutine est
dans le coup, le Front mettra peut-être un peu de vodka dans son vin
isolationniste.
Attention, que l’engagement de la France en Syrie suscite un débat et même
une franche contestation, rien n’est plus légitime. On a le droit de
regretter que Michel Onfray, que l’on a connu moins jobard, avale la
propagande de l’EI et finisse presque par donner raison à ceux qui nous
attaquent – qui ne feraient, selon lui, que répondre à nos agressions –en
utilisant, en prime, le terme « islamophobe » pour qualifier notre
diplomatie.
Quoi qu’il en soit, on peut comprendre que beaucoup, échaudés par les
conséquences désastreuses des précédents irakiens, libyens, syriens,
redoutent une dérive bushiste, même si, avec quelques dizaines d’avions et
des frappes qui restent d’assez basse intensité, on est assez loin de
l’opération Tempête du Désert. Du reste, si, à l’évidence, les Occidentaux
n’ont rien arrangé nulle part, il faut un tropisme finalement très
néoconservateur pour penser que tout le mal vient d’eux. Croit-on vraiment
que, si la France n’était pas intervenue en Libye, la situation y serait plus
stable ? Et sait-on ce que serait devenu le régime de Saddam Hussein si les
Américains ne s’en étaient pas mêlés ? En réalité, les États faillis,
corrompus, illégitimes, violents ont contribué au moins autant que les
interventions occidentales à faire de cette région un marigot djihadiste.
C’est sans surprise sur le front intérieur que le parti de la repentance
donne sa pleine mesure, en mobilisant la rhétorique excusiste que l’on
connaît. On a du mal à croire qu’Emmanuel Macron ait délibérément choisi ce
terrain mouvant pour donner des gages à la gauche du PS ou à ce qu’il en
reste. Convoquant le terreau sur lequel prospère le djihadisme, le ministre
de l’Economie estime que la société française a sa part de responsabilité
parce que les discriminations, les inégalités, le chômage et toutes nos
turpitudes. Bref, il ne parle pas d’apartheid mais presque. Dans les
bataillons de la sociologie « radicale », c’est le ravissement. Et quand
Olivier Roy, qui annonce la fin de l’islam politique depuis une vingtaine
d’années, leur offre la formule magique qui blanchit l’islam de tout soupçon,
c’est l’extase. « Ce n’est pas l’islam qui s’est radicalisé, c’est la
radicalité qui s’est islamisée », écrit-il – et il embobine tout le monde
avec ce tour de normalien.
Un instant sonnée, l’extrême gauche universitaire reforme les rangs, et
quelques-uns de ses représentants éminents signent une tribune hilarante – ou
 6
6
1
/
6
100%