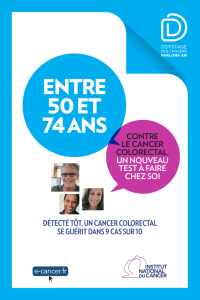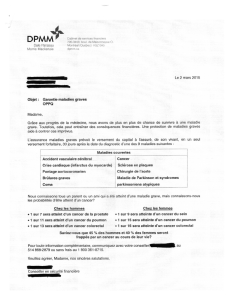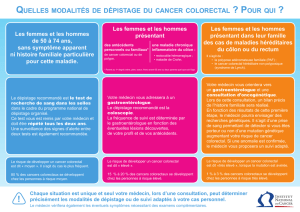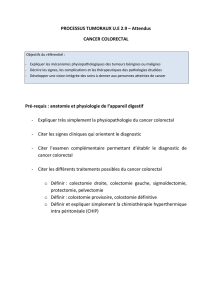LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

INTRODUCTION
Le cancer colorectal est une maladie fréquente et grave : en
France, plus de 37.000 nouveaux cas en 2005 et 17.000 décès
en 2003 [1]. Au Maroc, il n’existe pas actuellement de
programme de dépistage du cancer colorectal à large échelle
étant donné la relative faible prévalence de ce cancer par
rapport à d’autres cancers notamment le cancer du sein, du
col de l’utérus et du poumon qui constituent des priorités de
la santé publique.
Mais le cancer colorectal au Maroc mérite de faire l’objet
d’une réflexion de la part des professionnels de santé, car son
épidémiologie est en augmentation dans notre contexte du
fait du changement d’un certain nombre de facteurs
environnementaux, notamment du mode alimentaire. Ce cancer
pourrait constituer à moyen ou à long terme un problème de
santé publique. Selon les registres régionaux récemment
établis : 1) de Casablanca en 2004 : l’incidence du cancer
colorectal est de 5,3 nouveaux cas/100.000 habitants [2], et
2) de Rabat en 2005 : l’incidence du cancer du côlon est de
2,5 nouveaux cas/100.000 habitants et celle du rectum est de
3,3 nouveaux cas/100.000 habitants [3]. Ainsi au Maroc, le
cancer colorectal représente la troisième cause de mortalité
après les cancers du sein et du poumon [4].
Malgré des progrès importants dans sa prise en charge, la
guérison n’est obtenue que dans un cas sur deux [5, 6]. Pendant
longtemps, l’objectif a été un diagnostic précoce dès
l’apparition des premiers symptômes. Les études
épidémiologiques ont permis d’identifier des sujets à risque
élevé ou très élevé qui relèvent d’une stratégie de dépistage
individuel. Le problème est que moins d’un quart des cancers
colorectaux survient dans ce contexte [7]. Pour être efficace,
une politique de dépistage doit aussi concerner la population
à risque moyen.
GROUPES A RISQUE
Une meilleure connaissance de l’épidémiologie du cancer
colorectal permet non seulement de dégager des hypothèses
quant à l’identification des facteurs étiologiques, mais aussi
de reconnaître dans la population générale des groupes
présentant des niveaux de risques différents autorisant des
stratégies de prévention primaire ou secondaire adéquates.
Revue Marocaine du Cancer 2010 ; 4 : 7-12
7
LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
S. NADIR, H. SAATI, A. CHERKAOUI
Service d’Hépato-Gastro-Entérologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Mise au Point
RESUME
Plusieurs études contrôlées indiquent que la réduction de la mortalité
par cancer colorectal est possible grâce au dépistage.
L’identification des sujets à risque très élevé (forme héréditaire) et
des sujets à haut risque a été réalisée par des études épidémiologiques.
Ainsi, la coloscopie de dépistage est recommandée chez les apparentés
au premier degré de sujets atteints d’un cancer colorectal ou d’un
adénome de plus de 1 cm de diamètre diagnostiqué avant 60 ans ou
65 ans, ou ayant au moins deux parents atteints, chez les sujets
atteint d’une colite inflammatoire étendue ou ayant un antécédent
personnel de cancer ou d’adénome.
Chez les sujets à risque moyen, le dépistage est réalisé par un test
de recherche d’un saignement occulte dans les selles.
D’autres méthodes de dépistage représentent une perspective d’avenir
tels que les tests immunologiques, la détection de l’ADN altéré dans
les selles et l’approche protéomique.
Mots clés : cancer colorectal, dépistage
Correspondance : Pr. S. NADIR.
Service d’Hépato-Gastro-
Entérologie, CHU Ibn Rochd,
Casablanca, Maroc. E-mail :
ABSTRACT
COLORECTAL CANCER SCREENING
Several controlled studies indicate that the reduction in mortality
from colorectal cancer through screening is possible.
The identification of subjects at high risk (hereditary) and a high-
risk subject was carried out by epidemiological studies. The
colonoscopy screening is recommended in first degree relatives of
patients with colorectal cancer or adenomas larger than 1 cm in
diameter diagnosed before age 60 or 65, or having at least two
affected relatives, in subjects suffering from extent inflammatory
bowel disease, or with a history of cancer or adenoma.
In patients at average risk, screening is done by a test for occult
blood in the stool.
Other screening methods represent a forward-looking such as
immunoassays, detection of altered DNA in stool and proteomics
approach.
Key words : colorectal cancer, screening

• Groupe à risque moyen
Ce groupe concerne des personnes asymptomatiques de 50
ans et plus, chez qui surviennent la plupart des cancers
colorectaux, le risque est estimé à 3,5%.
• Groupe à risque élevé
Dans cette catégorie, on retrouve les sujets ayant :
-Des antécédents personnels d’adénome de plus de 1 cm ou
de cancer colorectal. Le risque dans ce cas varie de 2,2 à
6,6%.
-Des antécédents familiaux (parents de premier degré) de
cancer colorectal ou d’adénome de plus de 1 cm. Le risque
varie de 6 à 10%.
-Une maladie inflammatoire chronique de l’intestin : maladie
de Crohn ou rectocolite hémorragique.
• Groupe à risque très élevé
Ce groupe correspond aux sujets ayant des antécédents de
polypose adénomateuse familiale ou de syndrome de cancer
colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC) dit syndrome
de Lynch.
DEPISTAGE DANS LES GROUPES A RISQUE
TRES ELEVE
Les sujets du groupe à risque très élevé sont atteints de
maladies à transmission héréditaire, soit autosomale dominante
à forte pénétrance : polypose adénomateuse familiale (PAF),
HNPCC, soit récessive (polypose liée au gène MYH).
• Polypose adénomateuse familiale (PAF)
Cette maladie est caractérisée par le développement de plusieurs
dizaines ou centaines d’adénomes, tapissant toute la lumière
intestinale. Les progrès de la génétique moléculaire permettent
de rechercher chez un sujet atteint, avec son consentement,
la mutation constitutionnelle délétère qui siège sur le bras
long du chromosome 5 (gène APC). Lorsque la mutation est
caractérisée, la surveillance endoscopique est restreinte aux
sujets porteurs de la mutation délétère [8]. Lorsque la mutation
n’est pas identifiée, la détection se fait par recto-sigmoïdoscopie
souple annuelle depuis l’âge de 15 à 20 ans selon le siège de
la mutation [9] jusqu’à l’âge de 40 ans où l’expressivité de
la maladie est de 100%. La présence d’une polypose diffuse
est une indication de colectomie.
• Polypose liée au gène MYH
La polypose liée à une mutation du gène MYH est de
connaissance plus récente. La particularité de cette
prédisposition est sa transmission récessive. C’est-à-dire que
les sujets atteints ont reçu un allèle muté de chacun de leurs
parents et qu’un quart des enfants seront atteints. II faut y
penser devant une polypose sans PAF dans la famille. Leurs
descendants ne seront pas atteints sauf si leur conjoint est
aussi porteur d’une mutation du gène MYH. Par prudence,
un test génétique peut être proposé aux enfants.
• Cancer colorectal héréditaire sans polypose
Selon les études réalisées au niveau de populations non
sélectionnées, 2 à 3% des cancers colorectaux surviennent
dans le cadre de syndrome “Hereditary Non Polyposis
Colorectal Cancer (HNPCC)” ou syndrome de Lynch
actuellement [10, 11]. Le syndrome est maintenant défini par
les critères d’Amsterdam II [12] :
-Au moins trois sujets atteints de cancers du spectre HNPCC
(côlon-rectum, endomètre, ovaire, grêle, uretère ou cavités
excrétrices) dont un uni aux autres au premier degré.
- Au moins deux générations successives concernées.
- Au moins un cancer diagnostiqué avant l’âge de 50 ans.
Le diagnostic génétique est possible dans ces familles. Les
mutations concernent le plus souvent les gènes hMLH1 et
hMSH2. L’immunohistochimie peut guider la recherche
génétique. Deux études bien conduites donnent un risque de
cancer colorectal à 70 ans, qui se situe entre 48% et 69% chez
l’homme, 33% et 52% chez la femme et le risque de cancer
de l’endomètre entre 14% et 54% [13, 14].
Chez les sujets atteints, une surveillance est proposée :
-Une coloscopie totale tous les deux ans dès l’âge de 25 ans
ou cinq ans avant l’âge au moment du diagnostic du cas le
plus précoce dans la famille.
-Un examen gynécologique annuel dès l’âge de 30 ans avec
échographie endovaginale et frottis aspiratif.
-La surveillance des autres cancers digestifs ou des voies
urinaires ne fait pas l’objet d’un consensus du fait de leur
moindre fréquence.
DEPISTAGE DANS LES GROUPES A RISQUE
ELEVE
• Parents au premier degré de sujets atteints d’un cancer
colorectal
Les sujets ayant un ou plusieurs parents au premier degré
(père, mère, frères, sœurs, enfants) atteints d’un cancer
colorectal ont un risque d’être atteint de ce cancer plus élevé
que la population générale. Cet antécédent est trouvé chez 15
à 20% des sujets atteints de cancer colorectal et chez 7 à 10%
des témoins [15].
Une méta-analyse ayant inclus 47 études a évalué le risque
de cancer colorectal à 2,25 (intervalle de confiance : 2,06-
2,43) chez les apparentés au degré de cas index. Une étude
française a suggéré que la prévalence des sujets ayant au
moins deux parents atteints était faible, de l’ordre de 0,1%
[16], permettant d’estimer que malgré le risque élevé, seulement
environ 500 cas surviennent annuellement en France dans ce
contexte. II n’y a pas d’étude ayant évalué l’efficacité de
8
Le dépistage du cancer colorectal S. NADIR et coll.

différentes stratégies de dépistage dans cette population à
risque élevé.
Les recommandations actuelles proviennent de consensus
d’experts. Lors de la conférence de consensus sur le cancer
colorectal, une coloscopie de dépistage était recommandée
chez tout apparenté au premier degré d’un sujet atteint d’un
cancer colorectal avant 60 ans (ou 65 ans selon le cahier des
charges du dépistage prenant en compte les données récentes
de la littérature) ou si deux parents au premier degré sont
atteints quel que soit l’âge du diagnostic [8]. Dans ces
populations, le risque d’être atteint d’un cancer colorectal
avant 75 ans dépasse 10% (il est de près de 4% dans la
population générale). La coloscopie est proposée à partir de
45 ans ou cinq ans avant l’âge au diagnostic du cas index.
Après une coloscopie normale, une surveillance tous les cinq
ans jusqu’à 75 ans est suffisante. Après une ou plusieurs
coloscopies normales, le risque d’être atteint d’un cancer est
extrêmement faible. Le jury de la conférence de consensus a
considéré que si le cas index avait plus de 60 ans, les données
disponibles ne permettaient pas de savoir quelle stratégie doit
être recommandée [8].
• Apparentés au premier degré de sujets atteints
d’adénomes
Le risque de cancer colorectal chez les apparentés de sujets
ayant des adénomes a été moins évalué que celui des apparentés
atteints d’un cancer colorectal.
En 2001, une méta-analyse de neuf études a estimé le risque
relatif à 1,99 [17]. Malheureusement, la taille des adénomes
n'était pas prise en compte.
Selon les propositions de l’Anaes, une coloscopie est
recommandée comme moyen de dépistage chez les sujets
ayant des antécédents familiaux d’adénome de plus de 1 cm
diagnostiqués avant 60 ans [18].
• Antécédents personnels de cancer colorectal
Les sujets traités pour un cancer colorectal constituent
également un groupe à risque élevé de cancer colorectal
métachrome. Comme l’indiquent plusieurs études, le risque
était multiplié par deux dans le Connecticut [19], par trois en
Suède [20] et par 1,5 (intervalle de confiance : 1,32-1,72) en
Bourgogne [21]. Le risque un peu plus élevé dans le
Connecticut et en Suède qu’en Bourgogne peut s’expliquer
par le fait que ces études ont inclus des cas suivis jusqu'en
1985, c’est-à-dire sur une période où le suivi endoscopique
était moins développé que maintenant. L’étude bourguignonne
confirme que le risque persiste au cours de la vie, justifiant
une surveillance endoscopique au long cours [21]. Le risque
cumulé de développer un cancer colorectal était de 1,8% à
cinq ans, 3,4% à dix ans et 7,2% à 20 ans [19]. Ces données
épidémiologiques sont à l’origine des recommandations de
surveillance [8]. Elles comprennent une coloscopie péri-
opératoire après chirurgie à visée curative pour exclure un
cancer synchrone ou adénome synchrone si la coloscopie
préopératoire n’a pas été complète ou de bonne qualité. Une
coloscopie est ensuite recommandée à trois ans, puis tous les
cinq ans jusqu’a 75 ans.
• Maladie inflammatoire de l’intestin
Le risque de cancer colorectal dans la rectocolite hémorragique
et dans la maladie de Crohn est bien établi. Dans une cohorte
suédoise de rectocolite ulcérohémorragique portant sur une
population générale, donc sans biais de recrutement, le risque
de cancer colorectal par rapport à la population générale était
multiplié par 14,8 en cas de pancolite, 2,8 en cas de colite
limitée au côlon gauche et n’était pas augmenté de manière
significative en cas de proctite [22]. Un âge très jeune au
diagnostic augmente aussi le risque. Pour un diagnostic de
rectocolite hémorragique avant l’âge de 15 ans et une durée
d’évolution de 35 ans, le risque était de 40% [23].
Dans la maladie de Crohn avec atteinte colique, le risque est
comparable à celui de la rectocolite hémorragique. Il est
multiplié par 18 en cas de pancolite et par 57 si la pancolite
a été diagnostiquée avant 30 ans [24]. Les maladies
inflammatoires ne sont à l’origine que de moins de 1% des
cancers colorectaux. Cependant, chez ces individus, un
dépistage de cancer colorectal est nécessaire. La coloscopie
est conseillée tous les deux ans après 15 à 20 ans d’évolution
dans les pancolites diagnostiquées avant 40 ans, après cinq
dans les pancolites diagnostiquées après 40 ans [9]. La
coloscopie a pour objet de rechercher des lésions de dysplasie
en muqueuse plane et surtout sur des lésions avec relief. Il
est recommandé des biopsies étagées, orientées par la chromo-
endoscopie avec utilisation d’indigo carmin.
• Antécédents personnels d’adénome colorectal
Le risque de cancer colorectal est augmenté après exérèse
d’un adénome colorectal à risque de transformation maligne
(> 1 cm et/ou structure villeuse et/ou dysplasie grave). Dans
une cohorte de 1619 sujets suivis jusqu’à 30 ans après l’exérèse
d’un adénome rectal sans programme défini de surveillance,
le risque de cancer colorectal était multiplié par 3,6 (intervalle
de confiance : 2,4-5,0) chez les sujets atteints d’un adénome
de plus de 1 cm de diamètre ou avec une structure villeuse,
et par 6,6 (intervalle de confiance : 3,3-11,8) si ces adénomes
étaient multiples [25]. Le risque élevé de cancer colorectal
chez les sujets ayant un adénome à risque conduit à
recommander une surveillance endoscopique [8]. Des études
randomisées indiquent qu’une coloscopie de contrôle trois
ans après la polypectomie est suffisante [26].
DEPISTAGE DANS LA POPULATION GENERALE
La méthode de dépistage qui peut être proposée à 1’ensemble
de la population à risque moyen (sujets des deux sexes de
plus de 50 ans), en bonne santé, doit être simple, acceptable,
sans danger, peu coûteuse et d’efficacité démontrée. Les tests
de recherche d’un saignement occulte dans les selles
remplissent ces caractéristiques.
9
Revue Marocaine du Cancer 2010 ; 4 : 7-12

• La recherche d’un saignement occulte dans les selles : le
test Hemoccult*
La plupart des données disponibles proviennent de réévaluation
d’un test au guaiac. Le test Hemocult* est le seul test dont
l’efficacité a été prouvée. Quatre essais randomisés aux Etats-
Unis [27], en Grande-Bretagne [28], en Suède [29] et en
France [30] montrent que la réalisation tous les 1 à 2 ans d’un
Hemoccult* pendant 8 à 13 ans permet de réduire la mortalité
par cancer colorectal de 14 à 33%.
Le test Hemoccult* permet de détecter l’activité péroxydase
de l’hémoglobine. Deux petits fragments de selles (de la taille
d’une lentille) sont collectés sur trois selles consécutives. Un
tel test est facile à réaliser, sans grande gêne. Si une fenêtre
est positive, une coloscopie doit être faite. Le taux de positivité
du test Hemoccult*, analysé sans réhydratation, lors d’une
première campagne, se situe entre 2% et 3% [28, 31]. Le taux
de positivité est encore plus bas avec des recommandations
alimentaires : environ 1% [32], mais cela risque de diminuer
l’acceptabilité. Le taux de positivité est trop élevé, si le test
est réhydraté, entre 6 et 10% [27, 32].
En 2000, un avis consensuel sur le dépistage des cancers était
présenté par le Comité Consultatif des Experts Cancérologues
de la Communauté Européenne [33]. Il recommandait la mise
en route du dépistage du cancer colorectal par la recherche
d’un saignement occulte dans les selles. Les arguments
scientifiques et cette prise de position ont conduit à
l’introduction du dépistage du cancer colorectal dans le Code
Européen contre le Cancer et à un avis de la Commission
Européenne elle-même, reprenant les conclusions des travaux
des Experts Cancérologues émises en 2000 [34]. C’est le test
généralement recommandé du fait d’un coût faible et de
l’absence d’effets secondaires graves. Toutefois, sa mauvaise
sensibilité (< 40%) et sa spécificité médiocre (85 à 98% selon
la technique) en limitent l’intérêt. Par ailleurs, pour être
efficace, il est important qu’un grand nombre de la population
(> 50%) participe au dépistage.
PERSPECTIVES
• Les tests immunologiques
A court terme, un progrès devrait venir du remplacement des
tests au guaiac par les tests immunologiques, qui utilisent des
anticorps antihémoglobine humaine spécifiques. Les résultats
ont l’intérêt de ne pas dépendre de l’alimentation. Ces tests
sont quantitatifs et leur lecture automatisée devient non
opérateur dépendant. Ils ont l’inconvénient d’être plus coûteux
que les tests au guaiac. Les études menées dans des populations
non sélectionnées à risque moyen font apparaître que le test
immunologique est plus performant que le test au guaiac pour
la détection des cancers et des adénomes [35, 36]. Une vaste
étude japonaise [37] ayant inclus 21850 personnes ayant
réalisé un test immunologique sur une selle (5,7% de positif),
puis une coloscopie a montré une sensibilité de 66% pour le
cancer colorectal et 20% pour les adénomes supérieurs ou
égaux à 1 cm.
• Les recherches des altérations de I’ADN fécal
Les altérations génétiques des cancers colorectaux permettent
d’envisager la détection de l’ADN tumoral dans les selles.
Au moins trois types d’altérations génétiques sont impliqués
dans la carcinogenèse colorectale :
- L’instabilité chromosomique.
- L’instabilité génétique.
- L’hyperméthylation d’un gène ou de son promoteur.
La recherche d’anomalies de l’ADN dans les selles par les
techniques de biologie moléculaire est une technologie nouvelle
qui n’a pas encore sa place dans le dépistage du cancer
colorectal. Il y a encore des problèmes importants à résoudre.
II faut encore préciser les conditions de recueil et d’analyse
des selles compatibles avec une stratégie de population. Le
rythme sur lequel le test doit être répété n’est pas connu et
son coût actuel est prohibitif [38].
• Approche protéomique
Des études récentes, couvertes par le secret industriel, utilisant
l’approche protéomique, ont permis d’identifier dans les
cancers colorectaux des protéines candidates pour un test non
invasif de dépistage dans le sang ou les selles. Ces protéines
vont être évaluées en utilisant une biothèque disponible de
cancers et de témoins, de façon à identifier un nombre limité
de combinaison de protéines. La signature protéique sera
ensuite évaluée dans le sang et les selles dans le cadre du
dépistage organisé chez les sujets ayant un test de recherche
de saignement occulte dans les selles positif et devant avoir
une coloscopie. Ces travaux permettent d’espérer la mise au
point d’un nouveau test de dépistage du cancer colorectal
[39].
• L’endoscopie et le coloscanner
L’endoscopie est une possibilité de découvrir à un stade
asymptomatique les adénomes et les cancers au début. Son
efficacité théorique ne fait pas de doute. Mais on ne sait pas
si l’acceptabilité sera suffisante pour faire évoluer le problème
posé par le cancer colorectal. On attend les résultats des études
randomisées conduites en Angleterre [40], en Italie [41] et
aux Etats-Unis [42], évaluant l’effet d’une coloscopie courte,
unique, dans le groupe d’âge 50-64 ans, suivie d’une coloscopie
si l’on découvre un polype.
Les résultats des études concernant les performances du
coloscanner par rapport à la coloscopie sont divergents [39].
Cela est probablement lié à une maîtrise variable de la
technique. Les limites de son utilisation sont nombreuses :
disponibilité du scanner, coût, irradiation, absence de possibilité
de biopsie et de polypectomie devant conduire à réaliser une
coloscopie dans environ 40% des cas dans le cadre du dépistage.
La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie, la
Société Française de Radiologie et l’Institut National du
Cancer, ont dans un communiqué commun, précisé que le
coloscanner n’était pas indiqué dans le dépistage du cancer
colorectal.
10
S. NADIR et coll.Le dépistage du cancer colorectal

CONCLUSION
Il existe des preuves de l’intérêt de la coloscopie dans le
dépistage du cancer colorectal. Sa sensibilité et sa spécificité
pour l’identification des polypes et de leur grade histologique,
sa capacité à faire dans le même temps le traitement des
lésions précancéreuses, compensent les inconvénients liés
aux risques de complication, à l’inconfort et aux contraintes
de l’examen. D’autres méthodes pourraient devenir
intéressantes dans l’avenir, ce sont le diagnostic génétique,
les tests immunologiques et la recherche des altérations de
l’ADN fécal.
REFERENCES
1. Belot A, Grosclaude P, Bossard N, Jougla E, Benhamou E,
Delafosse P. Incidence et mortalité des cancers en France durant
la période 1980–2005. Rev Epidemiol Sante Publique 2008 ;
56 : 159-75.
2. Registre de Cancer de la région du Grand Casablanca 2004.
3. Registre de Cancer de Rabat 2005.
4. Izddine M. Les nouvelles thérapies mises à jour dans le traitement
des cancers digestifs. Science et Culture 2007.
5. Berrino F, De Angelis R, Sant M, Rosso S, Bielska-Lasota M,
Coebergh JW, Santaquilani M, EUROCARE Working group.
Survival for eight major cancers and all cancers combined for
European adults diagnosed in 1995-1999 : results of the
EUROCARE-4 study. Lancet Oncol 2007 ; 8 : 773-83.
6. Francim. La survie des patients atteints de cancers en France.
Paris : Springer Verlag, 2007.
7. Faivre J. Epidémiologie et prévention du cancer colorectal.
Paris : Springer Verlag, 2001.
8. Conférence Consensus. Prévéntion, dépistage et prise en charge
des cancers du côlon. Gastroenterol Clin Biol 1998 ; 22 : 205-
18.
9. Saurin JC. La polypose adénomateuse familiale atténuée : une
entité à connaître. Gastroenterol Clin Biol 2008 ; 32 : 158-65.
10. Hemminki K, Li X. Familial colorectal adenocarcinoma from
the Swedish Family-Cancer Database. Int J Cancer 2001 ; 94:
743-8.
11. Ponz de Leon M, Sassatelli R, Benatti P, Roncucci L. Identifica-
tion of hereditary nonpolyposis colorectal cancer in the general
population. The 6-year experience of a population-based regis-
try. Cancer 1993 ; 71 : 3493-501.
12. Vasen HF, Watson P, Mecklin JP, Lynch HT. New clinical criteria
for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC, Lynch
syndrome) proposed by the International Collaborative Group
on HNPCC. Gastroenterology 1999 ; 116 : 1453-6.
13. Alarcon F, Lasset C, Carayol J, Bonadona V, Perdry H, Desseigne
F, Alarcon F, Lasset C, Carayol J, Bonadona V, Perdry H,
Desseigne F, Wang Q, Bonaïti-Pellié C. Estimating cancer risk
in HNPCC by the GRL method. Eur J Hum Genet 2007 ; 15 :
831-6.
14. Hampel H, Stephens JA, Pukkala E, Sankila R, Aaltonen LA,
Mecklin JP, de la Chapelle A. Cancer risk in hereditary
nonpolyposis colorectal cancer syndrome : later age of onset.
Gastroenterology 2005 ; 129 : 415-21.
15. Butterworth AS, Higgins JP, Pharoah P. Relative and absolute
risk of colorectal cancer for individuals with a family history:
a meta-analysis. Eur J Cancer 2006 ; 42 : 216-27.
16. Eisinger F, Giordanella JP, Didetot R, Julian-Reynier C, Moatti
JP, Sobol H, Seitz JF. Pratiques de dépistage et antécédents
familiaux de cancers colorectaux. Une enquête en population
volontaire. Gastroenterol Clin Biol 1996 ; 20 : 627-32.
17. Johns LE, Houlston RS. A systematic review and meta-analysis
of familial colorectal cancer risk. Am J Gastroenterol 2001 ;
96 : 2992-3003.
18. Anaes. Recommandations professionnelles. Endoscopie digestive
basse. Indication en dehors de dépistage en population, 2004
(disponible sur :http:/www.has-sante.fr,consulté le 13/08/09).
19. Hoar SK, Wilson J, Blot WJ, McLaughlin JK, Winn DM, Kantor
AF. Second cancer following cancer of the digestive system in
Connecticut, 1935-1982. Natl Cancer inst Monogr 1985 ; 68:
49-82.
20. Enblad P, Adami HO, Glimelius B, Krusemo U, Pahlman L.
The risk of subsequent primary malignant diseases after cancers
of the colon and rectum. A nationwide cohort study. Cancer
1990 ; 65 : 2091-100.
21. Bouvier AM, Latournerie M, Jooste V, Lepage C, Cottet V,
Faivre J. The lifelong risk of metachronous colorectal cancer
justifies long-term colonoscopic follow-up. Eur J Cancer 2008;
44 : 522-7.
22. Ekbom A, Helmick C, Zack M, Adami HO. Ulcerative colitis
and colorectal cancer. A population-based study. N Engl J Med
1990 ; 323 : 1228-33.
23. Lennard-Jones JE, Melville DM, Morson BC, Ritchie JK,
Williams CB. Precancer and cancer in extensive ulcerative
colitis : findings among 401 patients over 22 years. Gut 1990;
31 : 800-6.
24. Gillen CD, Andrews HA, Prior P, Allan RN. Crohn’s disease
and colorectal cancer. Gut 1994 ; 35 : 651-5.
25. Atkin WS, Morson BC, Cuzick J. Long-term risk of colorectal
cancer after excision of rectosigmoid adenomas. N Engl J Med
1992 ; 326 : 658-62.
26. Winawer SJ, Zauber AG, O’Brien MJ, Ho MN, Gottlieb L,
Sternberg SS, Waye JD, Bond J, Schapiro M, Stewart ET.
Randomized comparison of surveillance intervals after
colonoscopic removal of newly diagnosed adenomatous polyps.
The National Polyp Study Workgroup. N Engl J Med 1993 ;
328 : 901-6.
27. Mandel JS, Bond JH, Church TR, Snover DC, Bradley GM,
Schuman LM, Ederer F. Reducing mortality from colorectal
cancer by screening for fecal occult-blood. Minnesota colon
cancer control study. N Engl J Med 1993 ; 328 : 1365- 71.
28. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH, Moss SM,
Amar SS, Balfour TW, James PD, Mangham CM. Randomised
controlled trial for faecal-occult-blood screening for colorectal
cancer. Lancet 1996 ; 348 : 1472-7.
29. Kronborg O, Fenger C, Olsen J, Jørgensen OD, Søndergaard
O. Randomised study of screening for colorectal cancer with
faecal-occult-blood test. Lancet 1996; 348 : 1467-71.
30. Faivre J, Tazi MA, Milan C. L’étude Bourguignonne d’évaluation
du dépistage de masse du cancer colorectal par la recherche
d’un saignement occulte dans les selles : résultat à 9 ans.
Gastroenterol Clin Biol 1999 ; 23 : A89.
11
Revue Marocaine du Cancer 2010 ; 4 : 7-12
 6
6
1
/
6
100%