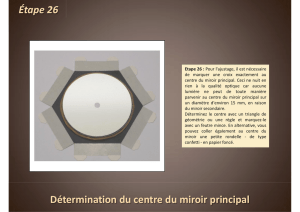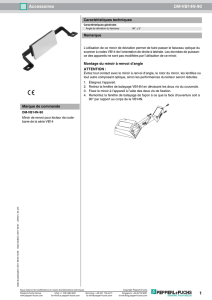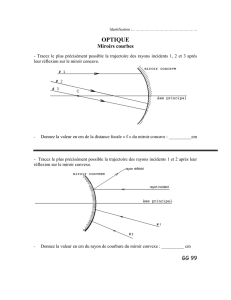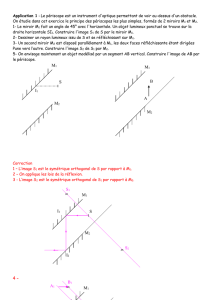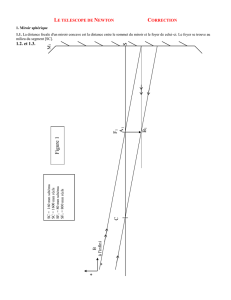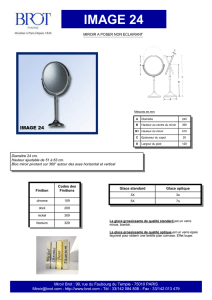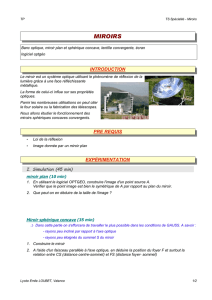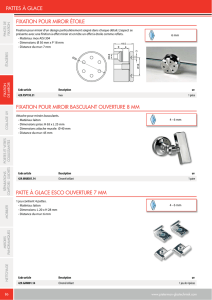Untitled - American Treibball Association


Miroir du ventpx:Maq 1 16/01/08 17:11 Page 1

Chez le même éditeur
Pour l’Éveil, Pierre Feuga
La Poignée de riz du Bouddha, Ariane Buisset
22 Cartes d’Asie, Georges Sédir
Gheranda Samhitâ, Jean Papin
La Couleur des Dieux, Stéphane Guillerme et Mathieu
Yoga, corps de vibration, corps de silence, Éric Baret
Le Psychiatre et la Voyante, Éliane Gauthier et Jean Sandretto
Le Seul Désir, Éric Baret
L’Impensable Réalité, Jean Bouchart d’Orval
La Voie du bambou, Yen Chan
Sakti-sûtra, Jean Papin
Dieux et déesses de l’Inde, Stéphane Guillerme
Caraka Samhitâ, Jean Papin
Le Sacre du dragon vert, Éric Baret
Journal d’un chaman – L’Ours des montagnes bleues, Mario Mercier
Journal d’un chaman – Les Voix de la mer, Mario Mercier
La Centurie de Goraksa, Tara Michaël
Les Doigts pointés vers la lune, Wei Wu Wei
Amour et connaissance, Alan Watts
Mandalas à contempler et à colorier, Christian Pilastre
Le Secret le mieux gardé, Jean Bouchart d’Orval
Être et ne pas être, Douglas Harding
Le Chemin des flammes, Pierre Feuga
© Éditions Almora, février 2008
51 rue Orfila, 75020 Paris
ISBN : 978-2-35118-021-1
Miroir du ventpx:Maq 1 16/01/08 17:11 Page 2

Le miroir
du vent
roman
Miroir du ventpx:Maq 1 16/01/08 17:11 Page 3

Du même auteur
Cent douze méditations tantriques, le « Vijñâna-Bhairava »,traduction du sanskrit
et commentaire, Accarias/L’Originel, 1988.
Cinq visages de la Déesse, Le Mail/Le Rocher, 1989.
Liber de Catulle, traduction du latin, Orphée/La Différence, 1989.
Les Trophées, José-Maria de Heredia, choix et présentation, Orphée/La Diffé-
rence, 1990.
Le bonheur est de ce monde, Accarias-L’Originel, 1990.
Satires de Juvénal, traduction du latin, Orphée/La Différence, 1992.
L’Art de la concentration, Albin Michel, coll. « Espaces libres », n° 32, 1992.
Tantrisme, Dangles, 1994.
Le Yoga (en collaboration avec Tara Michaël), PUF, coll. « Que sais-je ? »,
n° 643, 1998.
Comme un cercle de feu, traduction du sanskrit et commentaire de la Mândûkya-
upanishad et des Kârikâ de Gaudapâda, Accarias-L’Originel, 2004.
Pour l’Éveil, Almora, 2005.
Le Chemin des flammes, Almora, 2008.
Miroir du ventpx:Maq 1 16/01/08 17:11 Page 4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%