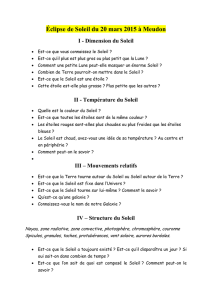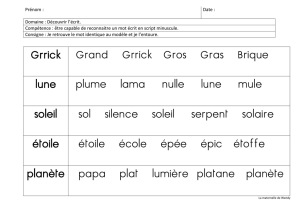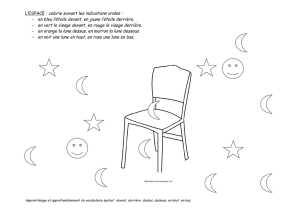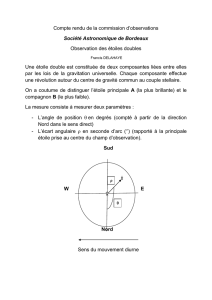Chapitre 3 : Phases de la lune et e clipses

21/41
UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux
I- L’éclipse de soleil
La lune se trouve entre le soleil et la terre.
Eclipse partielle dans la zone de pénombre.
Zone d’ombre (ombre portée) environ 20km
La lune est 400 fois moins large que le soleil, mais 400fois plus proche : d’où la possibilité
d’éclipse totale.
Le soleil est éclipsé.
La lune est un satellite de la terre, tournant avec une période de rotation de 29,5 jours en moyenne
(lunaison) et tournant sur elle-même de la même période ‘d’où sa face cachée).
La distance terre-lune est de 360 000km à 400 000km.
La lune est 100x plus légère que la terre, a un rayon 3,5x moindre.
II- Les phases de la lune
La lunaison comprend 4 phases principales d’environ 7,5 jours chacune. Les 8 phases de la lune :

22/41
UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux
III- Les éclipses de lune
Les éclipses de lune: la lune se trouve de l’autre côté de la terre, dans le cône d’ombre de la terre.
La lune est invisible (en fait orangée).

23/41
UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux
I- L’univers
1 a.l. = 1 année lumière = 300 000km x 3600 x 24 x 365,3 – 10 millions de millions de km
Distance parcourue par la lumière dans le vide en une année.
On cherche à convertir une année lumière en kilomètre :
v = c = 300 000km/s => vitesse de la lumière
t = temps parcouru, 1 an
d = distance parcourue par la lumière en 1 an
D’où d = c x t
t = 1 an = 365,3 jours x 24h x 3600sec
d = 300 000 x 365,3 x 24 x 3600 = 10.106.106 km
L’univers : un ensemble de plusieurs milliards de galaxies larges de plusieurs 100 000 a.l. s’éloignant les
unes des autres.
Son âge : ~13,5 milliards d’années.

24/41
UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux
II- Notre galaxie: la voie lactée
1
a.l.
= année lumière = 300 000 km x 3600 x 24 x 365,4 ~ 10 millions de millions km
Il y a ~200 milliards d’étoiles.
Le soleil est une étoile parmi d’autres.
Il est situé dans le bras d’Orion, à 26 000 a.l. du centre.
L’étoile la plus proche est à plus de 4 a.l. du soleil.
Une étoile est un astre au sein duquel se déroulent des réactions nucléaires dégageant un intense
rayonnement lumineux.
Une planète est un astre n’émettant pas sa propre lumière et gravitant autour d’une étoile, dont elle
réfléchit la lumière.
Une étoile filante est un météore, un petit corps céleste qui se consume en arrivant dans l’atmosphère.
Un météore : il traverse juste l’atmosphère.
Une météorite : météore qui s’est écrasé sur terre, c’est une pierre.
Un astéroïde : un objet en révolution autour du Soleil, sa taille est extrêmement variable. Synonyme de
petite planète.
Comète : météore qui revient régulièrement, qui fait de grande ellipse autour du soleil.
III- Notre système solaire :
Notre système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, et de neuf planètes qui tournent autour de lui sur
des orbites quasi-circulaires. Certaines de ses planètes possèdent des satellites et des anneaux.

25/41
UEO1 - Sciences Physiques - Barbachoux
Le système solaire renferme aussi une multitude d'astéroïdes, ce sont des corps relativement petits dont la
taille va de celle d'un grain de poussière à près d'un millier de km. Une partie de ces astéroïdes forment
une ceinture entre les orbites de Mars et de Jupiter
Planète
Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton
Distance moy. du soleil
(Million de Km)
58
108
150
228
778
1427
2870
4500
5950
Durée d'une révolution
(années)
0.24
0.61
1
1.88
11.86
29.45
84
164
247.7
Durée de la rotation
59 j
243 j
23h 56mn
24h 37mn
9h 50mn
10h 39mn
17h 14mn
16h 3mn
153h 17mn
IV- Étoiles et constellations
Une étoile est une boule de gaz (principalement hydrogène et hélium), lieu de réactions de fusion
nucléaire, à l’origine d’une émission d’énergie rayonnante par incandescence, et d’une température de
plusieurs milliers de degrés Celsius. La couleur d’une étoile dépend de sa masse et de son âge. Les étoiles
les plus chaudes sont bleues (ex. Véga). Il existe des étoiles « géantes » et des étoiles « naines ». Les
étoiles se transforment au cours de leur vie (naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs, super
nova…).
Remarque: le scintillement des étoiles est dû aux turbulences atmosphériques. Le rayonnement arrivant
des planètes est stable.
Une constellation est un groupe d’étoiles repéré par les hommes. On attribue aux différentes
constellations des vertus dépendant de la culture (ex. astrologie). En fait, les étoiles d’une même
constellation peuvent être à des distances gigantesques les unes des autres…
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%