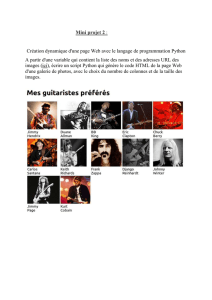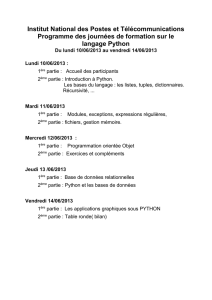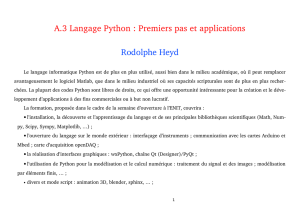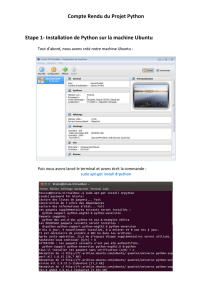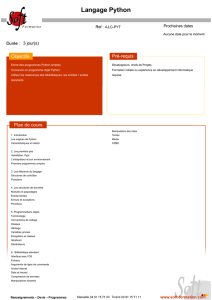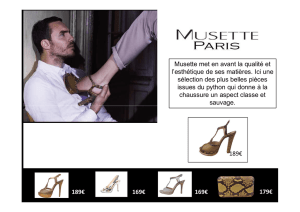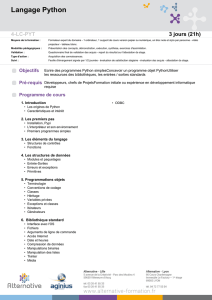Mythologie et astronomie III. Python et le Dauphin (Sénèque, Med

Presses Universitaires du Midi
Mythologie et astronomie III. Python et le Dauphin (Sénèque, Med. 700)
Author(s): Jean SOUBIRAN
Source:
Pallas,
No. 66 (2004), pp. 37-47
Published by: Presses Universitaires du Midi
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/43605938
Accessed: 01-01-2017 12:40 UTC
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted
digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about
JSTOR, please contact [email protected].
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
http://about.jstor.org/terms
Presses Universitaires du Midi
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Pallas
This content downloaded from 130.133.8.114 on Sun, 01 Jan 2017 12:40:57 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

PALLAS, 66, 2004, pp. 37-47.
Mythologie et astronomie III.
Python et le Dauphin
(Sénèque, Med. 700) 1
Jean SOUBIRAN
(Université de Toulouse-Le Mirail)
Préparant - selon le récit de sa nourrice - une terrible opération magique, Médée
rassemble d'abord une foule de serpents venimeux {Med. 681-690), dont elle juge
cependant trop faible la malfaisance : elle fera donc appel aux reptiles célestes, plus
redoutables encore :
690 « Parua sunt , inquit, mala
et uile telum est , ima quod tellus créât :
caelo petam uenena. (...)
694 Hue ille uasti more torrentis iacens
descendat unguis, cuius immensos duae>
maior minorque, sentiunt nodos ferae
(maior Pelasgis apta, Sidoniis minor),
pressasque tandem soluat Ophiuchus manus
uirusque fiindat ; adsit ad cantus meos
700 lacessere ausus gemina Python numina,
et Hydra et omnis redeat Hercúlea manu
succisa serpens , caede se reparans sua.
Tu quoque relictis peruigil Colchis odes,
sopite primum cantihus serpens meis. »
1 Je dois le point de départ de cette recherche à Madame Armisen-Marchetti qui, expliquant ce
passage à ses étudiants, s'est étonnée de la présence de Python au milieu de trois reptiles
notoirement catastérisés. Mes réflexions et mes recherches m'ont conduit, par l'argumentation
qu'on va lire, à l'hypothèse peut-être téméraire dont je porte seul la responsabilité.
This content downloaded from 130.133.8.114 on Sun, 01 Jan 2017 12:40:57 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

38 Jean SOUBIRAN
-I-
A. (v. 694-697) La constellation circumpolaire du Dragon, qui serpente entre
les deux Ourses qu'elle enserre, est reconnaissable entre toutes : on rappellera Aratos {Ph.
26-62), ses Scholiastes2 et ses traducteurs latins : Cicéron {Ph. fr. V-VII), Germanicus {Ph.
24-64 et Schol. ad loc.), Aviénus {Ph. 99-168), pour ne rien dire d'une foule d'autres
textes. La comparaison avec les méandres d'un fleuve, issue elle aussi d'Aratos {Ph. 45 oīīļ
Tcoxapoio árcoppcó^ / eiXeîxai) est passée chez Virgile {Ge. I 244 sq. Maximus hic flexu
sinuoso elahitur Anguis / circum perque duas in morem fluminis Arctos) et se retrouvera chez
Sénèque {Thy. 869 sq. Et qui medias diuidit Vrsas / fluminis instar lubricus Anguis) . L'idée
que les navigateurs grecs s'orientent d'après la Grande Ourse, plus facile à repérer, et les
Phéniciens d'après la Petite, plus proche du pôle, est également une idée aratéenne {Ph.
37-44) reprise par les traducteurs latins (Cic., Ph. fr. VII ; German., Ph. 40 sq. ; Avien.,
Ph. 12 4 sq.), ainsi qu'Ovide {Fast. III 107 sq. ; Tr. IV 3, 1 sq.), Manilius (I 294-301),
Val. Flaccus (I, 17-20)... pour nous en tenir aux poètes classiques. Ce Dragon est
considéré par les mythographes comme le gardien du jardin des Hespérides3, tué par
Héraclès qui, selon l'opinion la plus répandue, est à reconnaître dans la constellation
voisine de l'Agenouillé (aujourd'hui, précisément, Hercule)4. Certes, le scholiaste d'Aratos
(p. 92 Mart.) cite Python comme une identification possible de ce Dragon, mais telle ne
pouvait être la pensée de Sénèque, qui mentionne expressément Python plus loin (v. 700).
B. (v. 698-699) Le Serpent que tient Ophiuchus (' 0<|>ioû%oç = « qui tient le
serpent ») n'est pas moins évident. La figure humaine, dressée sur la carapace du Scorpion,
maîtrise un long reptile qui lui enserre la taille et dépasse de chaque côté, vers la
Couronne au nord (la tête), vers l'Aigle à l'est (la queue). Cette figure, les mythographes
l'identifient généralement à Asclépios-Esculape5, dont on sait que le serpent est l'animal
2 Nous renvoyons à la monumentale édition commentée dAratos procurée par J. Martin
(C.U.F., 1998, 2 vol.), ainsi qu'aux Scholia in Aratum uetera publiés par le même savant
(Stuttgart, Teubner, 1974). Traducteurs latins d'Aratos (tous publiés dans la C.U.F.) : Cicéron
(J. Soubiran, 1972) ; Germanicus (A. Le Boeuffle, 1975) ; Aviénus (J. Soubiran, 1981),
auxquels on ajoutera Hygin, De Astronomia (A. Le Boeuffle, 1983) ; on se reportera aux notes
ou commentaires de ces éditions. En outre, Scholies de Germanicus, Germanici Caesaris Aratea
cum scholiis, ed. A. Breysig, Berlin, 1867 = Hildesheim, 1967 ; Ératosthène, Catasterismorum
reliquiae, ed. C. Robert, Berlin, 1878, repr. 1963 ; Ératosthène, Le ciel. Mythes et histoire des
constellations, sous la dir. de P. Charvet, trad. fř. & comm., Paris, 1998.
3 Schol. Arat., p. 91 sq. ; Eratosth., Catast. 3 ; Schol. German., p. 60, 116 sq. ; Hyg., Astr. II 3,
1.
4 Cf. Arat., Ph. 63-70 et Schol. ad loc. ; Eratosth., Catast. 4 ; Hyg., Astr. II, 3, 1 ; 6, 1 ; Avien.,
Ph. 169-193, etc. D'autres identifications dans Hyg., Astr. II 3, 2 ; Schol. Arat., p. 92. Cf. Le
Boeuffle, 1977, p. 193 (en abrégé dans ce qui suit : N.LA.C.)
5 Cf. Arat., Ph. 82-89, et Schol. p. 111, 117 ; Cic., Ph. fr. XV ; German., Ph. 73-89 et Schol. p.
62, 120 ; Avien., Ph. 235-248 ; Eratosth., Catast. 6 ; Hyg., Astr. II, 14, 5 ; Manil., I 331-336.
Autres identifications : Hyg., Astr. II 14, 1-4 ; cf. A. Le Boeuffle, N.LA.C. p. 198.
This content downloaded from 130.133.8.114 on Sun, 01 Jan 2017 12:40:57 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

PYTHON ET LE DAUPHIN 39
favori6.
C. (v. 701-702) Il s'agit ici de la constellation de l'Hydre : Aratos, Ph. 443-
449, d'où Cicéron, Ph. 214-221 ; Germanicus, Ph. 426-432 ; Aviénus, Ph. 891-901 ; en
outre, Manilius, I 415 sq. ; Hygin, Astr. II 40 ; III 39 i etc. La plupart des mythographes
unissent l'Hydre (serpent d'eau), le Corbeau et la Coupe dans une fable amusante, contée
en particulier par Ovide, mais qu'on retrouve aussi ailleurs7 : envoyé par Apollon chercher
de l'eau à une source, le corbeau s'y attarda outre mesure pour attendre la maturité des
fruits d'un figuier voisin, et justifia ensuite son retard auprès du dieu en prétextant la
présence d'un serpent d'eau qui l'aurait empêché de remplir son vase. Irrité du mensonge,
Apollon condamna l'oiseau à souffrir toujours de la soif et catastérisa ensemble les trois
figures, Corbeau, Coupe et Hydre. Mais pour Sénèque, ici, il ne s'agit pas de cela : le
contexte indique sans équivoque que cette Hydre est le monstre de Lerne, dont Héraclès
triompha en tranchant d'un coup toutes les têtes (en nombre variable selon les
mythographes : peu nous importe ici) et en cautérisant les blessures pour les empêcher de
repousser plus nombreuses. Cette identification de l'Hydre céleste, xo Çcôov ô
KanrycoviaaTO o'HpaicMfc (Schol. Arat., p. 280, 14 ; cf. 281, 17 Mart.), explicite chez le
Scholiaste, est implicitement confirmée par le groupement des trois constellations, Hydre,
Cancer et Lion (Arat., Ph. 445 sq. et note J. Martin ad loc. ; d'où Cic., Ph. 216 sq. ;
German., Ph. 42 7 sq. ; Avien., Ph. 893 sq. ; Eratosth., Catast. 11 ; Vitruve, IX 5, 1 ;
Hygin, Astr. II 23, 1) - le Cancer étant, pour les auteurs qu'on vient de citer (et pour
Avien., Ph. 379-383), le crustacé qui mordit Héraclès au pied dans le marais de Lerne, et
le Lion le fauve de Némée, dont Héraclès portait sur le dos la dépouille, trophée de son
premier travail8.
Tels sont donc les trois reptiles célestes, car tres sunt ungues in cáelo : unus qui in
septentrione est, alter Ophiuchi, tertius australis , in quo sunt Crater et Coruus (Servius, ad
Ge. I 205). Mais non seulement Sénèque leur adjoint in fine (703 Tu quoque...) le dragon
cher à Médée qui veillait en Colchide sur la toison d'or et qui n'est pas catastérisé - nous
en reparlerons plus loin - ; mais surtout, parmi les reptiles célestes, il en intercale un
quatrième, Python (v. 699-700), qui ne semble jamais, lui non plus, avoir trouvé place
dans le ciel étoilé. Disparate du développement sénéquien ? Les commentateurs de Médée
paraissent l'admettre. Pour C.D.N. Costa9, Médée « now summons serpents from the
6 Cf. Ovide, Met. XV 651-744. Mais la couleuvre d'Esculape (le 7capeiaç des Grecs : cf. aussi
Lucain, IX 721 et la note de mon éd.), splendide serpent bronzé dont la longueur peut
atteindre 2 mètres ( Grand Larousse EncycL , s.v. couleuvre, III 565 b), n'est pas venimeuse,
contrairement à l'attente de Médée (699 uirusque fundat ). Dans le sanctuaire du dieu, à
Épidaure, était apprivoisée cette espèce ; et quand on fondait un nouveau temple, on y amenait
un de ces serpents.
7 Ovide, Fast. II, 243-266 ; en outre, Eratosth., Catast. 41 ; Schol. Arat., p. 282 ; Schol.
German., p. 100, 180 ; Hyg., Astr. II 40, 1 ; cf. A. Le Boeuffle, N.L.A.C. p. 204.
8 Sur ces deux identifications, cf. A. Le Boeuffle, N.LA.C. p. 21 1 et 212 (avec références).
9 Seneca Medeay ed. with Introd. and Comm., Oxford, 1973. C.D.N. Costa exclut l'Hydre des
reptiles célestes, ce qui est plutôt surprenant, la constellation de l'Hydre étant bien connue.
This content downloaded from 130.133.8.114 on Sun, 01 Jan 2017 12:40:57 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

40 Jean SOUBIRAN
constellations, and three others famous in the legend, Python, Hydra and the guardian of
the Golden Fleece with which she had already dealt » ; de même H.M. Hine 10, qui, ayant
cité les trois reptiles célestes énumérés par Servius, Draco , Serpens , Hydra , ajoute : « All
three are summoned by M., and so are other mythological serpents : Python, killed by
Apollo and cremated or buried, and the snake that guarded the golden fleece ». Mais ne
peut-on réellement trouver dans le ciel trace de Python ?n
-II-
Notons d'abord, après C.D.N. Costa, que l'allusion du v. 700 est connue par
d'autres sources, notamment Hygin, Fab. 140 : Python, serpent monstrueux, était voué à
périr de la main d'un enfant de Latone. Lorsqu'il la sut enceinte, Python la poursuivit
donc pour la tuer, mais elle lui fut dérobée par Zeus et il ne put la trouver. Quatre jours
après sa naissance, Apollon se vengea de Python en le tuant de ses flèches12.
Gemina... numina désigne donc Apollon et Artémis encore à naître, et le neutre pluriel
numina est particulièrement habile pour réunir deux divinités de sexe différent, fût-ce au
prix d'une anomalie métrique13.
Mais la question essentielle demeure une éventuelle catastérisation de Python, que
semble suggérer Sénèque, et qu'ignorent, à notre connaissance, mythographes et
astronomes. Donnons tout de suite notre solution. Nous pensons qu'a existé, connue de
Sénèque et attestée indirectement par ce seul passage de Médée> une tradition qui
identifiait Python avec la constellation du Dauphin. Le lien entre les deux est fourni par
un nom rare de Python, en grec, (ou -<|>ÍVT1Ç ), quasi homonyme du
Dauphin, ; et l'on ajoutera une deuxième homonymie, celle du nom de Delphes,
AeX<|)OÍ. Les relations induites par cette triple rencontre peuvent être synthétisées par le
diagramme que voici :
10 Seneca Medea^ with an Introd., Text, Transi, and Comm., Warminster, 2000 - qui corrige, à
propos de l'Hydre, l'erreur de son prédécesseur.
11 Je regrette de n'avoir pu consulter, pour tout ce qui suit, J. E. Fontenrose, 1959.
12 Version différente chez Apollodo re (14, 1) : ayant appris de Pan la man tique, Apollon se
rendit à Delphes, où Thémis alors prophétisait ; et comme le serpent Python, qui gardait
l'oracle, l'empêchait d'approcher de la crevasse, il le tua. - Sur Apollon meurtrier de Python,
nombreux textes : H. h. Ap. 300 sqq. ; Eur., I. T. 1233-1258 ; Call., Hymn. II 97-104 ; Ap.
Rh., II 705-707 ; Prop., IV 6, 35 ; Ov., Met. I 438-447 (qui fait de Python, v. 444, un serpent
venimeux) ; Sen., H.O. 92 sqq. ; Luc., V 79-81, VII 148 ; Stace, Th. I 562-569, 711 ; VI 8
sq. ; Ter. Maur., 1586 sqq.
13 Lorsqu'il termine son trimètre par un trisyllabe crétique ou dactylique, Sénèque s'astreint
presque toujours à le faire précéder d'un polysyllabe élidé (cf. mon Essai sur la versif dram, des
Romains , Paris, 1988, p. 379).
This content downloaded from 130.133.8.114 on Sun, 01 Jan 2017 12:40:57 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%