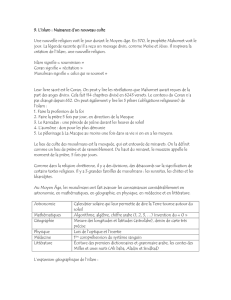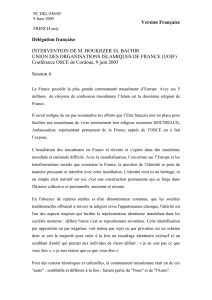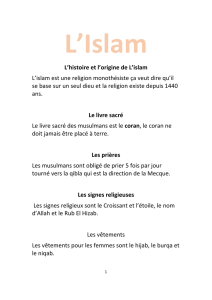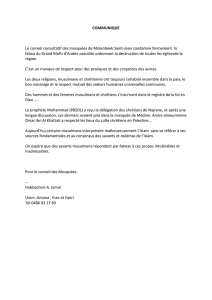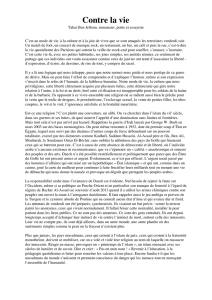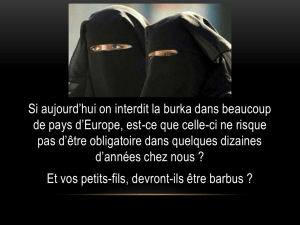LE "NOUVEL" ISLAM ESPAGNOL CONSOLIDATION ET CONFLITS

94
Bulletin N° 37
LE "NOUVEL" ISLAM ESPAGNOL
CONSOLIDATION ET CONFLITS SOCIO-EDUCATIFS
Jordi Garreta Bochaca
Université de Lleida, Espagne
L'ESPAGNE ET LA CATALOGNE
FACE A LA DIVERSITE
Les flots migratoires des dernières trente années, mais surtout depuis les années 80
ont comporté un accroissement de l'hétérogénéité culturelle et religieuse en Espagne et en
Catalogne1 . Des gens en provenance de pays que nous ne connaissons pas, de pays
lointains et, même, exotiques se sont ajoutés à la diversité déjà existante – et cette
présence sera de plus en plus évidente. Nous assistons ainsi à l'arrivée d'immigrants qui
ont modifié et la réalité multiculturelle et la perception que nous en avons. En même
temps, il va sans dire, la réponse donnée à cette immigration n'est pas homogène, l'accueil
est différent en fonction des individus, de leur lieu d’origine et de l’image que nous nous
en faisons. Aussi, partant de cette réalité, les chercheurs se sont intéressés à des groupes
concrets d'immigrants, en particulier à ceux qui proviennent de ce qu'on appelle le Tiers
Monde, et ont souvent analysé des aspects particuliers de leur situation: marché du travail,
logement, etc. Cet aspect joint à la nouveauté du phénomène, font qu'il y ait encore peu
d'études qui focalisent leur intérêt sur les croyances religieuses de ces nouveaux venus et
sur le rôle de la religion dans l'assimilation ou l'intégration dans la société d'accueil. C'est
en constatant ce vide partiel que nous avons envisagé le besoin d'amorcer une ligne de
travail qui nous permette de connaître et d'analyser le rôle de la religion. Cependant, il est
évident que les croyances religieuses ne sont pas communes à tous les immigrants qui
s'installent en Catalogne. C’est pour cette raison nous avons voulu centrer notre étude sur
un groupe qui a une présence importante et évidente: les musulmans.
L'immigrant emporte avec lui un bagage culturel, des croyances religieuses qui ne
vont toujours trouver un milieu facile dans la société d'accueil. Dans une société qui n'est
pas de majorité musulmane et où avant il n'y avait même pas une minorité importante, il
faut placer ou harmoniser l'Islam pour ne pas générer de conflits, pour ne pas, selon nous,
provoquer de renonciations importantes. L'établissement des immigrants qui ont ces
croyances, principalement en provenance d'Afrique et surtout du nord de l'Afrique,
comporte le besoin d'organiser le suivi et la pratique. L'introduction du système religieux
1Région Autonome située au Nord-est de l'Espagne, avec une population de quelques six millions
d'habitants et ayant une langue propre.

Association pour la recherche interculturelle
95
95
musulman , fruit des migrations, se trouve dans une phase évolutive où il se produit
différentes transactions (privées et publiques) basées sur deux axes fondamentaux et dont
l'articulation conditionne le processus d'intégration: la traduction des références islamiques
sociales et l'intégration des institutions islamiques. En Europe, des pays comme la Grande
Bretagne, la France ou la Belgique où vivent des deuxièmes et des troisièmes générations
de musulmans, ont vécu une "transplantation" comme celle qui a lieu actuellement en
Espagne et en Catalogne. Même avec les distances que nous devons prendre, ces exemples
et d'autres que nous aurions pu choisir comme référent, nous montrent l’évolution de cette
présence. La dynamique qui a été suivie dans les pays cités a mené à des situations
différentes, par exemple, en Grande Bretagne le modèle d'insertion de communautés a
favorisé l'expression d'une identité islamique bien homogène, par contre, en France le
modèle dominant d'intégration individuelle (sans médiation des communautés) a comporté
la diversification des expressions d'identité (voir par exemple Kepel 1991a ; 1991b ; 1995,
ou Leveau 1994).
L'ISLAM EN ESPAGNE
En Espagne il existe un islam autochtone mais qui a peu à voir avec les organisations
de musulmans immigrés (Losada 1995 et Moreras1996). Les musulmans étrangers
n'avaient pas d'organisation religieuse en Espagne avant la publication de la première loi
reconnaissant leurs droits (44/1967 de 28 juin), leur présence se manifestait, jusqu'alors, à
travers des centres culturels peu définis. C'est à partir de cette date que les premières
associations islamiques se sont inscrites. L'Association Musulmane d'Espagne, dont le
siège est à Madrid, initia la négociation avec l'état espagnol pour obtenir la reconnaissance
et l'application des droits que la loi de liberté religieuse leur octroyait. Au sein de cette
association, en 1990, on recense huit Communautés Musulmanes disséminées dans toute
l'Espagne (Valence, Grenade, Madrid, Saragosse, Asturies, Tarrasa et Alicante) qui
constituent en 1991 l'Union des Communautés d'Espagne (López et Olmo 1995) Depuis,
les communautés islamiques se répandent sur une grande partie du territoire espagnol
principalement dans le tiers sud de la péninsule et dans nord de l'Afrique (Tatary 1995).
Ces associations de la communauté islamique agissent en intermédiaires dans la
négociation du processus d'intégration, les associations nationales négocient la situation
officielle de l'Islam, tandis que les associations locales résolvent, de manière autonome, les
problèmes quotidiens, mais d'une grande valeur symbolique pour la communauté.
Un musulman qui réside momentanément dans un endroit peut pratiquer sa religion
n'importe où, mais s'il s'installe il a besoin de s'organiser au sein d'un groupe. Les
musulmans se sont organisés en créant des réseaux de solidarité. Ils ouvrent des magasins
où l'on vend la viande halal, (la seule autorisée par leur religion). La vie est structurée
autour de la mosquée. Cela s'explique par le caractère de l'Islam qui règle non seulement la
pratique religieuse et morale mais aussi les rapports sociaux (Losada 1995) La sédentarité
en Espagne de certains de ces musulmans est perceptible à travers quatre mosquées (sans

96
Bulletin N° 37
compter celles de Ceuta et de Melilla) et plus de cinq cents lieux de prière. Le Centre
Culturel Islamique de Madrid (financé par le roi Fahd de l'Arabie Saoudite) est la plus
grande mosquée, et en Catalogne nous avons recensé cette année quatre-vingt-quinze lieux
de prière (Garreta 1999) Les mosquées et les lieux de prière2 remplissent de nombreuses
fonctions et deviennent un espace de socialisation pour toute la collectivité musulmane.
Aussi, ils deviennent un axe de structuration de la communauté car ils organisent le groupe
et consolident la présence de l'Islam dans leur zone d'influence (Rozenberg 1996). Mais
cette présence n'est pas homogène dans tous les sens, d'après Teresa Losada (1995) on
distingue quatre expressions publiques de l'Islam en Espagne qui vont du laïcisme à
l'islamisme militant: pratiquants déjà installés (principalement migrants du genre masculin
âgés de trente à trente-cinq ans, pour qui le retour à l'Islam coïncide avec la décision de
s'installer avec leur famille d’origine, ceci étant une façon d'éviter l'absorption de leurs
enfants) ; l'Islam de deuxième génération (jeunes qui ne refusent ni leur culture ni leur
religion mais qui l'adaptent à la nouvelle situation et qui résument leur pratique à des
manifestations externes – Ramadan et autres fêtes– oubliant la pratique quotidienne. Leur
identité n'est pas encore définie et elle dépend en partie des stratégies familiales);
musulmans sociologiques avec une référence à l'Islam plus culturelle que de culte; et
militants islamistes, ayant une vision négative de l'émigration hors de leur pays, de peur de
l'assimilation et de la perte de l'identité religieuse.
Pour Teresa Losada (1995) et N. López (1995) les années quatre-vingt
représenteraient la période de croissance de l'Islam en Espagne dont les deux facteurs de
soutient sont: la révolution iranienne, qui jouera un rôle important dans l'identité
collective, et la promulgation de la loi sur les étrangers en 1985, avec une augmentation
immédiate du regroupement familial. A titre d’exemple concret et remarquable à
Barcelone, et selon la recherche de Jordi Moreras (1996) –généralisable à l'ensemble de la
Catalogne– on peut observer des rythmes différents d'ouverture et de consolidation des
centres de prière musulmans, en fonction du processus d'établissement de ces collectifs
d'immigrants. En même temps ce processus est conditionné par d'autres facteurs comme la
réaction du voisinage, l'appui des institutions locales ou l'intervention d'autres promoteurs
non communautaires. En constatant cette différence, dans le texte, qui peut nous servir
d'exemple de ce qui est arrivé en Espagne, on regroupe les différentes trajectoires de
manière à établir cinq étapes dans l'évolution de la "transplantation" de l'Islam: les années
soixante où il y a une absence d'espaces communautaires et une pratique religieuse non
visible –malgré tout, cela n'implique pas la non pratique religieuse de la part de la
communauté musulmane même si cette pratique s'exprimait en privé, individuellement ou
en communauté, dans des réunions de groupes musulmans dans leurs propres domiciles– ;
2 Les lieux de prière sont financés généralement par les fidèles et il n'est pas habituel que les pays
d'origine interviennent dans leur gestion, même si en faisant des contributions ils essaient d'avoir une
domination/ influence politique et idéologique sur la collectivité (Losada 1995). Mais d'après Rozenberg
(1996) qui reprend les mots du Père Emilio Galindo, l'Islam est politisé au niveau des associations. Ce
spécialiste pense qu'il existe entre les musulmans européens une distance due au sentiment de retour à la
patrie perdue (Al Andalus) et à la croyance que l'Espagne a une dette historique envers eux.

Association pour la recherche interculturelle
97
97
de 1970 à 1983, étape de la création des premiers centres et de précarité communautaire –
concrètement les premières initiatives pour créer des espaces communautaires pour la
pratique religieuse et comme lieu de réunion apparaissent vers 1974 – ; de 1984 à 1987,
première phase de la dispersion des espaces communautaires, on observe l'installation de
plusieurs communautés musulmanes, l'établissement dans des agglomérations au-delà de
la ville de Barcelone et l'augmentation du nombre de centres; de 1988 à 1992, phase de
dispersion, visibilité et stabilisation communautaire, les lieux de prière augmentent dans
les agglomérations aux alentours de Barcelone où se concentrent des immigrants; de 1992
jusqu'à l’heure actuelle, phase de régularisation progressive des espaces de culte –
concrètement elle commence au mois d'avril, lors de la signature des Accords de
Coopération entre l'État Espagnol et la Commission Islamique d'Espagne. Ces accords,
même s'ils n'ont pas eu un effet direct, nous sont utiles pour différencier ce dernier
moment dans lequel on observe une augmentation de l'intérêt pour transformer les centres
en associations culturelles non religieuses.
Dans une situation comme celle-ci, le projet migratoire transforme les lieux de prière
en centres de prière, mais aussi en centres de réunion de la communauté et d'affirmation de
l'identité. De ce point de vue ces endroits acquièrent une triple signification: par rapport à
la communauté musulmane en général, par rapport à la communauté musulmane locale et
face à la société non musulmane. Les années quatre-vingt-dix et sûrement la première
décennie du nouveau millénaire représenteront un réajustement où il faudra articuler, pour
les deux parties, les rapports et les échanges à établir. Dans cette articulation, les mosquées
déjà existantes et celles qui vont être créées auront sans doute un rôle important,
spécialement celles qui sont devenues une référence pour les autres.
LA DYNAMIQUE DE L'ISLAM
L'analyse de la situation de l'Islam que nous présentons a été réalisée à partir d'une
enquête et d’entretiens en profondeur auprès d’immigrants musulmans et d’imams qui ont
leur centre de prière en Catalogne3.
3 Les résultats ont comme point de départ deux études. L'une, effectuée dans deux provinces espagnoles:
Lleida et Huesca. On y a réalisé un travail de terrain quantitatif (enquête) qui analyse les réponses de 450
immigrants et qui suppose dans le cas le plus défavorable (p=q=50%) et avec un degré ce confiance de
95% une erreur statistique de +/-5.3. D'autre part, comme on pourra le constater, dans un but de
complémentarité méthodologique, l'étude, comprend une phase qualitative qui utilise l'entretient en
profondeur. En tout, nous avons réalisé vingt-cinq entretiens à des immigrants provenant d'Afrique, parmi
lesquels nous trouvons six représentants d'associations et quatre imams. La deuxième étude (financée par
le groupe FUS de Barcelone) a été réalisée dans toute la Catalogne et nous avons utilisé une
méthodologie qualitative– quarante et un entretiens en profondeur à des imams de toute la Communauté
Autonome/Région (ils sont en tout une centaine)

98
Bulletin N° 37
Les mosquées4 où nous avons eu des entretiens avec l'imam ont été crées au début
des années soixante-dix, mais c'est surtout dans les années quatre-vingt et en particulier
4 Une des premières questions que nous devons définir est ce que l'on entend par mosquée et par centre
de prière. Du point de vue pratique et même si quelques uns des informateurs essaient de faire des
différences, nous utiliserons les deux concepts pour nous référer à une même réalité. Pour cette raison, on
pourra voir que nous utilisons indifféremment les deux termes. Cependant nous devons remarquer que
pour certains on ne devrait parler que de mosquée, tandis que pour d'autres une mosquée devrait avoir une
infrastructure architectonique, que l'on ne possède pas et donc, il est convenable de parler de centre de
prière.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%