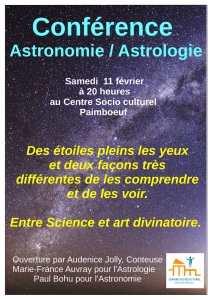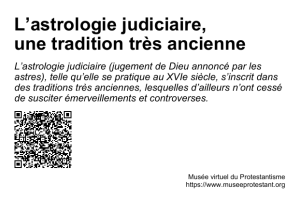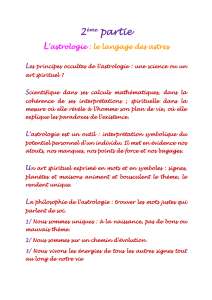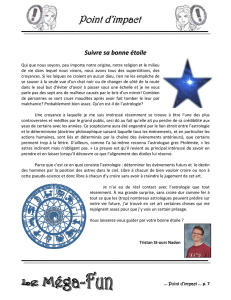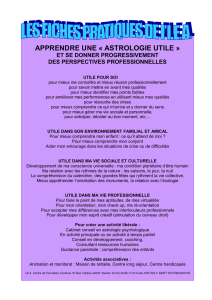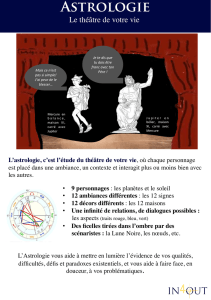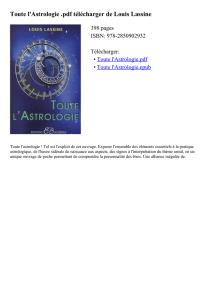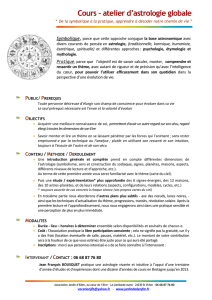ASTRONOMIE VERSUS ASTROLOGIE

69
ASTRONOMIE VERSUS ASTROLOGIE :
LA LECTURE DES ASTRES DANS
MEMOIRES D'HADRIEN ET L'ŒUVRE AU NOIR
par Claude BENOIT (Université de Valencia)
On regarde beaucoup les astres dans les grands romans de
Marguerite Yourcenar. Que l'on parcoure Mémoires d'Hadrien ou
L'Œuvre au Noir1, la scène du personnage qui lève les yeux vers
le ciel et scrute les figures célestes se renouvelle fréquemment
au fil du texte. Dans le cas d'Hadrien, il s'agit d'une
connaissance transmise par un ancêtre, d'un héritage familial
de caractère traditionnel et quasi sacré. Dès sa plus tendre
enfance, il a été initié par Marullinus, son grand-père, à
l'observation du monde stellaire :
Marullinus, mon grand-père, croyait aux astres. […] Il
m'emmenait observer le ciel pendant les nuits d'été, au haut
d'une colline aride. Je m'endormais dans un sillon, fatigué
d'avoir compté les météores. Il restait assis, la tête levée,
tournant imperceptiblement avec les astres. (MH, p. 39-40)
Avant de mourir, il avait essayé de m'enseigner son art.
(MH, p. 41)
Zénon, lui aussi, fait montre très tôt d'un intérêt singulier
pour les mystères de ces mondes supérieurs. Le narrateur
mentionne à son sujet « […] la crainte qu'inspire un garçon qui
parle latin et lit dans les astres » (ON, p. 37), pour souligner
cette particularité qui le distingue des adolescents de son
entourage. Il est dans ses habitudes d'observer les sphères
1 Mon corpus se limitera à ces deux romans qui offrent davantage matière à
étude. Les références au texte sont faites aux éditions suivantes : Marguerite
YOURCENAR, Mémoires d’Hadrien, Paris, Gallimard, Folio, 1974 (1e édition,
Plon, 1958) ; L’Œuvre au Noir, (1e édition), Paris, Gallimard, 1968.

Claude Benoit
70
ignées : « Tard dans la nuit […], il se leva pour sa coutumière
observation des astres » (ibid., p. 39).
Laissant de côté l'aspect historique ou pseudo-historique
susceptible de justifier, dans le cas d'Hadrien, cette inclination
de la personne évoquée pour les sciences astrales, ou, dans
celui de Zénon, le désir de conférer au personnage de fiction les
préoccupations propres aux savants de son époque, on serait
tenté d'y voir la manifestation d'un goût personnel de l'auteur.
C'est ce que je me suis proposé de mettre en lumière, non sans
avoir analysé auparavant dans ces deux romans, quelle est la
part réservée à l'astrologie et à l'astronomie respectivement.
Astrologicorum Mundi
Bien qu'on ne puisse pas considérer à proprement parler
l'astrologie comme une science dans le sens que nous donnons
actuellement à ce vocable (connaissance exacte et démontrée de
certaines choses déterminées2), nous respecterons l'expression
que l'on employait à l'époque d'Hadrien et même encore, dans
certains milieux, à celle de Zénon, dans son sens de science
naturelle, ou dédiée à l'étude des phénomènes de la nature, en
l'occurrence, à celle des corps célestes.
En général, on observe dans les deux œuvres un continuel
va-et-vient entre une croyance intuitive en le pouvoir des astres
sur les destinées individuelles ou universelles et un savoir
scientifique plus abstrait qui, dans l'Antiquité, comprenait
plusieurs disciplines, entre autres, les mathématiques, la
physique et la philosophie. Il s'y produit dans les deux cas une
oscillation pendulaire entre le domaine de l'astrologie et celui
de l'astronomie.
Dans les Mémoires, il est pratiquement impossible de
séparer ces deux parcelles de savoir. « J'ai toujours été l'ami
des astronomes et le client des astrologues » (MH, p. 162), écrit
Hadrien à Marc Aurèle.
Rien de surprenant si l'on pense que l'astrologie, ou
« étude des corps célestes », dont l'origine remonte à la nuit des
temps, a été considérée comme la science sacrée la plus
2 Définition du Lexis, Larousse 1979, p. 1703.

Astronomie versus astrologie
71
ancienne, et la « mère » de l'astronomie actuelle et qu'elle reçut
même le nom de « science des sciences ». Dès les premières
civilisations, les hommes ont observé et étudié le ciel, non
seulement pour y déchiffrer des présages – ils croyaient que la
volonté des dieux se manifestait à travers les phénomènes
célestes – mais encore pour mesurer le temps, les cycles du
soleil et de la lune ayant servi de base aux premiers
calendriers. Ainsi naquirent les concepts de jour, nuit, mois,
année, saison, etc. Le traité systématique d'astrologie le plus
connu – et l'un des plus anciens – est l'Almageste de Ptolémée,
écrit à Alexandrie vers l'an 150 de notre ère. Il est encore
réputé de nos jours comme la « bible de l'astrologie ».
Dans Mémoires d'Hadrien, comme dans l'Antiquité,
l'astrologie se fonde sur une conception unitaire du monde, le
microcosme étant de même matière que le macrocosme :
« puisque l'homme, parcelle de l'univers, est régi par les
mêmes lois qui président au ciel, il n'est pas absurde de
chercher là-haut les thèmes de nos vies, les froides sympathies
qui participent à nos succès et à nos erreurs » (MH, p. 162).
Pour Marullinus, « le monde était […] d'un seul bloc » (ibid.,
p. 40) ; le vieillard lit dans les astres comme il lit dans la
paume de l'enfant, croyant y trouver une « confirmation des
lignes inscrites au ciel ». La fracture entre l'homme et l'univers
ne s'est pas encore produite. Voilà ce qui explique pourquoi
Marullinus construit le thème de la nativité de son petit-fils,
pourquoi Hadrien cherche chez les astrologues la signification
de ses rêves et observe les mouvements des constellations,
croyant voir une « étrange réfraction de l'humain sur la voûte
stellaire » :
Je ne manquais pas, chaque soir d'automne, de saluer au sud
le Verseau, l'Échanson céleste, le Dispensateur sous lequel
je suis né. Je n'oubliais pas de repérer à chacun de leurs
passages Jupiter et Vénus qui règlent ma vie, ni de mesurer
l'influence du dangereux Saturne. (MH, p. 162)
Le point culminant de cette étroite relation entre l'être
humain et le cosmos nous est montré dans l'une des plus belles
pages du roman, à travers la description de l'extase de la nuit

Claude Benoit
72
syrienne. L'être qui contemple le firmament participe aux
mouvements célestes dans l'espace et dans le temps ; il
s'intègre aux voyages des astres en atteignant la plénitude
d'une fusion cosmique.
[J]'ai offert aux constellations le sacrifice d'une nuit tout
entière. […] Couché sur le dos, les yeux bien ouverts,
abandonnant pour quelques heures tout souci humain, je
me suis livré du soir à l'aube à ce monde de flamme et de
cristal. Ce fut le plus beau de mes voyages. Le grand astre
de la constellation de la Lyre, étoile polaire des hommes qui
vivront quand depuis quelques dizaines de milliers d'années
nous ne serons plus, resplendissait sur ma tête. Les
Gémeaux luisaient faiblement dans les dernières lueurs du
couchant ; le Serpent précédait le Sagittaire ; l'Aigle
montait vers le zénith, toutes ailes ouvertes […]. [J]'ai
connu plus d'une extase […]. Celle de la nuit syrienne fut
étrangement lucide. Elle inscrivit en moi les mouvements
célestes avec une précision à laquelle aucune observation
partielle ne m'aurait permis d'atteindre. […] la nuit syrienne
représente ma part consciente d'immortalité. (MH, p. 164-5)
Cependant, dans certaines occasions, l'empereur laisse voir,
malgré son penchant pour l'astrologie, une nuance de dédain
envers cette dernière. Ainsi, bien que son grand-père crût aux
astres, « [s]on esprit n'était pourtant pas tout à fait inculte »
(ibid., p. 39), précise-t-il ; la science des astrologues « est
incertaine, fausse dans le détail » (ibid., p. 162) ; pendant la
période heureuse de sa vie, « les étoiles ne furent plus que
d'admirables dessins sur la voûte du ciel » (ibid., p. 172). Il
s'intéresse davantage « aux mathématiques célestes, aux
spéculations abstraites auxquelles donnent lieu ces grands
corps enflammés » (ibid., p. 162), c'est-à-dire à l'astronomie.
À ce sujet, il est intéressant de remarquer qu'à l'époque
d'Hadrien, on ne distinguait pas encore entre astrologie et
astronomie. Il s'agissait d'une seule et même science, exercée
par des savants. Des philosophes grecs comme Pythagore et
Platon incorporèrent l'astrologie à leurs études sur la religion et
les phénomènes célestes. Le monde gréco-romain considérait les
deux sciences comme complémentaires, et jusqu'au XVIe siècle,

Astronomie versus astrologie
73
en Allemagne et en Italie, on les enseignait ensemble dans les
universités. La rupture entre ces deux domaines est beaucoup
plus tardive. En France, ce n'est qu'au XVIIe siècle que Colbert,
fondateur de l'Académie des Sciences, interdit l'enseignement et
la pratique de l'astrologie aux astronomes.
Il est donc pour le moins surprenant de constater chez
Hadrien ces quelques touches de mépris vis-à-vis des arts
divinatoires propres à l'astrologie, quand cette prise de position
devrait plutôt correspondre aux mentalités postérieures à la
Renaissance. Marguerite Yourcenar aurait-elle voulu doter son
personnage d'une modernité qui frise l’anachronisme, ou bien
aurait-elle fait cette concession au lecteur actuel pour rendre la
personnalité d'Hadrien plus crédible ou plus proche de nous ?
Voyons, à présent, quelle est la position du second des
grands personnages yourcenariens vis-à-vis de ces deux
sciences. Pour comprendre les différentes postures de Zénon
face à l'astrologie, il faut se replacer dans le panorama
scientifique de la fin du Moyen Âge et du début de la
Renaissance. À ce sujet, les choses ont bien changé depuis
l'empire d'Hadrien. Après l'irruption du christianisme et le
démembrement de l'empire romain (395 ap. J-C.), l'astrologie
n'était plus un sujet d'étude et son savoir stagnait depuis
l'époque de Ptolémée. Un fait d'importance capitale va
pourtant lui insuffler une nouvelle vitalité. La civilisation
arabe, et l'essor intellectuel favorisé par la naissance de l'Islam
récupèrent et transmettent, à partir du XIIe siècle, la pensée
aristotélicienne et la tradition astrologique du monde gréco-
romain. Bien qu'Avicenne ait affirmé que l'astrologie n'est pas
démonstrative, qu'elle ne peut rien prédire parce qu'il est
impossible de faire des expériences pour valider empiriquement
les assertions des astrologues, et que d'autres arguments
d'ordre théologique et moral3 viennent entraver ses progrès,
quelques savants arabes4 défendent toutefois une conception
hyper-déterministe des relations entre l'homme et le ciel.
3 Selon l'Islam, la destinée humaine ne peut dépendre que d'Allah. Pour les
Chrétiens, elle dépend de Dieu et non du cours des astres. Au XVIe siècle, la
question du libre arbitre sera au centre de la polémique.
4 Par exemple, l'astrologue Abou Marchar qui va jusqu'à dire que « l'homme ne
décide que ce que les planètes ont déjà décidé avant lui ». Cf. l'article proposé
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%