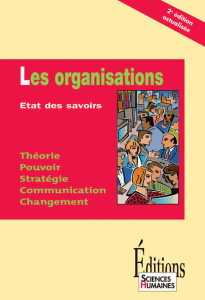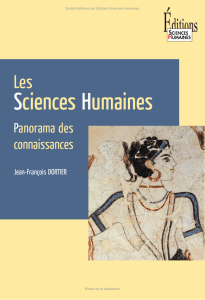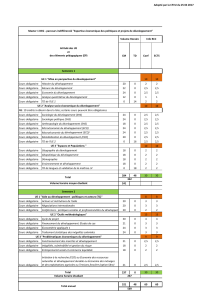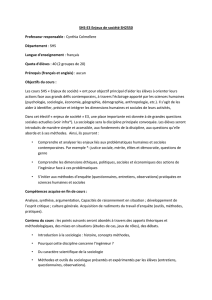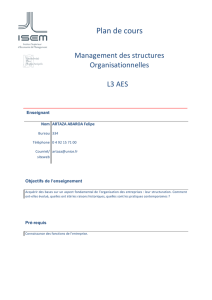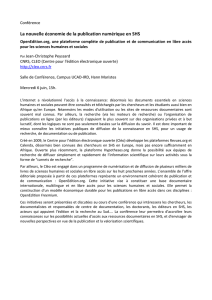Les sciences sociales en mutation

Extrait de la publication
Extrait distribué par Editions Sciences Humaines

Extrait de la publication

Extrait de la publication
Extrait distribué par Editions Sciences Humaines

LES SCIENCES
SOCIALES
EN
MUTATION
Extrait de la publication
Extrait distribué par Editions Sciences Humaines

Coordination : Emmanuelle Garcia
Conception de la couverture : Rampazzo & Associés
Réalisation de la couverture : Isabelle Mouton
Conception de la maquette intérieure : Isabelle Mouton
Lecture, correction et mise en pages intérieure : David Demartis
Iconographie : Laure Teisseyre
Fabrication : Natacha Reverre
Diffusion et promotion : Nadia Latreche
Diffusion Seuil Distribution Volumen
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire
intégralement ou partiellement, par photocopie ou tout autre moyen,
le présent ouvrage sans autorisation de l’éditeur ou du Centre Français
du droit de Copie.
Éditions Sciences Humaines, 2007.
38 rue Rantheaume, BP 256, 89004 Auxerre cedex
www.scienceshumaines.com
ISBN 9782361061241
Extrait de la publication
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%