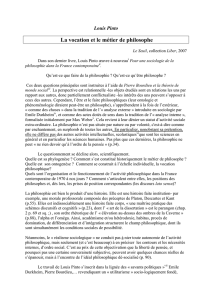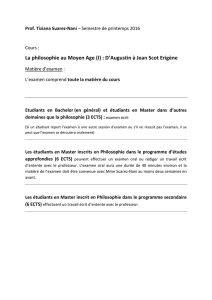Une histoire sans historien. Note sur l`usage du passé en philosophie

K
KL
LĒ
ĒSIS
SIS – R
– REVUE
EVUE
PHILOSOPHIQUE
PHILOSOPHIQUE
: 2009 = 11
: 2009 = 11
UNE HISTOIRE SANS HISTORIEN ?
(NOTE SUR L’USAGE DU PASSÉ EN PHILOSOPHIE)
Vincent Giraud (Bordeaux III)
I. Introduction
Étudier un auteur du passé, est-ce pour autant, du même coup et nécessairement,
s’en faire l’historien ? Une telle exigence semble jaillir du projet même d’étude
concernant les choses passées : qu’est-ce qui, mieux que la discipline historique,
permettrait de les aborder et de les saisir ? S’écarter de l’histoire, de ses démarches et de
ses contraintes, n’est-ce pas quitter le chemin sûr de la science pour céder aux appels
séduisants d’une lecture qui se prétendrait immédiate ? Selon une telle conception,
renoncer à l’histoire reviendrait soit à abandonner la rigueur propre à toute étude digne
de ce nom, soit à faire succéder au souci du passé celui d’une réalité présente.
À cette alternative, la philosophie répond par une exigence qui pourrait bien être
concurrente de celle de l’histoire et que l’on résumera en ces termes : toute pensée
philosophique authentique, en tant qu’elle est effective mise en œuvre du pensable, doit
pouvoir être réactualisée, ou plutôt, plus nettement encore : elle ne perd son actualité
qu’en cessant d’être philosophique, ou en révélant qu’elle avait jusque là usurpé ce titre.
La philosophie n’a affaire qu’à l’actuel, ce qui ne signifie aucunement que son objet ou
ses énoncés appartiennent toujours au temps présent ni ne s’y réduisent. Ainsi faudra-t-
il d’entrée de jeu, et soigneusement, distinguer le présent de l’actuel. L’actuel, défini par
sa seule opérativité, et comme tel terrain propre de la philosophie, s’impose comme
catégorie transcendante à la temporalité, irréductible à l’une ou l’autre des dimensions
du temps.
Pourtant, quoique échappant à l’histoire, la philosophie ne s’y oppose pas au
point de lui devenir étrangère ou hostile. La pensée vivante se moque du temps, mais
elle n’en reste pas moins liée au temps qui la voit éclore, la nourrit, ou la perpétue. La
philosophie a une histoire parce qu’elle est la pérégrination de l’actuel dans le temps,
lequel lui donne à chaque fois sa coloration et son relief propres. Dès lors, ne dira-t-on
pas que le philosophe doit être en même temps l’historien de sa propre discipline, lui
qui n’assume l’actuel de la pensée qu’en se confrontant aux actes de pensée des
philosophes du passé ? À cette question je tente dans ce qui suit, et dans la mesure de
mes forces, de répondre par la négative.
Et d’abord en soulignant ce qu’il peut y avoir de contradiction dans l’idée d’une
histoire de la philosophie établie sous la juridiction de la philosophie elle-même. En
53

K
KL
LĒ
ĒSIS
SIS – R
– REVUE
EVUE
PHILOSOPHIQUE
PHILOSOPHIQUE
: 2009 = 11
: 2009 = 11
effet, pour être histoire, une telle discipline devra prendre pour objet le passé, tout le
passé, et non, à l’intérieur de lui, s’attacher à l’actuel et rejeter l’inactuel – partage
comme tel étranger à l’histoire. Ainsi l’histoire rigoureusement comprise ne peut être en
même temps philosophie, ne partageant pas avec elle le même objet ni le même souci.
Et inversement, pour être philosophie cette discipline problématique (‘‘l’histoire de la
philosophie’’) ne doit pas être en même temps histoire – car elle s’encombrerait alors de
contenus dont elle n’a que faire. La divergence de projet est patente. Ce qui intéresse le
philosophe, c’est ce dont il peut tirer parti pour une pensée présente (l’actuel).
L’historien de la philosophie, lui, nous renseigne sur une pensée ou une époque de la
pensée afin de nous en restituer l’épaisseur, la cohérence, la beauté, l’éventuelle portée.
‘‘Qu’est-ce qui fut ici pensé ? Comment cela le fut-il ?’’, telles sont, en toute rigueur,
les seules questions qui intéressent l’historien. À la limite, on pourrait soutenir que
l’histoire est indifférente à l’usage qu’on peut faire de ce qu’elle établit. Là n’est pas son
objet. Le fait même qu’un phénomène intellectuel ou spirituel ait eu lieu suffit à
légitimer le travail de l’historien. L’histoire philosophique de la philosophie est un
cercle carré – à moins qu’elle ne se détache, comme c’est le cas chez Hegel, sur fond de
philosophie de l’histoire et comme l’une de ses dimensions. À strictement parler, il n’y
a que l’histoire (de la philosophie, finalement soluble dans l’histoire des idées) et la
philosophie.
Si l’exercice de la philosophie – considéré ici sous le seul aspect de la lecture
des auteurs – requiert bien quelque chose de l’histoire, il ne saurait en épouser les fins.
Car, être historien, ce n’est pas seulement comprendre et transmettre ce qui, d’une
philosophie, nous parvient – c’est aussi saisir celle-ci comme fruit de sa culture et de
son époque, c’est, à l’élucidation de la teneur spéculative du concept, ajouter celle de sa
genèse temporelle. Il s’agit donc d’établir la possibilité d’une discipline qui, sans
congédier la dimension irréductiblement historique de la philosophie, saura rester fidèle
au projet philosophique lui-même.
Mais prenons un exemple précis. En l’occurrence, celui sur lequel portent mes
propres recherches, et que je connais le moins mal. Il s’agit de la doctrine du signe
(signum) chez saint Augustin.
II. L’auteur en lui-même : l’actuel dans le passé
Le choix que nous faisons d’un auteur lorsque vient le moment (universitaire) de
la spécialisation reste souvent pour l’essentiel un geste opaque à notre propre
intelligence. Qu’est-ce qui me porte et m’engage à la lecture approfondie de telle ou
telle doctrine ? Ce n’est pas l’accord objectif et formel sur des thèses que nous
comprenons. Ce n’est pas davantage de partager le problème qui a mû le philosophe, et
qui peut très bien nous laisser aujourd’hui indifférent. C’est le sentiment, aussi obscur et
puissant qu’une conviction, d’une communauté de vues, ou plutôt, d’une commune
54

K
KL
LĒ
ĒSIS
SIS – R
– REVUE
EVUE
PHILOSOPHIQUE
PHILOSOPHIQUE
: 2009 = 11
: 2009 = 11
façon de voir et de sentir. Le passé de la pensée et de l’écriture, si lointain soit-il, cesse
alors tout à coup d’être vraiment le passé.
Quoi de plus lointain et de plus ‘‘démodé’’, en un sens, que la pensée de saint
Augustin ? Elle s’insère dans un cadre culturel révolu et adopte des présupposés qui ne
sont plus les nôtres. Pourtant, sa pensée du signe – pour ne parler que d’elle – trouve
sans difficulté un écho contemporain. Qu’est-ce qu’un signe ?
Le signe n’est pas d’abord pour Augustin un élément du discours (mot), un objet
intellectuel qui ferait problème pour l’analyse (ce que nous nommerions aujourd’hui le
signifiant), il est avant tout ce qui se manifeste à un conscience vivante et inquiète.
Signes sont, dans les Confessions, les livres des platoniciens, signes encore la rencontre
d’Ambroise à Milan, la voix de l’enfant dans le jardin, signes toujours la mort de l’ami
ou le vol de quelques poires. Le signe, au risque de voir se complexifier son concept, est
pour Augustin ce qui me requiert et me réclame, ce qui me convie ou me convoie vers
Dieu, il peut ainsi être une lettre aussi bien qu’un événement, un être de la nature tout
autant qu’une œuvre d’art. C’est que le signe répond d’abord à une exigence de
recherche qui prend la forme d’une vie. Cela ne retiendra évidemment pas Augustin de
consacrer de longs développements au signe linguistique, ou à l’image de la Trinité en
l’homme, mais l’impulsion part d’une existence qui se saisit comme « région
d’indigence » (regio egestatis, Conf. II, 10, 18). Le signe est pour une telle existence un
recours aussi bien qu’un détour. Voir Dieu, et trouver en cette vision le repos, tel est le
désir profond d’Augustin. Or cette vie ne permet pas la vision pleine et entière, le signe
donc devient nécessaire. Contrairement à la formule qui sera celle de Spinoza (veritas
eget nullo signo), si on la lit comme l’affirmation selon laquelle « la vérité (sa
découverte) n’a besoin d’aucun signe », le signe a chez Augustin un rôle de premier
plan. Il est ce par quoi Dieu m’appelle et m’avertit (vocatio, admonitio), ce qui pointe
vers lui et me l’indique en me permettant de m’orienter (nutus, indicium), ce qui enfin
me révèle une trace (vestigium) de Dieu dans le créé.
Mais le signe est par là même frappé d’un double statut axiologique, résultant
directement de son ambivalence ontologique. En tant qu’il est ce qui renvoie à Dieu, en
révèle un aspect, ou invite à s’unir à lui, il est valorisé positivement et son
déchiffrement constitue un juste rapport au réel. En tant qu’il risque en permanence
d’être pris pour ce qu’il ne cherche qu’à désigner, et de fasciner plutôt que d’indiquer, il
représente un danger : ce qui arrête le regard plutôt qu’il ne le mène au-delà de lui, vers
Dieu. Augustin en appelle au signe en même temps qu’il se défie de lui. Car la vérité ne
saurait tenir tout entière dans le signe qui tente de l’exprimer. La voie des signes
s’annonce ainsi comme une voie étroite, mais en même temps comme la seule qui soit
proportionnée à notre condition.
55

K
KL
LĒ
ĒSIS
SIS – R
– REVUE
EVUE
PHILOSOPHIQUE
PHILOSOPHIQUE
: 2009 = 11
: 2009 = 11
On le voit dans cette brève esquisse, tout surgit d’une inquiétude première1.
C’est elle, bien davantage qu’une quelconque thèse ou qu’un contexte culturel donné,
qu’il s’agit pour nous, lecteurs d’aujourd’hui, de partager. La pensée d’Augustin se
présente tout entière comme une quête de Dieu. Oublier cet aspect essentiel ou le
considérer comme secondaire serait se condamner à ne pas comprendre l’œuvre et à en
manquer la teneur et la portée proprement philosophiques. Ce n’est pas seulement à
travers le théologien qu’on voit poindre le philosophe, mais encore dans le simple
croyant qu’est Augustin, et finalement dans l’homme même, cet « homme » qui se
donne lui-même comme une « part quelconque de la création » divine2.
C’est là, certainement, dans la reconnaissance et la mise en œuvre spéculative de
cette inquiétude humaine qui n’est d’aucun temps, que se trouve l’irréductible actualité
d’Augustin. Or, dans la mesure où c’est à partir d’elle que surgit l’exigence du signe et
son étude, la doctrine augustinienne du signe prend à nos yeux un relief qui l’arrache au
simple intérêt historique qu’on pourrait lui porter.
III. L’auteur, son époque et ses sources : concept et histoire
Il est néanmoins évident que ce que nous avons identifié comme le nerf de la
pensée augustinienne n’accède au statut théorique qu’en endossant certaines formes et
certains motifs historiquement déterminés. Une fois isolée sa source, la doctrine du
signe chez l’évêque d’Hippone ne se laisse comprendre que si l’on connaît les éléments
à partir desquels elle se déploie. Se portant sur les signes, l’attention d’Augustin
embrasse du même coup un vaste champ qui exige qu’on en prenne aujourd’hui une
connaissance approfondie3. N’y a-t-il pas alors, dans cette investigation, geste
d’historien ? Oui et non. Oui : il y a bien une exploration du passé comme tel visant à
produire son intelligibilité. Non, parce que le but poursuivi n’est pas la connaissance
historique mais la participation plénière à ce qui se joue actuellement dans la pensée
étudiée. Le but, ici, n’est pas tant de connaître que de penser.
C’est ainsi que, traitant du signe chez Augustin, on en vient fatalement à discuter
anges, langage adamique, péché, miracles, symbolique des nombres, augures, astrologie
1 Confessions, I, 1 : « Tu nous as faits orientés vers toi, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose
pas en toi. Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te » (Les Confessions, trad.
E. Tréhorel et G. Bouissou, « Bibliothèque augustinienne », vol. 13-14, Paris, Institut d’études
augustiniennes, 1998, t. 1, p. 273).
2 « Te louer, voilà ce que veut un homme, parcelle quelconque de ta création. Laudare te vult homo,
aliqua portio creaturae tuae » (Ibid.).
3 Sans céder ici à aucune considération érudite, on peut nommer les principaux lieux auxquels Augustin a
nourri et élaboré sa pensée du signe : dialectique et théorie du langage selon le stoïcisme ; néoplatonisme
(Plotin et Porphyre) ; la Bible ; les Pères (et en premier lieu Ambroise, dont il fut l’auditeur à Milan) ; le
contexte religieux romain hérité du paganisme (augures, présages, haruspices) ; les connaissances
scientifiques et pseudo-scientifiques de son temps : astronomie/astrologie, médecine/physiognomonie,
mathématique ; les arts libéraux (droit, rhétorique). La diversité de ces champs permet d’entrevoir la force
et l’originalité de ce qu’on a pu appeler « la synthèse augustinienne » (T. Todorov, Théories du symbole,
Paris, Seuil, 1985, (1ère éd. 1977), pp. 34-58).
56

K
KL
LĒ
ĒSIS
SIS – R
– REVUE
EVUE
PHILOSOPHIQUE
PHILOSOPHIQUE
: 2009 = 11
: 2009 = 11
et sacrements. On n’en parle pas parce qu’on croit tout cela à la lettre, ni parce qu’on
veut connaître ce qu’ont pensé les Anciens à ce sujet, mais afin de retrouver dans toute
sa force la pensée qui les interroge et les thématise. Car il faut bien reconnaître que, sans
une claire connaissance de ces éléments qui constituaient pour elle le donné auquel elle
était confrontée, une telle pensée nous demeure pour l’essentiel fermée. Doit-on alors
parler d’un détour par l’histoire ? Celle-ci n’est-elle finalement pour le philosophe
qu’une laborieuse péripétie ? Porter un tel jugement serait négliger la nécessaire
inscription temporelle de l’actuel, la formulation historique inhérente à toute profération
de l’universel philosophique. La philosophie est tissée d’histoire, et comme telle exige
sa prise en charge. Mais celle-ci demeure de bout en bout philosophique, et n’appelle
pas pour autant le geste de l’historien. Tel est le paradoxe de la lecture des auteurs du
passé qu’elle nous conduit sur la voie d’une histoire à laquelle l’historien fait défaut. La
prise en considération du donné historique, pour être imputable à la philosophie, doit
avoir pour seule fin l’actualisation du penser.
IV. L’auteur et nous : l’actuel dans le présent
Il y a toujours quelque présomption à prétendre distinguer dans une philosophie
– ainsi que le faisait Benedetto Croce au sujet de Hegel – « ce qui est vivant » de « ce
qui est mort ». En philosophie, comme dans les nouvelles fantastiques, ceux qui ont l’air
le plus vivant sont parfois des spectres, et les morts sont rarement définitives. Pourtant,
dira-t-on, qui ne reconnaîtra sans peine que l’analyse augustinienne de la mémoire dans
les Confessions vaut philosophiquement davantage que les considérations
numérologiques de la Cité de Dieu ? En réalité, il faut aller plus loin : l’une est
philosophique, les autres ne le sont pas.
Mais l’essentiel n’est pas là. Il tient au fait – fondamental – que la philosophie
vivifie tout ce qu’elle touche. Avec elle, même les connaissances les plus absolument
dépassées retrouvent jeunesse et éclat, non pas dans leur contenu objectif toutefois, mais
dans le rôle conceptuel qui leur est désormais imparti. Nombres, anges, prophètes,
théophanies, sacrements, miracles… tous trouvent place dans la lecture contemporaine
d’une pensée qui fait du signe le véhicule (vehiculum) privilégié de l’existence humaine,
et dont la tâche théorique est finalement celle d’articuler ensemble la sémantique héritée
de la rhétorique et des écoles socratiques (stoïcisme) et la sémiotique issue de la Bible
(riche en théophanies, miracles, signes et prophéties). La quête d’une telle articulation
forme le fond vivant de la doctrine augustinienne du signe, dont elle permet
d’approfondir et d’unifier le concept.
En effet, l’étude du signe linguistique (sémantique) chez Augustin ne prend tout
son sens que lorsqu’elle est mise en regard avec le type de rapport qu’il s’agit, pour le
sujet, d’entretenir avec le monde sensible, dispensateur de signes (sémiotique). Par
exemple, le chapitre 2 du livre I du De doctrina christiana (consacré aux signes
57
 6
6
 7
7
1
/
7
100%