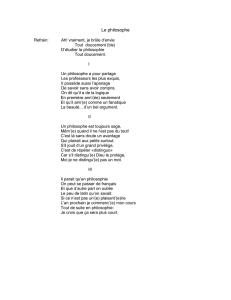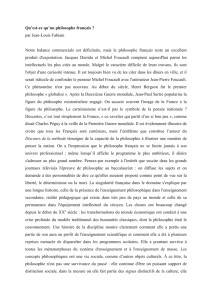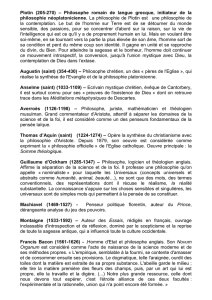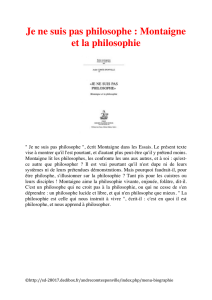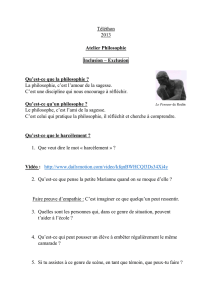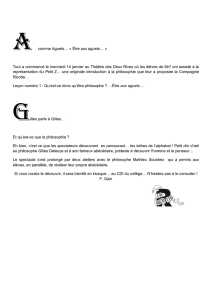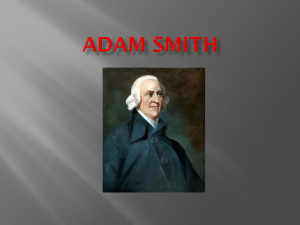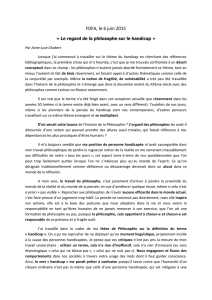Télécharger le texte intégral de Bruno Karsenti

Pour poser correctement le problème des rapports de la philosophie et des sciences
sociales — problème qui prend une importance grandissante en France et en Allemagne depuis
une quinzaine d’années — il me semble qu’il faut partir d’un constat simple : la philosophie a
une histoire longue, la sociologie a une histoire courte. Ce qu’on présuppose alors, en liant les
deux disciplines, c’est que l’histoire courte vient infléchir l’histoire longue, et dessiner les traits
pertinents de la modernité en termes de savoir. L’épistémé moderne peut donc être décrite à
partir de cette configuration. Plus encore, ce qui est en jeu, c’est une histoire de la modernité
tout court, c’est-à-dire des sociétés modernes où cette transformation a eu lieu, ces sociétés
où les sciences sociales sont apparues comme un savoir spécifique, socialement intéressant,
affecté d’une fonction particulière dans l’ordre social.
Bref, nous vivons dans des sociétés où les sciences sociales ont correspondu et
où elles continuent de correspondre à une volonté de savoir. De nouveau, résonne un motif
foucaldien, mais singulièrement infléchi puisqu’il correspond à un savoir que Foucault ne
considérait pas comme un prisme pertinent pour analyser la modernité. Une volonté de savoir
social, socialement distribuée, dont les sociétés modernes se nourrissent en se produisant
depuis deux siècles. Ou plutôt une volonté sociale de savoir social, dont il faudrait justement
discriminer socialement les modes et les porteurs effectifs (les individus, les sous-groupes,
les fonctionnaires publics, les publics se constituant autour de situations problématiques,
l’intelligentsia désancrée, ou au contraire les administrateurs civils et militaires, les journalistes,
les écrivains…), une volonté de savoir au sein de laquelle la sociologie elle-même prend place,
comme un mode de connaissance singulier, mais pas a priori coupé des autres et disposant du
privilège exclusif de la connaissance objective. C’est, après tout, ce que Bourdieu exprimait très
bien en disant que la sociologie est une science qui ne rompt pas comme les autres avec le sens
commun, précisément parce que le sens commun est un sens social. Ce à quoi, il faut ajouter, il
l’est de façon spécifique — ce que Bourdieu ne disait pas — dans la condition des modernes.
Qu’en résulte-t-il pour la philosophie — entendons, pour la pratique de la philosophie ?
Il en résulte l’émergence d’un genre (qui, une fois encore, me semble surtout être à l’honneur
en France et en Allemagne, même s’il ne procède pas des mêmes prémisses). Ces philosophes,
ce sont ceux qui ont bien à l’esprit la nouveauté du point de vue social, sur le plan historique
et philosophique. Cela signifie qu’ils prennent acte d’un déplacement qui s’est produit dans la
double zone de prérogatives philosophiques qui était demeuré intacte jusqu’au XVIIIème siècle :
la question de l’esprit humain (la question du sujet), et la question du gouvernement humain
(la question du pouvoir). Là encore, on retrouve un diptyque foucaldien, mais singulièrement
infléchi, puisque c’est depuis ce que font les sciences sociales que la transformation de ces
Bruno Karsenti
Le propre de la philosophie

deux thèmes est envisagée. Les lignes de forces de cette transformation sont les suivantes: sur
la pensée et sur l’action, au niveau psychologique et au niveau moral et politique, le point de vue
individualiste a cédé devant le point de vue social, ce qui a signifié un montée en pertinence
des questions relatives à la constitution sociale de l’individualité, aux déterminations sociales de
ses pensées et de ses actions, et des questions relatives à la constitution sociale des formes de
gouvernement, des droits subjectifs, des dispositifs législatifs.
Si les rapports sociaux viennent reconfigurer les problèmes philosophiques du sujet
et du pouvoir, alors le philosophe doit consentir à une forme, non pas de subordination, mais de
secondarité. C’est la conséquence la plus difficile à accepter dans la perspective que je décris.
Elle n’a pourtant rien de regrettable, et cela pour la philosophie elle-même. En acceptant de
recevoir ainsi une impulsion externe, le philosophe entre dans une nouvelle pratique théorique.
La confusion la plus grande serait de croire qu’il devrait se faire enquêteur, sociologue de
substitution. On a pu, et on peut sans doute encore enquêter en philosophe dans certains
domaines, mais il y a un domaine où enquêter en philosophe se heurte à une objection majeure,
et c’est précisément le monde social. Et cela parce que dès qu’il y a eu quelque chose comme
un « monde social », il y a eu une formation de savoir indépendante de la philosophie qui a pris
ce monde en charge. Le social n’a pas précédé comme niveau de réalité les sciences sociales
qui l’étudient. Il n’a pas d’abord été un champ pour philosophe, puis est devenu un champ pour
savants spécialisés. Il a pris forme au carrefour de plusieurs disciplines qui l’ont fait apparaître en
même temps qu’elles se constituaient comme disciplines (avec un rôle essentiel joué dans ce
cadre par l’économie).
Depuis deux siècles, le philosophe pour lequel les choses sociales importent, reçoit
forcément ses problèmes du dehors. Il re-formule dans son champ, s’exerce à fabriquer
autrement ses concepts par la prise en compte du social — non pas comme méta-concept
abstrait, mais comme réalité empirique décrite par quelqu’un d’autre, à savoir par le sociologue.
Par exemple, il cesse de penser l’État dans le sillage des théories juridico-politiques classiques
et dans leur reformalisation à l’aide des théories néo-contractualistes de la justice, mais suit
la conceptualisation de l’État formulée à partir des pratiques sociales qui le fabriquent et le
soutiennent en permanence, et mesure l’écart creusé dans une histoire plus longue du concept.
Bref, il défait ses catégories sous l’effet du point de vue sociologique, et les refait autrement.
Le sociologue conceptualise donc tout seul, et il n’a pas besoin d’aide pour
cela. Néanmoins, lui non plus ne sort pas indemne de cette mise en relation. La question
philosophique qui se pose à lui, c’est justement celle de la fabrication de concepts à l’échelle
de l’histoire de la modernité, à l’échelle de la forme de rapport à soi que les sociétés modernes
ont noué depuis deux siècles, et du type de réflexivité qu’elles se sont appliquées. Et cette
fabrication a deux grands registres : l’esprit (le sujet, l’individu, le statut de la pensée, etc…) et la
politique (la légitimation du pouvoir, la formation de l’autorité, la nature des lois…). C’est ainsi que

le philosophe second, le philosophe de l’après-coup que je décris, apporte au sciences sociales
quelque chose d’essentiel, qu’il est cette fois-ci le seul à pouvoir apporter : celle de leur histoire,
comme faisant partie de l’histoire des sociétés modernes. Celle de leur histoire, comme celle
d’un fait social singulier. Il faut le dire, au risque de froisser certaines susceptibilités : l’histoire
des sciences sociales, si elle se veut conceptuelle, doit être faite par des philosophes. C’est le
privilège qui leur échoit, en tant que philosophie seconde.
Les élèves du lycée Colbert (Lyon)
se sont eux aussi penchés sur le thème de la rencontre.
Retrouvez leurs recherches et leur édito sur le blog www.villavoice.fr
1
/
3
100%