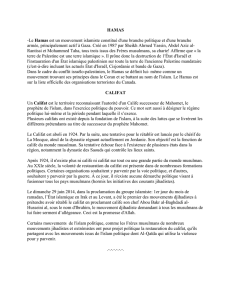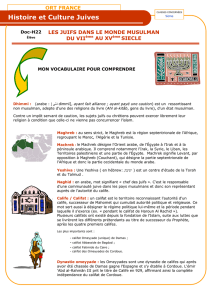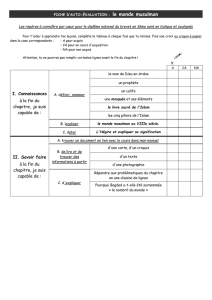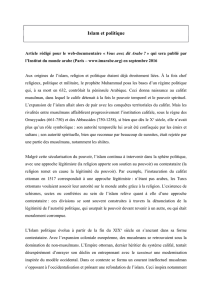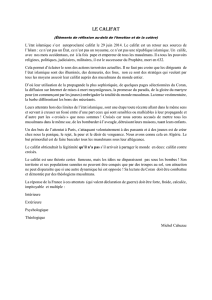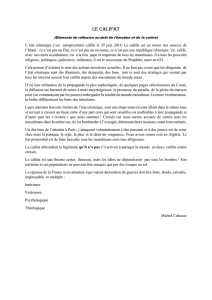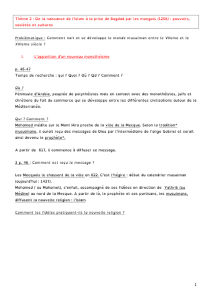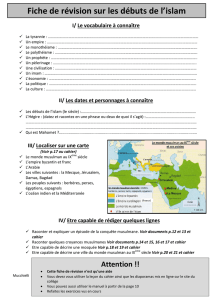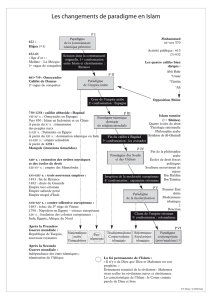L`idée de califat universel et de congrès islamique face à - Hal-SHS

L’id´ee de califat universel et de congr`es islamique face `a
la revendication de souverainet´e nationale et aux
menaces d’´ecrasement de l’empire ottoman
Jean-Fran¸cois Legrain
To cite this version:
Jean-Fran¸cois Legrain. L’id´ee de califat universel et de congr`es islamique face `a la revendication
de souverainet´e nationale et aux menaces d’´ecrasement de l’empire ottoman. Centre National
d’Enseignement `a Distance (CNED); Maison de l’Orient et de la M´editerran´ee, pp.114, 1986,
<http://www.mom.fr>.<halshs-00120036>
HAL Id: halshs-00120036
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00120036
Submitted on 5 Jan 2017
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.

L'idée de califat universel et de congrès
islamique face à la revendication de
souveraineté nationale et aux menaces
d'écrasement de l'empire ottoman.
À propos du Traité sur le califat de Rachîd Ridâ
Jean-François Legrain
Nouvelle édition, Lyon, Maison de l’Orient et la Méditerranée, 2006

© Jean-François Legrain, CNRS-Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 2006, pour cette
deuxième édition.
Source web : http://www.gremmo.mom.fr/legrain/califat.pdf
Première édition, Centre National d’Enseignement à Distance (CNED), septembre 1986, 114 p. dact.
Cours de préparation aux CAPES et agrégation d’Arabe (question d’histoire moderne et contemporaine).
Le texte de cette deuxième édition est le même que celui de l’édition d’origine, introuvable. Les
transcriptions ont été systématisées, les coquilles ont été corrigées et les notes renumérotées (l’édition
de 1986 avait été rédigée sur papier thermique avec une machine à écrire dotée d’une « mémoire vive »
d’une ligne... d’où les montages photocopiés et les corrections manuscrites). Un résumé a été ajouté,
argument d’une communication faite au CEDEJ (Le Caire) au printemps 1988.
2

Introduction.............................................................................................................6
Bibliographie sur Rachîd Ridâ .......................................................................................9
L'empire ottoman jusqu’en 1908................................................................................. 10
1 — Pénétration de l’occident....................................................................................... 10
Domination du capital étranger..................................................................................... 10
2 — Sultanat ottoman et titre califal au XVIIIe siècle.................................................. 13
Utilisation du titre califal au XVIe siècle........................................................................ 14
Le traité de Küçük Kaynarca (1774)............................................................................. 14
Mouradgea D’Ohsson et l’origine du califat ottoman.................................................... 15
D’Ohsson et les pouvoirs temporel et spirituel............................................................. 17
D’Ohsson et le traité de 1774....................................................................................... 18
Savvas Pacha............................................................................................................... 18
L’idée de pontificat musulman chez les Européens..................................................... 19
L’Encyclopédie.............................................................................................................. 19
Le comte de Saint-Priest.............................................................................................. 20
3 — Les tanzimat............................................................................................................ 21
Résistance à l’occident................................................................................................. 21
Premières réformes occidentalisatrices........................................................................ 22
Les tanzimat (1839-1876)............................................................................................. 22
Les Jeunes Ottomans................................................................................................... 24
Abdülaziz 1er la réaffirmation du titre califal ottoman................................................... 26
La Syrie ottomaniste..................................................................................................... 26
Beyrouth et la Nahda.................................................................................................... 30
Le séparatisme égyptien............................................................................................... 31
4 — Abdülhamit et le panislamisme............................................................................. 33
La constitution de 1876................................................................................................. 33
Despotisme et panislamisme........................................................................................ 34
Les émissaires et apologètes....................................................................................... 35
Jamâl Al-Dîn Al-Afghânî............................................................................................... 36
Le panislamisme comme protonationalisme................................................................ 40
5 — La montée du nationalisme turc et l’opposition à Abdülhamit.......................... 42
Les Tatars et la naissance du nationalisme turc.......................................................... 42
Émergence d’une identité turque dans l’empire ottoman............................................. 44
Les Jeunes Turcs......................................................................................................... 44
Ahmet Rıza. Les Jeunes Turcs et le califat.................................................................. 46
Union et Progrès........................................................................................................... 48
6 — Les Arabes sous Abdülhamit................................................................................ 49
Prospérité et développement en Syrie......................................................................... 49
L’opposition au sultan à Damas.................................................................................... 50
L’appel indépendantiste au mont Liban........................................................................ 51
L’Égypte asservie et la montée du nationalisme.......................................................... 52
7 — Congrès islamique et califat arabe....................................................................... 53
Muhammad "Abduh et Al-Manâr.................................................................................. 53
Rachîd Ridâ et le califat (1898).................................................................................... 55
Al-Kawâkibî et le califat arabe...................................................................................... 56
Azoury et la Ligue de la patrie arabe............................................................................ 60
Blunt et l’Avenir de l’islam............................................................................................. 61
Gasprinsky et le congrès musulman universel............................................................. 64
B — De l’ottomanisme aux nationalismes (1908-1924)......................................... 66
1 — Émergence du nationalisme turc dans l’empire.................................................. 66
La révolution des Jeunes Turcs.................................................................................... 66
La monarchie constitutionnelle d’Abdülhamit (1908-1909).......................................... 67
La démocratie constitutionnelle ottomane (1909-1911)............................................... 69
Ziya Gökalp et le nationalisme turc.............................................................................. 70
2 — De l’ottomanisme au nationalisme arabe............................................................. 72
Le cercle du cheikh Al-Jazâ’irî...................................................................................... 72
Al-Ikhâ’ Al-"Arabî Al-"Uthmânî...................................................................................... 73
Al-Muntadâ Al-Adabî..................................................................................................... 73
3

Le Parti de la Décentralisation...................................................................................... 74
Al-Qahtâniyya ............................................................................................................... 74
Al-Fatât......................................................................................................................... 75
Jam"iyyat Bayrût Al-Islâhiyya....................................................................................... 75
Le premier congrès arabe de Paris.............................................................................. 76
L’Irak et Al-"Ahd............................................................................................................ 76
Les Arabes et le califat................................................................................................. 77
3 — L’orient en guerre................................................................................................... 78
L’Égypte........................................................................................................................ 78
Damas durant la guerre................................................................................................ 78
4- L’enjeu du califat........................................................................................................ 79
La déclaration de jihâd.................................................................................................. 79
Les missions de mobilisation........................................................................................ 79
La vaticanisation du califat............................................................................................ 80
"Alî Al-Mirghânî et le califat chérifien............................................................................ 80
Mustafâ Al-Marâghî et le califat égyptien..................................................................... 81
Ubayd Allah Sindhi et son armée de Dieu.................................................................... 81
5 — La diplomatie des grandes Puissances ............................................................... 82
Correspondance Hussein-Mc Mahon........................................................................... 82
Les accords Sykes-Picot.............................................................................................. 83
La Déclaration Balfour.................................................................................................. 84
6 — La révolte arabe...................................................................................................... 84
Damas et la révolte arabe............................................................................................. 85
La chute de Damas....................................................................................................... 86
7 — L’occupation de la région...................................................................................... 86
Les projets de partage.................................................................................................. 87
8 — Fayçal à Damas et l’instauration du mandat........................................................ 87
Fayçal en Europe, la Palestine..................................................................................... 88
Al-Nâdî Al-"Arabî........................................................................................................... 89
Al-Fatât......................................................................................................................... 89
Hizb Al-Istiqlâl Al-"Arabî................................................................................................ 89
Al-"Ahd.......................................................................................................................... 89
Les divisions nationalistes............................................................................................ 90
Le congrès syrien......................................................................................................... 90
Les marchandages européens..................................................................................... 91
La Commission King-Crane.......................................................................................... 91
Fayçal seul face à la France......................................................................................... 92
San Remo et l’instauration des mandats...................................................................... 92
La chute du gouvernement arabe................................................................................. 93
Bilan du gouvernement Fayçal..................................................................................... 94
9 — Mustafa Kemal et la reconquête de la Turquie. ................................................... 94
10 — Mustafa Kemal et le califat................................................................................... 96
Le CUP et la ligue des sociétés islamiques révolutionnaires....................................... 96
Le nouvel État turc........................................................................................................ 97
L’abolition du sultanat................................................................................................... 99
Déchéance de Mehmet VI et désignation d’Abdülmecit............................................. 102
Les activités de Mehmet VI en exil............................................................................. 103
Rachîd Ridâ et le califat.............................................................................................. 105
Le mouvement du Khilafat en Inde............................................................................. 105
Proclamation de la république turque......................................................................... 107
Zia Gökalp et le califat................................................................................................ 107
Abolition du califat....................................................................................................... 108
Réaction d’Abdülmecit................................................................................................ 109
Réaction de Mehmet VI.............................................................................................. 110
Réaction de Hussein................................................................................................... 111
Réaction en Égypte.................................................................................................... 111
Annexe 1 - Cheikh Ali 'Abd al Râziq et ses sept propositions condamnées............. 115
Annexe 2 - Les chiites en Irak et l’Empire ottoman depuis l’avènement de
Abdülhamit II jusqu’à l’abolition du califat en 1924 ..................................................... 117
L’Irak, marche ottomane aux confins de l’Empire....................................................... 117
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
1
/
125
100%