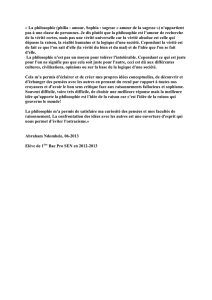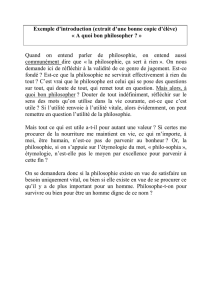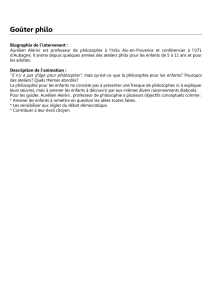Diaporama - Café

1. Étymologie / Définitions
2. Notions / Concepts / Prise de vue:
L’émergence du discours rationnel en quête de la vérité .
Place de la philosophie par rapport à la religion, à la science et aux valeurs.
3. Questions / Discussion : 3 questions, 20 mn environ par question.
4. En guise de conclusion
Réunion préparée avec
Nicole Poupon et Bernard Maréchal

Étymologie et définitions
Étymologie :
Philosophie vient du grec philosophia,de philein, aimer et sophia, qui signifie sagesse mais aussi
science. Amour de la sagesse ou amour de la science ? Ethique ou connaissance théorique ?
Etymologiquement le terme Philosophie est ambigu.
Définitions :
Larousse sur internet :
Ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme
dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la
métaphysique.
Système d'idées qui se propose de dégager les principes fondamentaux d'une discipline :
Philosophie des sciences.
Doctrine, système d'un philosophe, d'une école, d'une époque : La philosophie d'Aristote.
Manière de voir, de comprendre, d'interpréter le monde, les choses de la vie, qui guide le
comportement : Chacun a sa philosophie.
Constance résignée devant les avatars de l'existence, sagesse acquise avec l'expérience des
difficultés.
Synonymes : Morale, éthique, métaphysique, doctrine, école, idées, idéologie, position, thèse.
Dictionnaire philosophique d’André Comte-Sponville :
La philosophie n’est pas une science, ni même une connaissance (ce n’est pas un savoir de plus, c’est
une réflexion sur les savoirs disponibles), et c’est pourquoi, comme disait Kant, on ne peut apprendre la
philosophie : on ne peut apprendre qu’à philosopher.

Notions / Concepts / Prise de vue
A. La philosophie en tant qu’émergence du discours rationnel en quête de la vérité :
La philosophie est d’abord le discours d’un certain type : le discours rationnel (logos) qui cherche à
répondre par des arguments à un problème explicitement posé.
Ce type de discours est historiquement situé : il a commencé à se développer en Grèce au VIIe et
VIe siècle av JC en supplantant progressivement le mythe.
Les premiers philosophes grecs (Thalès / Anaximandre… / école de Milet) ont introduit
simultanément deux grands changements :
oL’usage de la raison, sans faire appel à la religion, à la révélation, à l’autorité ou à la
tradition, pour tenter de comprendre le monde.
oLa nécessité de penser par soi-même pour tenter d’atteindre la vérité, d’où l’émergence
du débat d’idées en lieu et place de l’enseignement de type dogmatique.
Philosopher est-ce ériger la rationalité en moyen, norme et critère de la vérité ?
B. Philosophie et religion :
Pour la religion, la vérité est d’abord révélée dans les Ecritures, et non pas découverte par l’effort
autonome de l’esprit rationnel.
De là deux solutions semblent alors possibles :
oLe discrédit total porté sur la philosophie ou la rationalité en général.
oAu mieux, une subordination de la philosophie qui se met au service de la théologie, ce qui
sera notamment le cas au Moyen-âge.
Philosophie et religion sont elles incompatibles ou complémentaires ?

Notions / Concepts / Prise de vue
(suite)
Philosophie et science sont elles incompatibles ou complémentaires ?
La philosophie n’est-elle pas à la fois :
• Un instrument critique par l’usage de la raison d’une pensée en quête de la vérité
•Et une interrogation sur le sens et la valeur de la condition humaine sur lesquels
aucune science ne pourra jamais nous renseigner ?
C. Philosophie et science :
Si le XVIIe siècle est celui qui, avec Descartes et Spinoza, libère la philosophie de la tutelle
théologique, c’est aussi le siècle ou la science moderne prend son essor et son autonomie
(jusqu’au milieu du XVIIIe siècle la science expérimentale s’appellera philosophie naturelle que l’on
distinguait de la philosophie morale).
De là naitra une nouvelle contestation de la philosophie, inverse de celle opérée par la religion,
puisqu’il va lui être alors reproché de ne pas donner à la raison toute sa positivité.
Deux voies semblent alors s’ouvrir pour sauver la légitimité de la réflexion philosophique :
oLa première (explorée notamment par Bergson) selon laquelle, à côté des sciences qui
s’occupent de la matière et se fondent sur l’intelligence, la philosophie existe par son objet
propre, l’esprit et sa méthode, l’intuition.
oLa seconde est celle du positivisme selon laquelle c’est à la philosophie qui n’a pas d’objet
propre (aucun champ en soi n’échappe a priori aux sciences) que revient d’unifier les
différents domaines scientifiques (cf Auguste Comte) ou bien, comme le disait Wittgenstein,
de clarifier le langage de la science.
D. Philosophie et valeur :
La philosophie n’est-elle pas moins concernée par les faits (la vérité) que par les valeurs,
(l’éthique, la morale, la sagesse, le bonheur) ?
Les développements de la science n’appellent-ils pas aujourd’hui la réflexion philosophique au
sens éthique/moraliste du terme ?

QUESTIONS
1. La philosophie, pourquoi faire ?
2. La philosophie s’apprend-elle ?
3. La philosophie est-elle une thérapie ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%