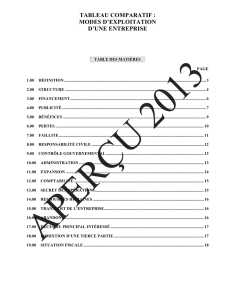Diaporama - Café

1. Etymologie / Définitions
2. Notions / Concepts :
Tour d’horizon et terminologie des principales morales
L’ordre de la morale selon André Comte-Sponville
3. Questions / Discussion
4. En guise de conclusion
Choix des sujets du deuxième trimestre
Réunion préparée avec Brigitte Kos, Hélène Mouraret,
Elyane Duquenne et Michel Rumeau

Etymologie et définitions
Etymologie :
Du latin « mores » mœurs ou plus particulièrement de « moralis » chez Cicéron (106-43 av JC)
qui traduit « éthos » en grec d’où est venue éthique, ce qui tend à montrer qu’entre morale et
éthique, étymologiquement, la frontière est ténue.
Définitions :
Petit Robert :
Science du bien et du mal; théorie de l’action humaine en tant qu’elle est soumise au devoir et
a pour but le bien.
Dictionnaire de Philosophie (Gaudin) :
Partie de la philosophie qui a pour objet les lois et les règles de l’action bonne et qui a
une prétention à l’universalité. La morale définit le bien et le mal, ainsi que les moyens d’y
parvenir.
Alors que la morale prétend légiférer pour l’ensemble des êtres raisonnables, l’éthique se
particularise en points de vue (éthique épicurienne, stoïcienne, sexuelle, professionnelle). La
substitution de l’éthique à la morale qui entraîne le remplacement du bien par le bon, témoigne
du triomphe de l’individualisme contemporain.

Notions / concepts : Tour d’horizon
1. Les principaux types de morale :
•Morale du plaisir : Celle qui, comme la cyrénaïque ou l’épicurienne (plus ascétique et plus
connue), identifie le bon à l’agréable (synonyme d’hédonisme). On peut classer la morale de
Michel Onfray dans cette catégorie.
•Morale stoïcienne : C’est celle de la vertu et non celle du plaisir. Seule la vertu vaut
absolument car tout ce qui ne dépend pas de nous est moralement indifférent et seul ce qui
en dépend peut être bien ou mal.
•Morale du devoir : Morale définissant le bien comme l’accomplissement du devoir (et non
comme la recherche du bonheur ou du plaisir). La morale de Kant est une morale du devoir.
Elle est pur respect de la loi. Elle est aussi une morale répondant aux exigences de la raison.
•Morale de l’intérêt :Morale qui définit le bien par le bon, l’avantageux, et qui repose sur le
postulat que l’intérêt commun est l’agrégation de la multitude des intérêts individuels. La
morale selon Darwin :
« survie et développement de l’espèce »
et la morale selon Durkheim :
« intérêts de la société
»peuvent être rangées dans cette catégorie.
•Éthique de l’amour : Amour de l’humanité ou du
« prochain »
comme disent les chrétiens.
L’amour n’est pas strictement une morale, c’est plutôt ce qui l’éclaire et donne sens aux
vertus. C’est l’éthique de Jésus, du Dalaï-Lama, de Spinoza, de l’abbé Pierre …. et aussi de
Comte-Sponville qui est athée.
De façon provocante, Nietzsche qualifie cette éthique de morale des esclaves par opposition
à la morale des maîtres dans laquelle c’était respectivement le fort et le faible qui qualifiait le
bon et le mauvais pour le remplacer par le bien et le mal déterminés par l’humilité et l’orgueil.

Notions / concepts : Tour d’horizon (suite)
2. Quelques autres formes de morale :
•Morale de l’intention :Doctrine qui fait dériver la valeur morale des actions, non de leur
résultat. Kant est le représentant classique de ce type de morale.
•Morale provisoire : Pour Descartes, il faut douter avant d’agir (c’est le doute hyperbolique
qui conduit à la vérité). Mais, comme l’action n’attend pas, il faut bien une morale
provisoire
( Obéir aux lois et coutumes du pays / Être ferme et résolu dans la manière
d’agir / Tâcher de se vaincre soi-même plutôt que la fortune (le hasard, ce qui ne dépend
pas de soi) / Cultiver sa raison),
en attendant l’élaboration d’une morale personnelle fondée
sur le bon sens.
•Morale close : Morale fondée sur l’obligation que la pression sociale impose par
conformisme pour Bergson par opposition à la morale ouverte fondée sur l’aspiration,
ouverte sur la vie, et possédant de ce fait une dimension mystique.
•Morale de la responsabilité : Max Weber (1864-1920) appelle ainsi celle qui prend en
compte la rationalité des fins et non seulement, comme la morale de conviction, la force des
principes.
•Morale du sentiment : Morale qui par opposition aux morales rationnelles et aux morales
utilitaires, fait reposer les valeurs et comportements moraux sur l’impression immédiate de
sympathie (considérée comme universelle).
•Morale de situation : Conception selon laquelle la moralité consiste à se déterminer
d’après les données complexes de chaque cas particulier, et non d’après des lois générales.

Notions / concepts : L’ordre de la morale selon Comte-Sponville
Les ordres :
Un ordre est un ensemble homogène et autonome, régi par des lois, se rangeant à un
certain modèle, d’où dérive son indépendance par rapport aux autres ordres.
A l’instar de Pascal qui identifiait 3 ordres : l’ordre du corps, l’ordre de l’esprit (la raison), l’ordre
du cœur (la charité), Comte-Sponville
« Le capitalisme est-il moral »
identifie 4 ordres :
1. Techno-économico-scientifique : C’est l’ordre du vrai ou faux, du possible ou de
l’impossible.
2. Juridico-politique : C’est l’ordre du juste ou de l’injuste, du légal ou de l’illégal.
Des lois peuvent y prescrire racisme et xénophobie. Individuellement, on peut y
être
« un salaud parfaitement légaliste »
: méchant, égoïste, menteur, haineux…
3. Moral : C’est l’ordre du bien ou mal, du
« Que dois-je faire ? »
et de la pratique
des vertus (1) qui permet d’échapper au spectre du
« salaud légaliste »
.
Il en va de la liberté de chacun que cet ordre soit strictement personnel.
4. Éthique : Ce n’est pas vraiment un ordre. C’est plutôt un sens, un « phare » qui
éclaire l’ordre moral. Pour C-S, l’éthique c’est l’amour :
« Faire son devoir moral
en le respectant à la lettre, ce n’est pas suffisant, c’est être un « pharisien », celui
à qui il manque l’amour »
(1) Les 18 vertus de A.C-S
« Petit traité des grandes vertus »
: (Politesse), fidélité, prudence, tempérance, courage,
justice, générosité, compassion, miséricorde, gratitude, humilité, simplicité, tolérance, pureté, douceur, bonne
foi, humour et (amour).
En orange, les vertus cardinales de l’antiquité.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%