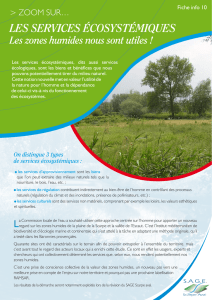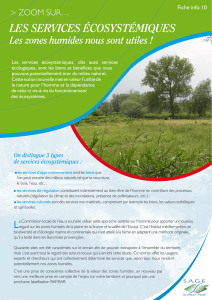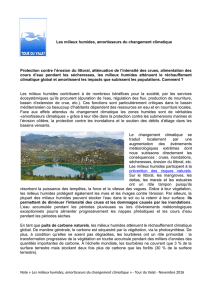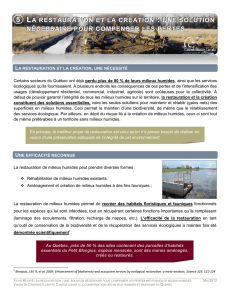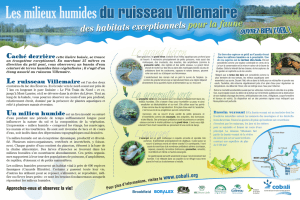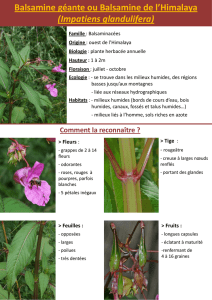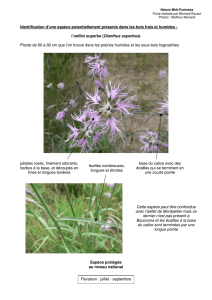Que cette mesure d`urgence serve de leçon

MÉMOIRE
PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC,
COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT
DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE LOI N°71 :
LOI CONCERNANT DES MESURES DE COMPENSATION POUR LA
RÉALISATION DE PROJETS AFFECTANT UN MILIEU HUMIDE OU HYDRIQUE
QUE CETTE MESURE D’URGENCE SERVE DE LEÇON :
LE QUÉBEC DOIT SE DOTER, DANS LES MEILLEURS
DÉLAIS, D’UNE VRAIE LOI DE PROTECTION DES
MILIEUX HUMIDES
Mai 2012
PAR

Nature Québec, 2012 (mai).
Que cette mesure d’urgence serve de leçon : le Québec
doit se doter, dans les meilleurs délais, d’une vraie loi de
protection des milieux humides . Mémoire présenté à
l’Assemblée nationale du Québec, commission des
transports et de l’environnement, dans le cadre de la
consultation générale sur le projet de loi no 71, loi
concernant les mesures de compensation pour la
réalisation de projets affectant un milieu humide ou
hydrique, 15 pages + annexe.
Rédaction
Christian Simard, directeur général
Crédits photographiques (page couverture)
© Charles-Antoine Drole
ISBN 978-2-923731-76-6 (document imprimé)
ISBN 978-2-923731-77-3 (document PDF)
© Nature Québec, 2012
870, avenue De Salaberry, bureau 207, Québec (Québec) G1R 2T9

iii
Que cette mesure d’urgence serve de leçon :
le Québec doit se doter, dans les meilleurs délais, d’une vraie loi de protection des milieux humides
Mémoire présenté à l’Assemblée nationale du Québec,
dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi no 71, loi concernant les mesures de
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (mai 2012)
Table des matières
INTRODUCTION ...................................................................................... 1
DE L’IMPORTANCE DES MILIEUX HUMIDES AU QUÉBEC ........................ 3
Des écosystèmes remarquables ........................................................................ 3
UN ENCADREMENT LÉGISLATIF DÉFICIENT ............................................. 5
Au Québec, l’absence de définition légale et d’encadrement réglementaire
favorise la destruction des milieux humides .......................................................... 6
Des brèches majeures dans la loi ........................................................................... 7
Une stratégie à revoir en profondeur ............................................................... 8
LE PROJET DE LOI 71 : UN CONSTAT D’ÉCHEC DE L’APPROCHE DU
MINISTÈRE ........................................................................................... 10
Le projet de loi 71 : une mesure d’urgence qui doit nous servir de leçon et
nous permettre d’avancer ................................................................................... 10
RECOMMANDATIONS .......................................................................... 11
CONCLUSION ........................................................................................ 14
PUBLICATIONS DE NATURE QUÉBEC SUR LES MILIEUX HUMIDES ......... 15
ANNEXE :
Les milieux humides dans le sud du Québec : entre destruction et protection.
Analyse critique et élaboration d’une stratégie de conservation.

1
Que cette mesure d’urgence serve de leçon :
le Québec doit se doter, dans les meilleurs délais, d’une vraie loi de protection des milieux humides
Mémoire présenté à l’Assemblée nationale du Québec,
dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi no 71, loi concernant les mesures de
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (mai 2012)
INTRODUCTION
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs présente en coup de vent, en fin
de session, un projet de loi visant à maintenir la légalité de centaines de certificats d’autorisation
concernant des milieux humides émis depuis le 8 janvier 2008 en vertu des articles 22 et 32 de la Loi sur
la qualité de l’environnement. Le projet vise également à donner un caractère légal, pour une période de
transition d’au moins 2 ans, à directive interne prévoyant des mesures de compensation, directive qui a
été en grande partie invalidée par un jugement récent (Les Atocas de l’érable vs Procureur général du
Québec, 12 mars 2012). Voici ce que dit le juge à propos de l’emploi de directives internes par une
Administration :
Une société comme la nôtre, régie par la règle de droit, doit demeurer
vigilante lorsque l’administration invoque des directives sans statut
juridique dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir décisionnel ou
lorsqu’il s’agit de déterminer l’aire d’application d’une loi. Lorsqu’on
compare l’encadrement juridique et procédural qui régit l’élaboration,
l’adoption et la publication d’un règlement au flou qui s’applique lors de
l’adoption, de la rédaction, de la publicité, de l’entrée en vigueur et de
la durée de vie des directives, on comprend que ces instruments peuvent
difficilement assurer une sécurité juridique satisfaisante aux citoyens.
Le jugement Dallaire est dévastateur dans ses conclusions sur la validité de l’approche et de
l’encadrement légal sur lesquels s’appuyait jusqu’à aujourd’hui l’action du ministère de du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Il « déclare nulle et de nul effet la directive
no 06-01 et de ses annexes dont l’application d’une compensation comme condition à la délivrance du
certificat d’autorisation ». De plus, le jugement rend illégal le fait de chercher à ce que le
promoteur « évite » de se développer dans des milieux humides. Le juge précise face à « l’évitement »
que « la directive quant à cet aspect est illégale » (op.cit. paragraphe 139).
On comprend que le projet de Loi 71 vise à réintroduire le caractère légal de la compensation minimale
exigée jusqu’à maintenant d’un promoteur qui détruit des milieux humides, MAIS elle ne réintroduit pas
le premier pilier de la directive qui en compte trois : éviter, minimiser, compenser. Est-ce à dire que la
directive interne qui accompagnera le projet de loi a été changée ? A-t-on abandonné toute volonté ou
toute possibilité de chercher à atteindre « zéro perte nette de milieux humides » en cherchant à
convaincre le promoteur de ne pas empiéter sur un milieu humide ? Peut-on déposer à cette commission
la directive interne qui accompagnera la présente loi ? Ne peut-on pas réintroduire cette possibilité dans
le présent projet de loi pour ne pas régresser par rapport à la situation actuelle en attendant une vraie
politique de protection ? Nous reviendrons à ces questions.
Depuis longtemps, Nature Québec et plusieurs autres groupes de conservation s’inquiètent du fait que
les milieux humides ne soient pas clairement définis dans la loi sur la qualité de l’environnement et qu’ils
ne fassent pas l’objet d’une politique de protection légale et réglementaire spécifique. On nous a

2
Que cette mesure d’urgence serve de leçon :
le Québec doit se doter, dans les meilleurs délais, d’une vraie loi de protection des milieux humides
Mémoire présenté à l’Assemblée nationale du Québec,
dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi no 71, loi concernant les mesures de
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (mai 2012)
toujours répondu que, dans les faits, cette politique existait « virtuellement » et était appliquée à
l’interne, et qu’elle avait le même effet de protection légale qu’une politique officielle…
Le 4 avril 2011, Martin Joly, du MDDEP, nous confiait lors d’une rencontre que la politique concernant la
protection des milieux humides n’a jamais été diffusée, mais qu’elle est bien mise en place à l’interne. Le
MDDEP se défendait également et répondait aux accusations de complaisance en expliquant que les
projets irrecevables sont modifiés ou abandonnés avant même le dépôt de la demande, et que c’est pour
cette raison que les autres sont autorisés. Aucune donnée, à notre connaissance, ne vient étayer cette
affirmation.
Dans les faits, il apparaît que cette directive interne, non accessible au public, était considérée, même
par le Ministère, comme une mesure transitoire. Ainsi le jugement Dallaire nous apprend qu’en amorce
de cette directive en application depuis le 30 novembre 2006 (bientôt 6 ans), on peut lire :
En attente d’une politique sur les milieux humides en préparation ; en
accord avec des principes de cette politique en élaboration et pour
adapter les mesures et les conditions d’autorisation aux réalités diverses
de protection et de gestion durable des milieux humides, il est convenu ;
Nature Québec ne s’oppose pas à l’adoption de ce projet de loi « correcteur », mais nous croyons qu’il
doit absolument être amélioré, notamment à l’article 4, pour donner une date butoir solide au
gouvernement pour enfin adopter un cadre légal et réglementaire qui ait des dents pour protéger les
derniers milieux humides du sud du Québec. Nous croyons également qu’il doit chercher à réintroduire la
notion d’évitement pour éviter un recul important face à une situation déjà très insatisfaisante.
Après une première partie où nous reviendrons sur l’importance de protéger ces milieux naturels
essentiels, nous reviendrons en deuxième partie sur nos recommandations à très court terme (pour ce
projet de loi) et à moyen terme.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
1
/
84
100%