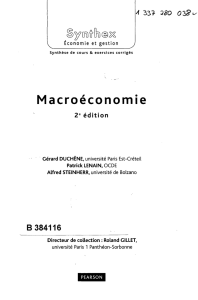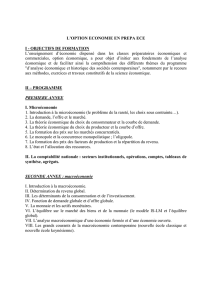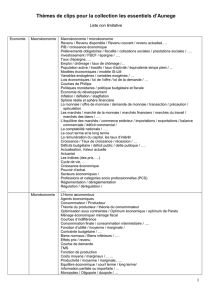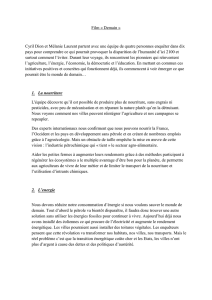Vers l`économie soutenable

CHANTiERS
de l’Institut pour le développement de l’information économique et sociale
LES
1
H
erman Daly a observé il y a
déjà fort longtemps, dans
l’introduction à son ouvrage classique
Steady-State Economics (1977),
toute la faiblesse d’une science éco-
nomique qui peine à reconnaître que
certains problèmes d’économie
politique ne possèdent aucune solu-
tion d’ordre technique ou scientifique,
mais bel et bien une solution d’ordre
moral. Le terme de « développement
durable » pointe un tel problème,
ou plutôt tout un nœud de pro-
blèmes imbriqués les uns dans les
autres, quels que soient les efforts
pour broyer la question dans le jar-
gon mathématique. « Si le para-
digme sous-jacent et les valeurs
qui le sous-tendent ne changent
pas, affirme Daly, aucune habileté
technique ni intelligence manipu-
latrice ne pourra résoudre nos
problèmes; en réalité, elles vont
encore les aggraver. »
Avouons que c’est à la fois du bon
sens et une position radicale qui,
sans nous dispenser des efforts théo-
riques ni des exercices chiffrés, nous
invite néanmoins à nous départir des
faux espoirs de pouvoir confier toute
la question au vieux couple « expert–
politique », le premier livrant au
La sortie du paradigme productiviste passe aussi par
l’élaboration de nouveaux outils capables d’orienter
les politiques publiques et l’économie dans son ensemble dans
le sens de la soutenabilité. Quel rôle peuvent jouer les nouveaux
indicateurs de richesse ou les instruments monétaires qui
privilégient l’échange sur l’accumulation ? Comment intégrer
les limites de la biosphère dans la macroéconomie et dépasser
le débat entre croissance et décroissance ?
Vers l’économie soutenable
RENCONTRES DE L’IDIES 2011
NOTE DE TRAVAIL N°22
MARS 2012
Du développement durable
à l’économie d’état stationnaire
Wojtek Kalinowski,
INSTITUT VEBLEN POUR LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES
www.idies.org
second, clefs en main, les politiques
publiques à conduire. C’est déstabi-
lisant pour les deux, tant ils se sont
habitués l’un à l’autre, mais un chan-
gement systémique ne se décrète
pas ; or, si la transition social-
écologique veut dire quelque chose,
c’est bien une transformation sociale
profonde, celle des rapports sociaux,
des valeurs et des habitudes de la
vie quotidienne, à un degré qui pour-
rait surprendre les tenants de la
«croissance verte ».
Ce mot de précaution vaut égale-
ment pour les efforts visant à
construire une macroéconomie de la
durabilité: il ne s’agit là que d’expli-
citer nos choix collectifs en les pro-
jetant dans le temps et à l’échelle «
macro », tout le travail politique pour
les voir réalisés reste encore à accom-
plir. A titre d’exemple, à supposer
même que nous arrivions un jour à
mesurer les flux de matière et d’émis-
sions incorporés dans les produits et
services, tout au long de la chaîne de
valeur jusqu’au recyclage – au
TABLE RONDE ANIMÉE PAR SANDRA MOATTI, IDIES
lll

Vers l’économie soutenable
2
NOTE DE TRAVAIL N°22
MARS 2012
lieu de nous satisfaire des don-
nées brutes de consommation domes-
tique et des importations–, une telle
comptabilité des flux de matière-
énergie ne serait qu’un outil, la vraie
solution serait de savoir s’en servir.
LA QUESTION
DE L’ÉCHELLE
La question vaut néanmoins qu’on
s’y attarde : à quoi ressemblerait et à
quoi servirait une macroéconomie de
la transition sociale et écologique?
Les classiques d’économie écologique
comme Joshua Farley,
Robert Constanza ou
H. Daly répondent
qu’ils ne font qu’ajou-
ter, aux deux notions
clés de la science éco-
nomique que sont
l’allocation et la distri-
bution, une troisième,
celle de l’échelle, de la
« taille» de l’économie
dans son ensemble
par rapport à la bios-
phère et les écosys-
tèmes dans lesquels
elle fonctionne. A une
structure de distribu-
tion donnée, le mar-
ché parfait des écono-
mistes allouera les
ressources de façon
optimale (selon la
définition de Pareto),
mais ce n’est pas le
marché qui pourra
établir une structure
de distribution « opti-
male » ; celle-ci pré-
suppose des critères éthiques exté-
rieurs. De même, à toute échelle
donnée, le marché parfait imaginé par
les économistes pourra allouer les
ressources de façon optimale, mais ce
n’est pas le marché qui peut détermi-
ner la question de l’échelle optimale;
celle-ci présuppose des critères éco-
logiques exogènes.
Arriver à intégrer la question de
l’échelle dans la macroéconomie, c’est
bien l’objectif affiché des chercheurs
comme ceux que nous venons d’évo-
quer. D’après Tim Jackson (1), le but
de l’exercice est d’explorer les aspects
suivants : le comportement d’une
économie soumise à des objectifs
exogènes d’émissions et d’usage des
ressources naturelles ; le potentiel d’un
ratio investissement/consommation
élevé ; le rôle de l’investissement public
et de la consommation publique ; la
stabilité d’une économie dont
la consommation privée ne croît que
lentement, voire pas du tout ; la sta-
bilité d’une économie dont la demande
agrégée ne croît que lentement, voire
pas du tout.
Admettons que ce travail de modé-
lisation n’en est qu’à ses débuts, et
même que les premiers résultats ne
sont pas entièrement satisfaisants.
Toujours est-il que le point de départ,
la critique de la comptabilité nationale
actuelle, est valable. En mesurant la
demande agrégée (consommation
privée, dépenses publiques, investis-
sement), explique Jackson, nous ne
distinguons pas assez les différents
types de matières et d’énergie utilisés,
et le même problème se pose du côté
des facteurs de production. Si la crois-
sance n’est pas séparable de la crois-
sance physique, et si les limites
physiques se manifestent de plus en
plus clairement, ne faut-il pas chercher
un modèle de développement qui
assure la qualité de vie et l’emploi sur
une autre base que la croissance, ou
en partant de l’hypothèse d’une crois-
sance structurellement limitée ?
L’une des rares tentatives concrètes
pour modéliser un tel scénario a été
réalisée par un groupe de chercheurs
autour de l’économiste canadien Peter
Victor (2), une autre est actuellement
menée par la New Economic Founda-
tion au Royaume-Uni. Dans le cas
canadien, le modèle puise ses para-
mètres dans les données de la comp-
tabilité nationale et simule l’évolution
du PIB, de la balance fiscale, du chô-
mage, mais aussi des émissions de gaz
à effet de serre, de la pauvreté, des
inégalités mesurables, etc. Il permet
d’évaluer les implications économiques
des limites exogènes imposées à
l’usage des ressources naturelles, de
mesurer l’impact économique du
changement des écosystèmes, de
distinguer différentes formes d’énergie,
etc. Plus généralement, il tente de
rompre avec l’idée que les facteurs de
production sont substituables, lui
préférant une substituabilité limitée
ou bien une complémentarité des
différentes ressources. Ce point est
crucial, car la réponse des économistes
classiques à l’économie écologique
est de dire que la rareté est toujours
relative, jamais absolue : une ressource
devenue plus rare sera remplacée par
une autre. Une macroéconomie de la
durabilité doit au contraire partir de
la rareté absolue.
Le modèle de Victor débouche sur
plusieurs scénarios pour la période
étudiée (2005-2035) ; dans le scénario
« catastrophe », les limitations
physiques « cassent » la croissance et
génèrent des dommages collatéraux
sociaux colossaux, avec un taux de
chômage qui grimpe et des inégalités
sociales qui se creusent rapidement.
Dans le scénario « résilience», en
revanche, une stabilisation des émis-
sions est obtenue tout en préservant
l’emploi et réduisant les inégalités.
Qu’est-ce qui différencie ces deux
scénarios ? Deux variables, surtout : la
structure de l’investissement et le
partage du temps de travail. Dans le
scénario «résilience», l’investissement
privé baisse progressivement au pro-
fit des investissements publics ; comme
l’explique Victor, la transition écolo-
gique nécessite des investissements
de long terme gérés par les acteurs
publics, les acteurs privés préférant
d’autres types d’investissements, plus
profitables à court et moyen termes.
Quant au partage du temps de travail,
c’est la variable clé pour partager les
efforts liés à la transformation du tissu
économique et l’extinction progressive
du « moteur croissance ».
Il va sans dire que ces scénarios
«macro » reposent sur des présup posés
forts au niveau microéconomique: le
partage du travail ne sera
“LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
NÉCESSITE DES
INVESTISSEMENTS
DE LONG TERME
GÉRÉS PAR LES
ACTEURS PUBLICS,
LES ACTEURS PRIVÉS
PRÉFÉRANT DES
INVESTISSEMENTS
PLUS PROFITABLES
À COURT ET
MOYEN TERMES.”
lll
lll
1.Prosperity without Growth:
Economics for a Finite Planet,
[Tr. Française : Prospérité
sans croissance : La
transition vers une économie
durable, De Boeck 2010].
2. Managing Without
Growth: Slower by Design,
Not Disaster, Edward Elgar
Pub, 2008.

CHANTiERS
de l’Institut pour le développement de l’Information économique et sociale
LES
3
NOTE DE TRAVAIL N°22
MARS 2012
“L’ÉCONOMIE NE
TOURNE PAS DANS
LE VIDE, ELLE EST
INSÉRÉE DANS UNE
BIOSPHÈRE AVEC
LAQUELLE ELLE
INTERAGIT SANS
CESSE, EN
PRÉLEVANT TOUT
CE QU’IL Y A
À PRÉLEVER ET
REJETANT TOUT
CE QU’IL Y A
À Y REJETER.”
réellement possible qu’avec un
marché du travail fondé sur la mobi-
lité sécurisée, capable de mieux appa-
rier l’offre et la demande que ce n’est
le cas actuellement, ce qui exige à son
tour un faible niveau d’inégalités au
départ, etc. Une réduction radicale du
temps travail est par ailleurs indisso-
ciable du passage de l’idéal du plein-
emploi à la « pleine-activité » (pour
reprendre un terme des années 1990),
où le temps libéré est consacré à la
coproduction de certains services
sociaux, aux activités locales d’utilité
publique, etc.
Sans aller plus en détails dans ce
débat, rappelons simplement la vision
générale dans laquelle ces efforts de
modélisation s’inscrivent. L’enjeu d’une
« autre » macroéconomie soulève en
réalité une double question: qu’est-ce
qu’une économie soutenable, au juste?
D’autre part, quels sont les outils pour
transformer l’économie dans le sens
de la durabilité ? Les deux questions
sont étroitement liées, car pour
construire un outil, il faut savoir à quoi
il doit servir.
« LA NAVETTE
SPATIALE TERRE »
Les outils de la transition écologique
ne manquent pas : l’écologie indus-
trielle élabore des boucles du «méta-
bolisme territorial », les entreprises
explorent le potentiel de l’économie
de fonctionnalité, les nouveaux indi-
cateurs mettent au défi le statut domi-
nant du PIB comme clef de lecture du
progrès, les propositions fleurissent
en matière de fiscalité verte et de
quotas d’émission, la restauration
collective découvre l’intérêt des circuits
courts alimentaires, les outils de tra-
çabilité permettent de gérer le cycle
de vie des produits tout au long de la
chaîne, les adeptes des « Commons»
d’Elinor Ostrom opposent la gestion
locale et participative des biens com-
muns aux solutions « tout marché »
mais aussi au « tout Etat »…
Parce qu’il présuppose des citoyens
actifs et désireux de prendre en main
leur destin, ce dernier exemple fait le lll
lll
lien avec un autre type d’outils, à savoir
toutes ces innovations locales menées
par des hommes et des femmes qui
inventent, bon gré mal gré, des modes
de vie nouveaux, souvent dans un
cadre contraignant et en s’attirant des
regards amusés de la société environ-
nante. Après le slow food, les slow
cities ; après le commerce équitable,
les « consomm’acteurs » et les objec-
teurs de croissance ; après les Agen-
da21, les collectifs « Villes en transi-
tion» préparant la vie après le pétrole,
etc. Les économistes s’y intéressent
rarement, mais si l’analyse de H. Daly
est juste, alors nous avons besoin de
tenir ensemble les différentes échelles
du changement social.
Quoi qu’il en soit, ce foisonnement
d’idées « macro » et « micro », au
centre et à la périphérie, témoigne
à sa façon d’une certaine frustration
devant les approches actuelles du
développement durable, et des résul-
tats accomplis en la matière. Vingt
ans après la première conférence de
Rio et vingt-cinq ans après la publi-
cation du rapport Brundtland, les
doutes percent jusqu’au mainstream
de la pensée économique. Aussi le
représentant d’un des « fleurons »
de l’industrie française, François
Grosse de Veolia Environnement,
reconnaît-il qu’« à très long terme
l’idée d’une décroissance matérielle
est incontournable, dans la mesure
où nous vivons dans un environne-
ment physiquement limité et que
les ressources de notre planète ne
sont pas inépuisables ». Certes, l’aveu
est suivi aussitôt des assurances que
« la perspective d’une décroissance
reste aujourd’hui extrêmement
éloignée et nous sommes bien en
peine d’imaginer à quoi elle ressem-
blera. Car il y a dans cette idée des
points cruciaux qui interrogent les
fondements mêmes de l’économie:
comment imaginer par exemple de
faire tourner une économie,
de motiver les diérents acteurs à
investir, à immobiliser du capital,
sans ‘‘récompense’’ à court ou moyen
terme? ». (3)
Cet exemple est instructif précisé-
ment en ce que la contradiction entre
le temps court et le temps long n’est
pas vraiment levée : elle reste là,
troublante, pointant un avenir incer-
tain. Pour reprendre la métaphore
de Kenneth Boulding, un précurseur
en la matière, de plus en plus d’ac-
teurs comprennent que nous
sommes en train
de passer d’une
«économie du
cowboy », celle des
grands espaces
ouverts et des res-
sources naturelles
inépuisables, à la
«navette spatiale
Terre », un système
clos incapable de
croître, ne recevant
de l’extérieur que
l’énergie solaire.
Aussi est-il devenu
banal de dire que
l’économie ne
tourne pas dans le
vide, qu’elle est
insérée dans une
biosphère avec
laquelle elle inte-
ragit sans cesse, en
prélevant tout ce
qu’il y a à prélever
et rejetant tout ce
qu’il y a à y rejeter.
Au vu de tous nos
rejets et leurs effets
secondaires sur les
écosystèmes et la
biodiversité, qui risquent d’imposer
les vraies limites à la croissance bien
avant que ne commencent à se réa-
liser les pronostics d’épuisement des
ressources, on peut évidemment
être pessimiste. Toujours est-il que
notre regard sur l’économie, sa
matérialité même, change.
Ce changement nous rapproche de
la vision évoquée par H. Daly dans
l’ouvrage déjà cité, (et que l’on retrouve
facilement dans l’histoire de la pensée
économique, chez John Stuart Mill et
d’autres), celle d’une «écono-
3. « Vers une écologie
industrielle », ParisTech
Review, entretien paru le 21
décembre 2011, accessible
en ligne www.
paristechreview.
com/2011/12/21/
ecologie-industrielle.

Vers l’économie soutenable
4
NOTE DE TRAVAIL N°22
MARS 2012
Quels nouveaux indicateurs
de richesse ?
Florence Jany-Catrice,
PROFESSEUR EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
À L’UNIVERSITÉ LILLE 1
E
xiste-t-il de bons indicateurs
pour réfléchir à la soutenabilité
et à la question multidimensionnelle
de la richesse? Le PIB et la croissance
ont été élaborés dans un contexte
socio-politique extrêmement particu-
lier. D’abord pensé par Simon Kuznets
au lendemain de la grande dépression
de 1929 et mis en place en 1945 alors
que le projet politique était celui d’une
reconstruction des sociétés sur
une base industrielle et marchande.
C’est bien ces deux piliers du projet
politique qui ont finalement été accom-
pagnés de l’outil du PIB. Celui-ci devait
permettre d’envisager dans quelle
mesure la croissance progressait,
l’expansion continue des sociétés se
faisant sur cette base industrielle et
marchande. La croissance mesure, ou
cherche à mesurer, l’expansion des
volumes de production, elle est donc
d’abord marchande et monétaire. Alors
qu’ont été formulées de nombreuses
critiques à propos de ces indicateurs
de croissance et du PIB, je vais m’attar-
der sur seulement deux d’entre elles.
CONTRE LE PIB
La première peut presque être qua-
lifiée d’internaliste, et peut être facile-
ment comprise. La croissance écono-
mique exprimant l’expansion de
volumes, cela pose problème pour un
certain nombre d’activités de plus en
plus importantes dans nos
mie d’état stationnaire», à savoir
une économie dont le stock de capi-
tal physique et la population reste
constants. Puisque ce stock de capital
physique doit être
entretenu en perma-
nence, il doit respec-
ter un volume global
que l’on peut régé-
nérer dans des li-
mites physiques. La
question n’est pas
tant de choisir entre
croissance et dé-
croissance : les deux
sont possibles mais
toujours en tant que
phases intermé-
diaires, comme un passage d’un état
stationnaire à l’autre.
DE LA « VALEUR » ABSTRAITE
À LA MATIÈRE-ÉNERGIE
Paradoxalement, le retard est peut-
être le plus marquant dans les manuels
d’économie, qui abondent d’images de
flux circulaires abstraits, reliant la pro-
duction et la consommation ; dans leur
version élémentaire, le flux relit les
ménages aux entreprises : les ménages
livrent aux entreprises les facteurs de
production, les entreprises leur livrent
en retour les biens et services. Les ver-
sions plus sophistiquées ajoutent plu-
sieurs boucles supplémentaires: la
dépense publique, la finance, le com-
merce international… mais les flux
tournent toujours dans le vide et non
au sein d’un écosystème. On pourrait
croire que ce qui tourne ainsi est une
substance abstraite, la « valeur », et non
la matière-énergie. La « valeur » se re-
cycle à l’infini ; la production et la
consommation sont des flux physiques
où une partie d’énergie et de matières
transformées dans le processus devient
inutilisable à chaque boucle (4).
Autrement dit, l’enjeu d’une «autre»
macroéconomie renvoie inéluctable-
ment aux arguments développés dès
les années 1960 par Nicholas
Georgescu-Roegen (5), le premier à
avoir appliqué à l’économie le principe
d’entropie et la deuxième loi de la
lll
thermodynamique. Toute activité
économique comporte une part de
dégradation irrécupérable. Cela vaut
de façon évidente pour les énergies
fossiles, mais la thèse s’applique
aussi à la matière utilisable: l’utilisation
de tout bien de consommation com-
porte une dégradation qui est, en
partie, irrécupérable. L’exemple donné
par Georgescu-Roegen est la pièce de
monnaie: pour tout solide qu’elle
paraisse, elle s’use, car les molécules
qui s’en détachent échange après
échange sont perdues irrévocablement.
Ce raisonnement jette un profond
doute sur les promesses d’un décou-
plage absolu entre la croissance
physique et la croissance économique,
et c’est bien là le cœur du débat. On
évite souvent la question en invoquant
le découplage relatif, les gains d’effi-
cience dans la consommation d’éner-
gie et de matière réalisés grâce au
progrès technologique. Il est vrai que
l’intensité énergétique du PIB baisse,
comme l’intensité carbone de la pro-
duction d’énergie, mais il y a une limite
à ces gains d’efficience, et cela pas
uniquement à cause de l’effet de re-
bond qui fait que la consommation
globale augmente quand même. A
en croire les calculs de Tim Jackson,
si l’on considère un monde de demain
avec 9-10milliards d’habitants ayant
un revenu comparable au nôtre,
l’intensité carbone devrait baisser
quinze fois plus vite que le progrès
réalisé depuis les années 1980. On
peut discuter les détails du calcul à la
base de ces estimations , mais l’argu-
ment de Georgescu-Roegen est plus
fondamental: puisque la croissance
immatérielle n’existe pas, l’économie
d’état stationnaire s’imposera tôt ou
tard. La question est simplement de
savoir si nous pouvons anticiper le
changement, pour éviter une dou-
loureuse adaptation. u
“TOUTE ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
COMPORTE
UNE PART DE
DÉGRADATION
IRRÉCUPÉRABLE.”
lll
4. Voir à ce sujet « The Circular
Flow of Exchange Value and
the Linear throughput: A Case
of Misplaced Concreteness »,
article paru initialement dans
Review of Social Economy,
déc.1985, repris dans The
Steady State Economics,
op. cit., pp. 195-205.
5. Pour un résumé de
l’argumentation de Nicholas
Goergescu-Roegen par l’auteur
lui-même, voir « Energy,
Matter and Economic
Evaluation : Where do we
Stand ? », dans Energy,
Economics, and the
Environnement, Hermad Daly
& Alvaro F. Umana (éds.),
1981, pp. 43-79.

5
CHANTiERS
de l’Institut pour le développement de l’Information économique et sociale
LES
NOTE DE TRAVAIL N°22
MARS 2012
sociétés. Par exemple, qu’est-ce
qu’un « volume » d’éducation ? De
santé ? D’aide à domicile ? Ces do-
maines nécessitent des conventions,
pas seulement techniques, mais qui
interrogent la représentation que l’on
se fait de la finalité de l’activité. Cette
critique est interne, car le PIB est consti-
tué aujourd’hui aux deux tiers d’acti-
vités de service à propos desquelles
on a justement des difficultés à appré-
hender le « volume ».
La deuxième critique est plus ex-
terne: est-ce de l’expansion de volume
dont on a besoin quand on vise une
production plus durable, des biens de
meilleure qualité, plus économique
en composants matériels et accessible
à tous ou au plus grand nombre ? Il
ne faut jamais oublier la question
sociale dans le débat sur la soutena-
bilité. Peut-on donc rester arcbouté
sur l’idée que l’on peut avoir une forme
de gisement de productivité dans des
projets dans lesquels sont nécessaires
plus de qualité, plus de durabilité, plus
de sobriété et de solidarité ?
ENJEU DÉMOCRATIQUE
Une fois ces critiques établies, dis-
posons-nous de bons indicateurs et
comment faire ? Sur ces questions très
délicates et complexes, nous ne partons
pas de rien. En particulier, il me semble
que la sociologie de l’action publique
et de la quantification sont tout à fait
instructives de ce point de vue. On
peut alors partir du constat que nous
sommes confrontés dans notre envi-
ronnement actuel à une double contin-
gence. Tout d’abord, en moins de deux
décennies, un ou deux indicateurs ont
en quelque sorte kidnappé nos repré-
sentations collectives de ce que sont
nos richesses et nos finalités de vie en
société. Il faut de la croissance pour la
croissance, c’est bien là qu’est le pro-
blème. Ce n’est pas tant l’indicateur
qu’on peut critiquer en soi, mais plutôt
ses usages en tant qu’indicateur de
pilotage automatique de la vie pu-
blique et donc de nos vies individuelles.
Cela pose un enjeu démocratique
majeur dans nos sociétés.
La deuxième contingence, pour la-
quelle je suis engagée et aussi souvent
critiquée, est la quantification. On peut
véritablement le déplorer, mais nous
sommes dans des sociétés qui sont
extrêmement guettées par la « quan-
tophrénie » c’est-à-dire des formes de
frénésie de la mise en chiffres de toutes
les réalités. D’un côté, c’est très com-
mode pour les acteurs publics, car ils
considèrent que les chiffres sont accré-
dités d’une forme de neutralité axio-
logique ou apolitique. C’est-à-dire que
l’on peut les utiliser pour des actions
publiques et qu’il n’y a plus besoin de
réinjecter ni de la politique ni du débat
public dans la question de la mesure.
Un autre aspect de la quantophrénie
est lié à la valeur sociale du chiffre. Les
chiffres sont en quelque sorte des
arguments supérieurs qui supplantent
toute autre forme d’argumentaire dans
le débat public. C’est tout à fait flagrant,
n’importe quel débat contradictoire
se fait à coups de chiffres. Cette contin-
gence, que l’on peut déplorer, est
d’autant plus forte qu’elle repose sur
des concepts flous. On parle de bien-
être individuel ou collectif, de déve-
loppement soutenable, de croissance
différente, de qualité de vie… Et ce
que je remarque, pour avoir participé
à la commission de concertation sur
les indicateurs du développement
durable en France, c’est que nous ne
prenons même plus le temps de réflé-
chir à une définition préalable de ces
concepts très importants. Et finalement,
ce sont les indicateurs qui finissent
par incarner les concepts.
Au sujet du développement durable
en France, je ne comprends pas bien
encore la stratégie adoptée par les
pouvoirs publics, mais je connais très
bien les dix indicateurs phares qui
constituent ce qu’est la stratégie du
développement durable. Tout ceci
pour vous dire que la question de la
mesure n’est pas une question
technique et qu’elle devrait être réap-
propriée par le monde du politique
au sens très noble du terme.
Quelles formes doivent alors pendre
ces indicateurs ? Comment produire
de la légitimité pour supplanter ceux
qui sont extrêmement prégnants dans
nos représentations collectives ? Il faut
d’abord réfléchir à la spécificité de
nouveaux indicateurs potentiels et
essayer de trouver avec l’ensemble
des acteurs ce qui fait leur spécificité.
On voit bien que cela s’oppose à une
légitimité liée à des
formes d’universa-
lisme qui sont extrê-
mement préémi-
nentes dans les
nouveaux formats
d’indicateurs. Par
exemple, le PNUD et
son indicateur de
développement
humain (IDH), tout
rudimentaire qu’il
soit, a été fortement
aidé par la manière
universelle avec la-
quelle il était mesuré.
Il pouvait donc
s’appliquer indiffé-
remment à la France,
au Luxembourg ou
à une région de
l’Amazonie. Mais
l’universalisme va
souvent de pair avec
une forme de domi-
nation dans la représentation que l’on
impose à ce que l’on appelle la soute-
nabilité, et va de pair avec une forme
d’ethnocentrisme dans ce que l’on
renvoie comme représentation.
SUBSTITUALITÉ
Une autre question liée à la légi-
timité porte sur la forme de ces
indicateurs et en particulier sur la
question de la substituabilité. Un
indicateur comme celui de la sou-
tenabilité retenu par la commission
Stiglitz renvoie à des dimensions
qui relèvent à la fois de la question
économique, de la question sociale,
de la question environnementale.
Cet indicateur monétarise l’ensemble
de ces dimensions –et c’est le cas
de l’épargne nette ajustée– produit
des formes de substituabilité
lll
lll
“LES CHIFFRES
SONT EN QUELQUE
SORTE DES
ARGUMENTS
SUPÉRIEURS
QUI SUPPLANTENT
TOUTE AUTRE
FORME
D’ARGUMENTAIRE
DANS LE DÉBAT
PUBLIC.”
 6
6
 7
7
1
/
7
100%