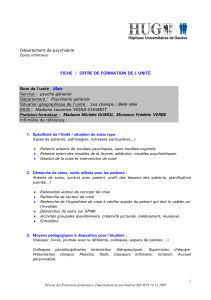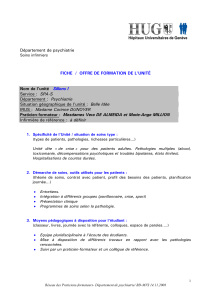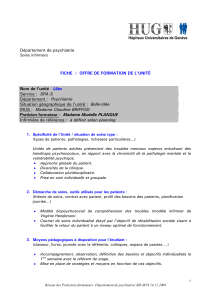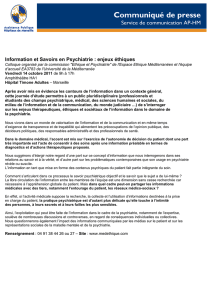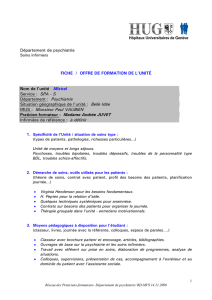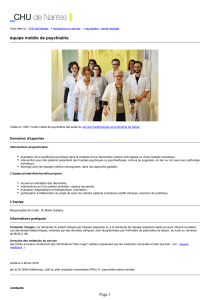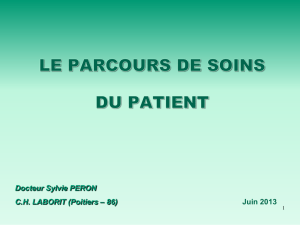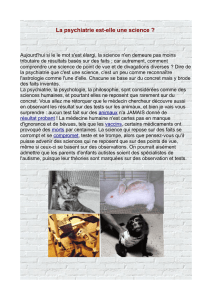Trois métiers impossibles : gouverner, soigner, éduquer

1
Dispositif de stage intercatégoriel n° 12A13
« Les normes médicales et les représentations de l’humain »
Stage déposé par :
Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (IA-IPR de Philosophie) et Benoît PAIN
24 janvier 2013
Lycée du Bois d’Amour
Dr. Frédéric SALES
Psychiatre, praticien hospitalier au CH de Libourne
Chef de service de CAPLib (intersecteur de psychiatrie de liaison et d'urgence)
De « psychiatrie » à la « santé mentale » Nous sommes entrés dans l’ère d’une
psychiatrie postmoderne, qui veut allouer, sous le terme de « santé mentale », une
dimension médicale et scientifique à la psychiatrie. Jusqu’à présent, cette discipline
s’intéressait à la souffrance psychique des individus, avec le souci d’une description fine de
leurs symptômes, au cas par cas. Depuis l’avènement du concept de santé mentale, émerge
une conception épidémiologique de la psychiatrie, centrée sur le dépistage le plus étendu
possible des anomalies de comportement. Dès lors, il n’est plus besoin de s’interroger sur
les conditions tragiques de l’existence, sur l’angoisse, la culpabilité, la honte ou la faute ; il
suffit de prendre les choses au ras du comportement des individus et de tenter de les
réadapter si besoin.
La cause de cette tendance. Le DSM (Diagnostic and Statistical Manual), sorte de
catalogue et de recensement des troubles du comportement créé par la psychiatrie
américaine. En multipliant les catégories psychiatriques (entre le DSM I et le DSM IV, soit
entre les années 1950 et les années 1990, on est passé de 100 à 400 troubles du
comportement), il a multiplié d’autant les possibilités de porter ces diagnostics. Aujourd’hui,
on est tombé dans l’empire des « dys » : dysthymique, dysphorique, dysérectile,
dysorthographique, dyslexique… Chaque individu est potentiellement porteur d’un trouble ou
d’une dysfonction. Ce qui étend à l’infini le champ de la médicalisation de l’existence et la
possibilité de surveillance sanitaire des comportements. La santé mentale ne s’est pas
imposée à des sujets victimes, passifs, mais à des individus consentants. Depuis
l’effacement des grandes idéologies, l’individu se concocte son propre guide normatif des
conduites, qu’il va souvent chercher dans les sciences du vivant.
Une évolution. Il semble que les dispositifs de santé mentale aient le souci de
soigner, et encore moins de guérir. Ils sont plutôt du côté d’un dépistage précoce et féroce
des comportements anormaux, que l’on suit à la trace tout au long de la vie. Or, en
s’éloignant du soin, la santé mentale utilise des indicateurs extrêmement hybrides. Ainsi de
l’expertise collective de l’Inserm (2005) qui préconisait le dépistage systématique du
« trouble des conduites » chez le très jeune enfant pour prévenir la délinquance : elle
mélangeait des éléments médicaux, des signes de souffrance psychique, des indicateurs
sociaux et économiques, voire politiques.
Prévention et soin. Il semble que la prévention permet en réalité d’étendre le filet de
la surveillance des comportements, en liaison permanente avec l’industrie pharmacologique.
La production de nouveaux diagnostics est devenue la grande affaire de la santé mentale.
Voyez le concept de « troubles de l’adaptation » : il est suffisamment flou pour qu’on puisse
l’attribuer à chaque personne en position de vulnérabilité. Quelqu’un qui est stressé au

2
travail ou qui est angoissé par une maladie grave peut ainsi développer une « réponse
émotionnelle perturbée », qui sera considérée comme trouble de l’adaptation. La réponse
sera de lui administrer un traitement médicamenteux, accompagné d’une thérapie cognitivo-
comportementale pour l’aider à retrouver une attitude adaptée. Ainsi, la « nouvelle »
psychiatrie se moque éperdument de ce qu’est le sujet et de ce qu’il éprouve. Seul importe
de savoir s’il est suffisamment capable de s’autogouverner, et d’intérioriser les normes
sécuritaires qu’on exige de lui. On peut craindre que l’on demande aux psys d’être
davantage des coachs que des soignants. Depuis quelques années, on assiste à une
multiplication hyperbolique de la figure du coach, devenu une sorte de super-entraîneur de
l’intime, de manager de l’âme. Les dispositifs de rééducation et de sédation des conduites
fabriquent un individu qui se conforme au modèle dominant de civilisation : un homme
économique, flexible, et performant. La psychanalyse est totalement à rebours de ces
idéologies, en ce qu’elle fait l’éloge du tragique, de la perte, du conflit intérieur, d’un certain
rapport à la mort et au désir. Elle peut donc disparaître en tant que pratique sociale. A cet
égard, il est frappant de voir que la psychanalyse, désavouée par la santé mentale, est
actuellement requise dans les services de médecine non psychiatrique. Tout se passe
comme si les médecins, à l’inverse des nouveaux psychiatres, reconnaissaient qu’il y a une
part hétérogène au médical, qui est que toute maladie est un drame dans l’existence, et qu’il
faut aider le patient à traverser cette épreuve.

3
Pour aller plus loin : DRAPERI Catherine (MCF Philosophie, UFR Médecine
d’Amiens), « Psychiatrie : logiques thérapeutiques en débat », Ethique et santé, Paris,
Elsevier-Masson, vol 9 - n° 4 - décembre 2012, pp. 141-142
« Véhiculant de façon privilégiée le souci historique de transformer des lieux de
rétention et de répression de la marginalité en véritables lieux de soins, la psychiatrie
demeure également l’espace privilégié du souci éthique au cœur de la prise en charge. De
Pinel, prônant le respect de l’humanité à travers le respect du malade, au mouvement de
sectorisation au lendemain de la seconde guerre, en réaction aux traitements dont les
hôpitaux psychiatriques furent le théâtre, la psychiatrie est cette spécialité médicale qui, plus
que toute autre, rencontre au quotidien le sens de l’existence entravée en conflit avec la
norme sociale.
Parce que le sens de l’action soignante est ici lisiblement indissociable de son
efficience, parce que le cadre institutionnel a ici vocation à être cadre thérapeutique, les
modalités de l’échange sont elles-mêmes impliquées ou plus précisément font partie
intégrante du soin : un soin qui ne saurait consister dans la seule application de techniques,
mais se déploie dans la pratique de la relation. La psychiatrie se présente ainsi comme ce
lieu de la médecine où l’on ne peut faire l’économie du sens sans faire l’économie de son
objet — cette atteinte à l’intégrité dans sa relation avec le dehors, que les soignants
abordent en termes de souffrance.
Aussi est-ce là aussi qu’affleurent avec le plus d’acuité les questions que pose
l’introduction dans l’activité médicale et soignante, d’une logique de la preuve qui met à mal
l’épreuve soignante, en réduisant la rencontre à un recueil de données, une observation
objectivante, qui n’aurait d’autre finalité que de mettre en œuvre les moyens présumés
adéquats pour venir à bout des signes d’un mal-être en le gommant. C’est en tout cas ce
schéma qu’a, semble-t-il, rencontré Despoira Nikiforaki dans l’expérience de novice d’un lieu
de psychiatrie qu’il partage ici, en insistant sur son propre ressenti concernant la carence de
cette approche. Une expérience qui est loin cependant de relater le travail de fond à l’œuvre
dans bien des équipes en psychiatrie, tant sur le plan réflexif que dans les pratiques
thérapeutiques, mais dont le mérite est peut-être de mettre en exergue l’importance d’un tel
travail, alors même qu’aujourd’hui, il est mis en cause dans le primat d’une logique exclusive
de résultat à courte vue. Plus qu’ailleurs, l’attitude positiviste traduisant en faits donnés
l’expérience vécue, interroge sur le refoulement du sens dans le soin.
La psychiatrie, ce lieu si particulier de la médecine, aurait alors une valeur
paradigmatique : ici se révèle comment la réduction du symptôme en signe d’anormalité qu’il
s’agirait de juguler, met entre parenthèse l’expérience subjective du mal-être, partagée par le
patient et le thérapeute, c’est-à-dire la dimension indissociablement clinique et éthique de sa
prise en soin. Alors, les méthodes préconisées parce qu’elles seraient évaluables à l’aune
d’une norme quantifiée et d’un objectif de régulation, apparaissent non seulement étrangères
à la finalité de seconder le patient dans la conquête d’une normativité, mais aussi animées
d’une vue à court terme à laquelle ne saurait se réduire la démarche thérapeutique. À la
différence de stratégies inféodées à l’impératif de donner une réponse immédiate au
comportement anormal, quitte à enliser la question et la réponse dans un présent sans
perspective, la démarche questionnant le sens du symptôme, s’arrime à la temporalité du
sujet et d’une histoire en construction. Si la première vient remplir une exigence de
régulation sociale au regard de laquelle il n’est sans doute pas anodin de permettre au
malade de répondre à l’injonction d’une normalité de comportement, la seconde vise, à la
construction avec le patient d’un monde habitable.
L’étrangeté de l’expérience langagière du mal-être ne se laisse pas nécessairement
décoder ni épuiser, dans un système sémiologique où tous les signes se vaudraient : elle
exige interprétation. C’est tout le sens du cheminement qui conduit par exemple de la
désignation des « crieurs » à travers leur comportement dérangeant, au cri comme
symptôme signifiant. Sans doute, la psychiatrie pose-t-elle des questions éthiques
exemplaires, non seulement quant au consentement, mais plus fondamentalement encore,
quant à la nature de l’objet du contrat auquel il s’agirait de consentir : celui-ci ne peut à
proprement s’élaborer que laborieusement et en se faisant, lorsqu’il s’agit moins de soulager

4
une souffrance que de lui permettre d’advenir en lieu et place de l’opacité du symptôme.
Sans doute, l’imaginaire est là pour témoigner de ce que les aspérités que donnent à lire
l’histoire d’une vie ne sauraient se résorber dans la transparence de dysfonctionnements et
de comportements inadaptés à la norme, à laquelle une approche positiviste voudrait les
réduire.
Si la psychiatrie souffre aujourd’hui, c’est peut-être que ce cheminement incertain du
sujet, dans lequel le patient met au travail ses thérapeutes, ne se laisse pas inféoder à une
infaillible marche à suivre qu’appellerait de ses vœux une société éprise de certitude. C’est
qu’elle ouvre le sujet sûr de la réalité de son monde, à l’abîme de l’altérité.
L’idéologie à l’aune de laquelle l’autonomie de l’homme se mesure à la capacité à
produire et à gérer sa vie, résout la question de l’évaluation d’une situation à un objectif de
normalisation. Or, l’expérience humaine du bien et du mal-être, au cœur de laquelle Aristote
nous rappelait déjà la place motrice du désir, témoigne au quotidien de ce qu’elle s’accomplit
en deçà et eu delà de la capacité à fonctionner, fût-ce de façon optimale. N’est-ce pas
précisément dans cette tension du désir au cœur de la pratique, que la philosophe ancrait le
souci éthique dans la quête du bonheur ? Une quête dont la finalité universelle admet la
diversité des moyens, car elle ne se construit que dans l’évaluation singulière de chacun.
C’est sur ce chemin escarpé de la construction de son histoire, que la psychiatrie vient
rencontrer l’expérience du patient. En cela, loin de constituer un îlot excentré de la
médecine, la psychiatrie serait le miroir des questions qui en traverse l’exercice au quotidien,
et font débat de façon discrète mais croissante, à mesure que la standardisation des moyens
met en péril la tension du regard vers la finalité du soin. »

5
Pour aller plus loin : NIKIFORAKI Despoira (interne en médecine et docteure en
sciences humaines de l’E.H.E.S.S.), « Note d’une externe en service psychiatrique »,
Ethique et santé, Paris, Elsevier-Masson, vol 9 - n° 4 - décembre 2012, pp. 176-180.
Docteur en sciences humaines depuis peu, formée à élucider un ordre intime des
choses touchant à des matérialités fictives, j’ai choisi d’élargir ma quête intellectuelle en
apprenant la médecine. Honorée de rejoindre cette profession dont j’avais pu rêver, en
représentation idéale, comme étant celle qui accomplit une œuvre utile auprès de ce qu’est
l’homme véritablement, sans théorie artificielle interposée, j’éprouvais surtout la nécessité de
me rapprocher de cet espace de vie où l’humanité m’apparaissait immédiate, douloureuse et
mise à l’épreuve. Admiratrice également de la réflexion de Georges Canguilhem, alliant
modestement, soutenait-il lui-même, dans l’introduction de sa thèse intitulée Le Normal et le
pathologique, la spéculation philosophique aux acquisitions et connaissances médicales, je
me savais marcher dans un terrain ambigu où la coexistence du principe scientifique
moderne, garant d’évolution, et le vieux caractère d’un métier humaniste, garant de
fondement, est certainement admise, quoique sans rencontrer un enthousiasme unanime1 .
En mode de visite alors dans ce « nouveau » monde, chargée moi-même d’un
bagage culturel lourd et portant l’étrangeté d’un observateur qui marche sur la ligne de la
marge, je passe du côté de la médecine. Quel regard pourrais-je dorénavant poser sur
l’univers agité du centre hospitalier universitaire une fois franchie la distance qui me séparait
de lui ? Un service de psychiatrie parisien allait être mon domaine de prédilection, comme le
prolongement d’un itinéraire personnel et littéraire déjà constitué de fragments de corps et de
discours éclatés, puis mis en tension pour fabriquer du sens, sens qui m’apparaissait jusqu’à
présent éphémère et fugitif et qui ne saurait aucunement faire le poids face à la vérité d’une
société qui, elle, ne se substitue ni ne se laisse réduire au concept. Sachant que j’étais
fascinée par l’être piégé dans la pathologie psychiatrique, une question latente attendait
réponse : comment le médecin-psychiatre s’y prend-il afin de rétablir cet équilibre en
désordre ? En quoi consiste véritablement son travail de fond ? Et, de façon plus large, de
quoi en est-il question en psychiatrie ?
Ces interrogations peuvent, sans doute, sembler sans intérêt pour celui qui connaît la
réponse. Au demeurant, j’insiste sur le fait que les notes présentées ici restent des
observations absolument subjectives et, en aucun cas, elles ne tiennent lieu de vérité
générale. Elles ne peuvent tenir compte que d’une des facettes d’une situation complexe,
vue de la part d’un individu en particulier, saisie à un moment donné et dans un lieu précis.
De plus, ce que connaît comme une évidence un psychiatre ou un médecin formé dans une
autre spécialité ne correspond pas nécessairement avec la vision de celui qui se rapproche
du domaine médical sans avoir été préalablement formaté et conditionné pour agir dans ce
milieu. Le monde médical n’est pas un monde anodin : l’apprentissage de la médecine
consiste aussi bien en l’intégration d’un enseignement universitaire polyvalent, qu’en
l’acquisition progressive d’un savoir-faire relevant de l’exercice du métier, de l’expérience qui
s’acquiert sur le terrain, au contact, en temps réel, des médecins et des patients2 . La durée
de ce stage était prévue pour un trimestre, ma fonction allait être celle d’une externe
ordinaire et, entourée des autres étudiants en médecine, j’allais faire partie intégrante de ce
service. Ainsi, encadrés par l’équipe médicale, l’équipe soignante et la psychologue, nous
allions à la fois participer aux tâches médicales secondaires et apprendre, au fil des jours, de
nos aînés, le métier du médecin dans la pratique.
J’ai compris malgré moi qu’une immersion dans le monde hospitalier s’accompagne
forcément du retour d’une conscience vive qui ne peut s’avouer vaincue malgré les
contrariétés, présentes dans un milieu où les individualités s’entremêlent sans cesse. J’étais
sur le point d’expérimenter jusqu’où l’objectivité de l’observation médicale rencontre, en
psychiatrie, le caractère personnel de la maladie et du malade en particulier. Gérard Reach
pense que l’amour porté au soigné par le praticien est de l’ordre du personnel : la personne
aimée l’est pour elle-même, en tant qu’individu, et non pas d’une manière générale [1]. La
psychiatrie s’offrait alors à moi comme une sorte de cinéma du réel, une projection
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%