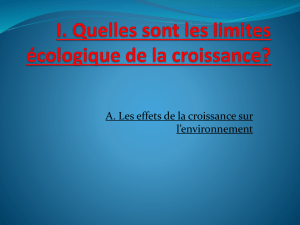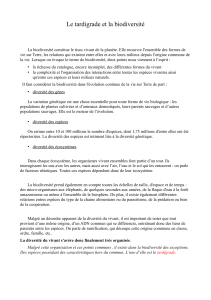ET SI ON PARLAIT BIODIVERSITÉ ? - APPA Nord

16
Edition d’octobre 2012
#1
ET SI ON PARLAIT BIODIVERSITÉ ?
SECONDES ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
COMPTE-RENDU DE COLLOQUE
Du 26 au 28 septembre dernier, se
tenaient les secondes Assises Natio-
nales de la Biodiversité au Palais
du Littoral de la ville de Grande-
Synthe. C’est dans cette commune
élue première capitale française
de la biodiversité en 2010, que s’est
tenue une série de conférences,
tables rondes et autres ateliers sur
des sujets variés (ex : biodiversité
marine, espèces exotiques enva-
hissantes, espaces naturels ouverts
au public, etc.), mais tous reliés par
la thématique de la biodiversité.
Le Professeur Damien Cuny, Vice-
président de l’APPA Nord – Pas de
Calais, participant à l’animation de
la conférence intitulée « La biodi-
versité au service de la santé pu-
blique », nous nous sommes rendus
sur les lieux an de vous faire parta-
ger cette expérience.
La relation unissant la santé et la
biodiversité est un sujet qui attire,
puisque nombre de personnes
étaient présentes pour écouter les
quatre conférenciers venus s’expri-
mer sur le sujet : le Professeur André
Caudron, Docteur en Pharmacie,
Christophe Aubel, Directeur de
l’association « Humanité et Biodi-
versité », Brigitte Deroo, Directrice
du Centre de Santé de Grande-
Synthe, ainsi que le Professeur Da-
mien Cuny.
Chacun abordant des approches
différentes autour de la question,
il est intéressant de zoomer sur ces
quatre regards.
CHRISTOPHE
AUBEL
Le Directeur de l’association
Humanité et Biodiversité1 , Chris-
tophe Aubel, est le premier à
prendre la parole et entre très vite
dans le vif du sujet : sa réexion se
fera en trois points et fera écho au
colloque qui a eu lieu en juin 2011
sur la même thématique, à Aix-en-
Provence.
Dans un premier temps, il nous
propose d’arrêter de voir la bio-
diversité comme un danger pour
l’Homme. Cette dernière est en ef-
fet trop souvent perçue négative-
ment et assimilée aux maladies ;
dès lors, la réponse des pouvoirs
publics est souvent disproportion-
née. Si les microbes et les bacté-
ries appartiennent à la biodiver-
sité, c’est l’Homme qui est le plus
souvent responsable des pandé-
mies du fait des bouleversements
liés à la mondialisation. C’est ainsi
qu’il prend pour exemple la mala-
die de Chagas, cette pathologie
transmise par les punaises et dont
on dénombre 300 000 cas par an.
Si à l’origine les punaises vivaient
essentiellement dans les savanes
sèches, le développement de
l’urbanisation a conduit les terri-
toires à se transformer, perturbant
le milieu de vie de ces insectes.
Contraints à trouver de nouveaux
habitats, c’est dans les logements
qu’ils ont commencé à élire domi-
cile, entraînant inéluctablement
la diffusion de la maladie.
C’est lors de son second temps
que Christophe Aubel veut sen-
sibiliser son public sur le fait que
vouloir contrôler les êtres vivants
a inévitablement un impact sur
la santé de l’Homme. Il aborde
alors le problème de l’antibioré-
sistance, la résistance aux antibio-
tiques et aux facteurs extérieurs
qui viennent attaquer le système
immunitaire. Il prend également
pour exemple les moustiques,
dont certaines espèces sont
devenues résistantes aux pesti-
cides. Ces techniques lourdes en
conséquence sur l’écosystème
ne s’avèrent donc plus efcaces
et les retombées ont un impact
certain sur toute la biodiversité, y
compris sur ceux qui voulaient la
contrôler.
Le troisième point de Christophe
Aubel se veut plus positif puisqu’il
vise à démontrer que la biodiver-
sité peut aussi nous soigner. Il rap-
pelle ainsi que les médicaments
contiennent de nombreuses
molécules provenant des plantes
et que des techniques médici-
nales se développent via la bio-
diversité ; en effet, des études
tentent aujourd’hui d’insérer de
« bonnes » bactéries sur des per-
sonnes malades, que les médi-
caments ne guérissent plus. Pré-
sentes dans notre tube digestif
mais aussi sur notre peau, les bac-
téries sont vitales pour notre survie
et une perte de leur diversité peut
impacter notre santé. Protéger la
nature contribuerait donc à notre
bien-être et si la qualité de notre
santé dépend aussi de la qualité
de l’écosystème, ils méritent tous
deux qu’on s’y intéresse de plus
près.
1 En savoir plus : http://www.humanite-biodiversite.
fr/categorie/sante-et-biodiversite

17
Edition d’octobre 2012
#1
ANDRÉ CAUDRON
Lorsque le Professeur André Caudron
prend la parole, il annonce immédia-
tement à son public que les plantes
médicinales sont « [son] problème de-
puis 70 ans » et qu’elles ont un rôle à
jouer dans la thérapeutique moderne.
Elles susciteraient aujourd’hui un inté-
rêt de plus en plus vif, puisqu’elles
seraient, selon lui, mieux tolérées par
l’être humain et ne présenteraient pas
ou peu d’effets secondaires, contrai-
rement aux médicaments de syn-
thèse.
Mais si les plantes médicinales peuvent
jouer un rôle important sur la santé hu-
maine, elles sont à utiliser avec minutie,
puisque la chimie des plantes est une
science précise et complexe. An d’il-
lustrer ses propos, le Professeur prend
l’exemple du fenouil, une plante aux
effets multiples : les racines seraient
diurétiques, les feuilles décongestion-
nantes, tandis que les graines lutte-
raient contre les colites et autres bal-
lonnements intestinaux. Les différentes
parties d’une même plante ont donc
des rôles différents et il faut les utiliser
à bon escient pour bénécier de leurs
vertus. Il faut également veiller à utiliser
la plante quand celle-ci peut appor-
ter des vertus thérapeutiques. En effet,
si certaines d’entre elles perdent leurs
propriétés thérapeutiques en séchant,
d’autres au contraire les acquièrent à
ce moment là.
Le Professeur André Caudron clôt son
discours en réafrmant la légitimité
des plantes dans le monde médical et
en valorisant le rôle précieux qu’elles
ont, si utilisées à bon escient.
DAMIEN CUNY
Une fois les interventions de Chris-
tophe Aubel et André Caudron termi-
nées, c’est à Damien Cuny, Vice-pré-
sident de l’APPA Nord – Pas de Calais,
de s’exprimer. Celui-ci propose à son
public d’aborder la thématique don-
née à travers la question de la pollu-
tion atmosphérique, son domaine de
recherches depuis de nombreuses
années. C’est via un PowerPoint illus-
tré qu’il montre à son auditorat que
les grandes causes anthropiques de
l’appauvrissement de la biodiversité
appartiennent à plusieurs catégories
bien identiées, dont le changement
climatique et la pollution atmosphé-
rique. Cette dernière, qu’il qualie
de « phénomène complexe » qui agit
à différentes échelles, n’est pas à
prendre à la légère : si déséquilibre il
y a dans l’environnement, c’est la bio-
diversité qui sera altérée en premier. Et
celle-ci concerne tout le monde, tous
les jours, à toute échelle.
Car le véritable problème de la pollu-
tion atmosphérique réside dans le fait
qu’un polluant se déplace et se trans-
forme : si son chemin commence dans
les airs, il nira dans les sols, puis dans
les nappes phréatiques. Inévitable-
ment, ce polluant aura un impact sur
la biodiversité et bouleversera toute la
chaîne alimentaire. Si une grenouille
boit cette eau polluée, elle sera ma-
lade, consommera différemment et
tout l’écosystème se comportera au-
trement. La pollution atmosphérique
est donc ce facteur extérieur qui mo-
die les espèces, leur répartition dans
l’espace et qui agit directement sur la
santé de l’Homme, qui développe de
nouvelles maladies : accidents cardio-
vasculaires, modication des agents
pathogènes, etc.
On comprend dès lors que tout est lié
et qu’il existe encore un trop grand
manque de connaissances car la
question de la biodiversité n’est pas
toujours encouragée dans les pro-
grammes de recherche, augmentant
au fur et à mesure le décit à rattraper.

18
Edition d’octobre 2012
#1
BRIGITTE DEROO
Brigitte Deroo, la Directrice du Centre
de Santé de Grande-Synthe, est la
quatrième et dernière intervenante à
prendre la parole. Le public comprend
très vite comment celle-ci va orienter
son discours puisqu’elle aborde immé-
diatement la question des politiques
publiques en matière de santé et de
nutrition. Selon elle, notre alimentation
a été et reste orientée par les lobbies
agro-alimentaires, dont les publicités
et slogans recommandent d’adopter
un type d’alimentation bien précis et
« formaté ». Si le concept de la pro-
motion d’une alimentation équilibrée
n’est pas mauvais en soi, évidem-
ment, Brigitte Deroo rappelle qu’il
devrait toutefois ne pas être le seul
critère à prendre en compte.
En effet, il faudrait veiller à replacer
la nutrition dans sa régionalité an
de favoriser l’accessibilité aux « bons
produits », mais aussi l’associer à la
question du goût, de la durabilité et
de l’agriculture. Une solution envisa-
geable serait de ne consommer que
les produits locaux, puisqu’ils conser-
veraient davantage leurs saveurs,
nécessiteraient peu de transports et
seraient moins polluants. La limite de
cette idée réside bien évidemment
dans le fait qu’une région ne peut
pas produire à elle seule le nécessaire
pour avoir une alimentation équilibrée
et variée.
Il existe donc des solutions, mais des
solutions à étudier et à développer. En
attendant des impacts à long terme, il
faudrait avant tout promouvoir l’équi-
libre alimentaire auprès des enfants
et les sensibiliser sur la relation qui lie
l’alimentation au développement
durable.
On comprend dès lors que la ques-
tion de la biodiversité au service de la
santé publique est un sujet vaste qui
peut être appréhendé de différentes
façons : si M. Aubel a opté pour un
constat général de la situation ac-
tuelle, M. Caudron l’a abordée via
les plantes médicinales, tandis que M.
Cuny et Mme Deroo ont respective-
ment choisi de lier cette thématique
à la pollution atmosphérique et à
l’alimentation. Cela prouve une nou-
velle fois que la biodiversité régit notre
quotidien et que toute perturbation
entraîne indubitablement des consé-
quences pour l’Homme, à court ou
à long terme. Elle mérite donc toute
notre attention et tout notre soin.
ET SI ON PARLAIT BIODIVERSITÉ ?
SECONDES ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
COMPTE-RENDU DE COLLOQUES
1
/
3
100%